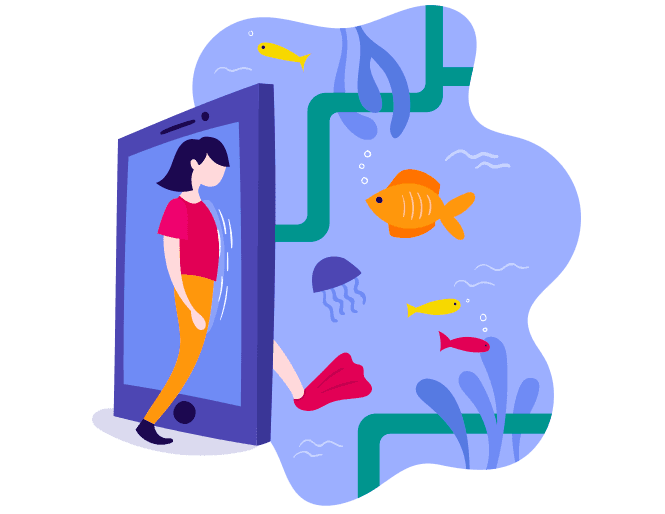
Nos données sous les mers
Nos données personnelles transitent aux quatre coins du monde en moins de quelques secondes. Mais que sait-on de la façon dont elles sont transmises ?
Pour en savoir plus, nous avons interviewé Camille Morel, doctorante sur les enjeux stratégiques des câbles sous-marins à l’université Jean Moulin Lyon III, financée par la Direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS).
Aujourd’hui, 99% des flux d’informations intercontinentaux passent par des câbles sous-marins1 – un système planétaire de plus de 1 200 000 km répartis sur tous les océans. Qui participe à la construction et à la maintenance de ces réseaux ?
C’est un marché assez complexe : il a d’un côté les propriétaires (historiquement des opérateurs réunis en consortium et plus récemment des acteurs privés) - qui utilisent les câbles-, les fabricants - qui produisent les câbles et les équipements nécessaires à la transmission optique-, et les armateurs - c’est à dire les navires en charge de la pose et de la réparation. Parfois, certaines de ses fonctions sont occupées par les mêmes acteurs.
Ces entreprises, à l’exception des opérateurs, étaient majoritairement occidentales (Etats-Unis, Europe, Japon). Désormais, la Chine est également un acteur important du secteur. Cela a un peu modifié les rapports de force. Pour autant, ce paysage n’est pas près d’évoluer, il y a très peu d’autres entreprises ayant la capacité de s’insérer sur un tel marché de niche. Les géants du web participent aujourd’hui activement à la constitution de ces réseaux en tant qu’utilisateurs et que propriétaires des câbles sous-marins.
Parmi tous ces acteurs, qui a le pouvoir sur les câbles en définitive ?
Tout dépend du type de pouvoir dont nous parlons. Ce sont les investisseurs qui choisissent où est-ce que l’on pose les câbles - en fonction de la demande en bande passante - et donc quels internautes en bénéficient selon un cercle vertueux/vicieux. Sur les questions de données personnelles, ce sont les utilisateurs (opérateurs comme Orange, ou fournisseurs de contenu comme Facebook, Google…) qui ont le pouvoir : ce sont eux qui choisissent quels types de données transitent par les câbles. Le constructeur a également une forme de pouvoir. On pourrait - par exemple - suspecter une entreprise de fournir des câbles défectueux ou biaisés pour servir des intérêts nationaux (par exemple par des portes dérobées).
Est-ce que la surveillance des Etats passe par les câbles sous-marins ?
S’il n’est pas possible d’exactement savoir par quels moyens les agences de renseignements (DGSE, NSA…) écoutent nos activités numériques, il est envisageable que cela se fasse en interceptant les données qui transitent par les câbles sous-marins, comme l’ont révélé les déclarations d’Edward Snowden en 2013. Peu importe le moyen par lequel elles voyagent, les données personnelles sont rarement à l’abri des écoutes des services de renseignement.
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement s’est récemment exprimée sur le sujet2. Elle a estimé que les données et métadonnées des citoyens transitant vers l’international sont largement récupérées, et ce notamment du fait des collectes de données réalisées par les services secrets
Des entreprises privées pourraient également être en capacité d’écouter les câbles. Cependant, il me semble qu’elles n’ont pas d’intérêt particuliers à organiser des écoutes à une telle échelle. Dans le cas des GAFA, ces entreprises ont déjà une grande partie de ces données à disposition. Pour le reste des entreprises, le volume de data transitant par ces câbles serait trop important pour être analysé, même au titre de l’intelligence économique.
Les câbles sous-marins constituent de véritables enjeux stratégiques pour les États. Saboter des câbles sous-marins pourrait-il devenir une arme diplomatique ?
Si cela a pu arriver dans le passé, aujourd’hui, il serait compliqué de mettre cela en œuvre. Il y a une trop forte interdépendance entre les pays. Nos communications dépassent le cadre de nos frontières nationales : les ressortissants d’un État peuvent se trouver sur le territoire d’autres États. De plus, il y aura toujours d’autres moyens et routes pour conduire l’information vers son destinataire.
Pour autant, des conventions datant de 1884 autorisent explicitement les attaques sur les réseaux sous-marins en temps de conflit. D’ailleurs, il est fort probable qu’actuellement la NSA écoute les câbles, donc ce n’est pas qu’en temps de guerre que les câbles deviennent un enjeu géopolitique !
En cas d’attaques, ce que nous ne savons pas exactement, c’est quel impact aurait la rupture de tous les câbles entre l’Europe et les Etats Unis, notamment en matière de psychologie sociale. Mettre à mal la transmission d’informations, même si ce ne sont pas des informations vitales, pourrait impacter le moral de la société, ou même créer un mouvement de panique générale.
Qui pourrait envisager vivre au XXIe siècle plusieurs jours voire plusieurs semaines sans aucun contact quotidien avec ses proches ? sans WhatsApp ? ou même, dans une moindre mesure, sans Netflix dont les serveurs sont sur le continent américain ?
__Cette vision semble nous éloigner d’un internet oeuvrant pour le bien commun. Ces réseaux numériques sous-marins pourraient-ils se mettre au service des internautes ? __
En effet, le fait d’ouvrir le financement à des organisations non gouvernementales permettrait une meilleure inclusion de la société civile dans ces enjeux internationaux. Reste que les citoyens ont peu de marge de manœuvre, si ce n’est directement sur leurs modes de consommation.
Il y a toutefois un certain nombre d’initiatives qui sont prises pour essayer de donner aux câbles une ambition un peu plus humaniste. Par exemple, très peu de câbles traversent l’atlantique autrement qu’en reliant Les Etats-Unis et l’Europe. Or, ces réseaux sont des moteurs essentiels pour la croissance, les libertés d’expression, l’innovation, le développement…et seraient les bienvenus dans d’autres zones du globe, peu couvertes aujourd’hui. Le projet de câble ELLALink3 qui relie l’Amérique du Sud à l’Europe tente notamment de renforcer l’inclusion digitale du continent et de réduire les coûts d’accès à internet pour les populations concernées.
1 https://fr.calameo.com/read/00015149975182c95b301
2 https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/04/25/alerte-sur-les-echanges-de-donnees-sensibles-entre-pays_5454741_3224.html?xtmc=surveillance_donnees&xtcr=2
3 https://internetwithoutborders.org/ellalink-lavenement-dun-nouveau-modele-de-gouvernance-des-infrastructures-dinternet/
Partager sur :
