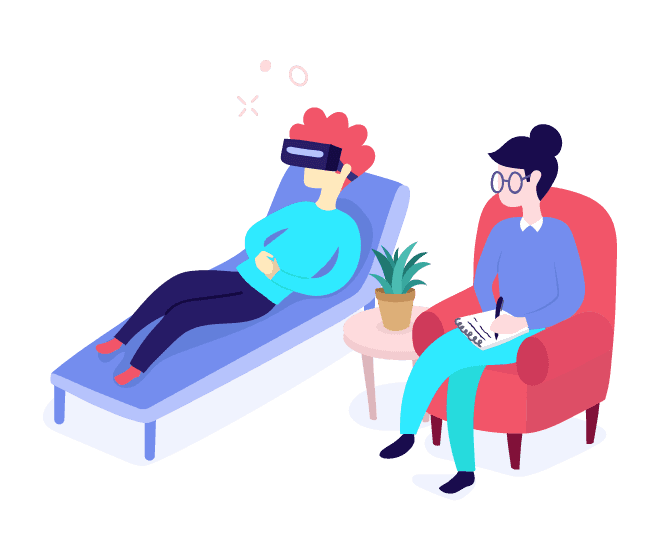
Réalité virtuelle : révolution, échec anticipé ou non-événement ?
Dans ce premier article, Emilie Ropert-Dupont, autrice, et Bahman Ajang, psychologue, étudient l’évolution de l’utopie liée à l’avènement de la réalité virtuelle, et s’intéressent aux multiples applications et changements qu’elle engendre dans la société.
La réalité virtuelle deviendra-t-elle une « super drogue » dans les années à venir, comme l’a prédit Steven Spielberg au moment de la sortie de Ready Player One ? Sera-t-elle synonyme de profits records pour les acteurs industriels qui ont « misé » sur cette technologie ? Facilitera-t-elle l’accès du plus grand nombre au savoir, à l’éducation ? Modifiera-t-elle notre rapport à notre corps, notre capacité à guérir ? Tandis que ces questions reviennent fréquemment dans les médias et chez les observateurs de cette technologie, les réponses tardent à faire consensus pour plusieurs d’entre elles.
La VR a en tout cas déjà démontré sa capacité d’innovation et ses apports dans divers domaines. Nous explorerons ses applications notamment dans le champ médical, et tenterons de comprendre comment l’immersion agit sur l’esprit et les comportements.
Les promesses de la réalité virtuelle : entre enchantement et désenchantement
La réalité virtuelle, à l’instar d’autres innovations lorsqu’elles sont arrivées sur le marché, a parfois été abordée sous l’angle utopique. Il s’agit là d’un mécanisme déjà identifié, par exemple à propos de la radio, de la télévision, d’internet ou aujourd’hui concernant l’intelligence artificielle.
Dominique Wolton avait nommé « prophéties de la communication » 1 ces discours dithyrambiques qui confondent la technique avec ses effets supposés. La réalité virtuelle a ainsi été présentée comme dotée de capacités qui lui seraient propres, réduisant la technique à sa seule dimension instrumentale.
Ce faisant, on oublie - c’est d’ailleurs le cas actuellement lorsque l’on évoque l’intelligence artificielle - que ce sont les humains qui décident de l’utilisation des machines qu’ils créent, et non l’inverse ! La réalité virtuelle a par exemple été surnommée « machine à empathie », comme si ressentir ce qu’autrui éprouve devenait soudain possible. Les commentateurs ont également repris l’expression « effet waouh » pour qualifier l’effet de surprise ressenti par les utilisateurs.
La VR s’inscrit dans une « utopie de la communication » 2 , et par extension une utopie des nouvelles technologies. Cette utopie est caractérisée par un certain nombre de promesses. Le numérique est par exemple associé à des termes tels que « dématérialisation », « transparence », « ubiquité », « accessibilité » qui forment un halo de croyances dans l’imaginaire collectif, sans que l’on sache exactement à quoi ils renvoient. Il en est de même pour la réalité virtuelle, accolée à l’idée d’immersion, d’empathie, d’expérience personnalisée, de nouvelles sensations, ou de plus grande acuité dans la compréhension de l’actualité.
Cette vision utopique correspond à une première étape 3 : le lancement d’une nouvelle technologie entraîne un emballement médiatique qui se traduit par un horizon d’attentes démesuré, suivi d’une désillusion, puis d’une phase de normalisation où les caractéristiques de l’innovation deviennent plus objectives. Le marché se solidifie ensuite progressivement, qu’il s’agisse d’un marché de niche ou de produits qui atteignent un plus vaste public.
Concernant la réalité virtuelle ce pic médiatique a eu lieu en 2014-2016, auquel a succédé une réaction de déception des commentateurs qui s’interrogent actuellement sur son avenir, voire craignent qu’elle ne prenne le chemin d’un échec commercial, comme cela a été le cas pour la 3D.
Sortir de cette binarité enchantement/désenchantement n’est pas aisé. D’aucuns annoncent une concordance technologique pour bientôt, autour de 2020, avec l’arrivée de la 5G et de casques plus légers, atténuant ou supprimant les entraves au déplacement ainsi que la motion sickness (sensation de nausée, maux de tête).
Difficile d’affirmer pour l’heure si cette perspective est annonciatrice d’un développement et d’une stabilisation du marché. Si le modèle économique reste à trouver, la baisse des prix des casques constitue néanmoins une première condition à la démocratisation de cet usage, qui a d’ores et déjà été adopté par de nombreux secteurs d’activité.
Quels usages pour quels effets tangibles ?
Il existe de multiples applications à la réalité virtuelle, circonscrites au domaine professionnel ou étendues au grand public. Outre le domaine vidéoludique (l’immersion dans les jeux vidéo) qui a très vite développé des contenus en réalité virtuelle, le tourisme, la formation professionnelle, la médecine, l’immobilier, l’industrie des loisirs, l’information, l’architecture, la psychologie ou encore la chirurgie font partie des secteurs qui utilisent cette technologie. Les avantages les plus évidents sont le gain de temps, les économies en ressources humaines et la possibilité de reproduire à l’envi telle ou telle situation.
L’industrie du tourisme utilise par exemple la réalité virtuelle comme produit d’appel, pour donner envie au consommateur d’acheter un séjour en visitant une destination ou un lieu de résidence, ou en tant qu’activité à sensations fortes, comme voir les aurores boréales islandaises, survoler le Tarn à bord d’une montgolfière ou faire un trek dans la jungle tropicale.
Il est également possible de vivre sa pratique sportive dans un environnement virtuel, en faisant son footing dans un décor de nature avec le chant des oiseaux en fond sonore, au lieu de se rendre dans le parc le plus proche.
Les grands fabricants que sont Oculus, HTC ou Vive multiplient en outre leurs initiatives dans le domaine de la culture et de l’éducation, en finançant des programmes visant l’introduction de casques de réalité virtuelle dans les écoles ou les musées. Mais au-delà de l’intérêt financier potentiel, quels sont les apports des contenus pédagogiques en réalité virtuelle ?
L’enthousiasme pour les nouvelles technologies appliquées au secteur éducatif est en effet régulièrement douché par les études qui rappellent l’importance d’un tuteur humain dans l’apprentissage de l’enfant. L’engagement actif de l’apprenant dépend en effet pour partie de l’interaction sociale avec l’adulte formateur, ce qui remet en question le mythe d’une nouvelle génération de digital natives multitâches, qui auraient développé leur propre méthode d’apprentissage.
Ainsi la croyance en la capacité des artefacts technologiques, par exemple les tablettes, à améliorer les performances scolaires, a-t-elle été battue en brèche. Se trouve-t-on cependant dans le même cas de figure avec la réalité virtuelle ?
Quelques pistes 4 intéressantes ont été formulées par Pascal Roulois, enseignant et chercheur en neuropédagogie. Selon lui, la réalité virtuelle permet d’incarner son apprentissage, dans la lignée des théories de l’embodiment. Ce concept issu de la psychologie cognitive a montré l’influence des expériences sensori-motrices sur notre manière de penser. Utilisée dans l’enseignement, la réalité virtuelle permettrait d’expérimenter physiquement des notions abstraites, et favoriserait l’acquisition de nouvelles compétences.
Cette idée selon laquelle la réalité virtuelle déclencherait des émotions propres à mieux faire ressentir, et donc mieux appréhender certaines situations (la guerre en Syrie, l’épidémie d’Ebola, l’enfermement carcéral…) a également convaincu certains journalistes et producteurs de créer des expériences médiatiques en réalité virtuelle 5.
Ces contenus demeurent pour le moment confidentiels, trop peu de foyers étant équipés de casques. La question des effets possibles de ces reportages sur les personnes qui les visionnent mérite toutefois d’être posée. Quelles sont les différences de perception entre un reportage classique, diffusé à la télévision ou sur internet, et un reportage en réalité virtuelle ? Entre un reportage conçu par ordinateur (Computer Generated Imagery), et tourné en 360°, c’est-à-dire entre des images construites numériquement et des captations d’images « réelles » ?
Par Emilie Ropert-Dupont et Bahman Ajang
Lire la suite consacrée aux applications thérapeutiques de la réalité virtuelle.
1 Wolton Dominique, « Penser la communication », Champs essais, 1997, p. 10.
2 Breton Philippe et Olivési Stéphane, « Utopie et imaginaire de la communication » Quaderni n°28, Hiver 1996.
3 Hype cycle, Gartner : Cycle du hype — Wikipédia
4 Réalité virtuelle et neuropédagogie : la promesse de l’aube ?
53 JOURNALISME ET RÉALITÉ VIRTUELLE - Émotion ou information ?, Émilie Ropert-Dupont - livre, ebook, epub
Partager sur :
