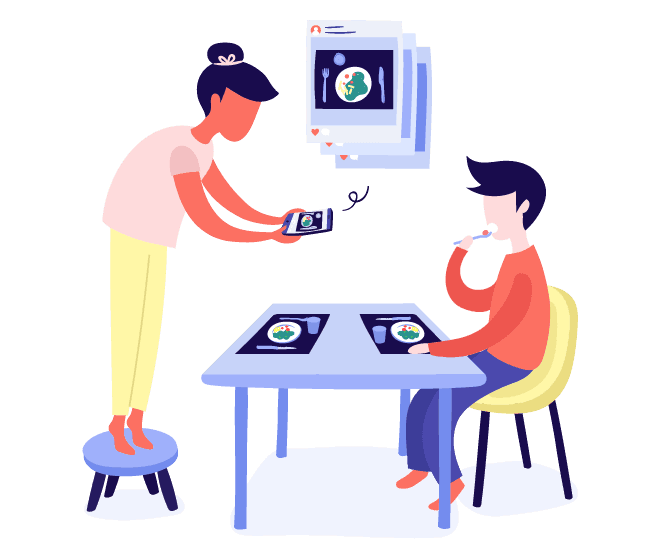Le darknet : plongée dans les profondeurs du web
Protection des données personnelles et portabilité des droits numériques sont à l’agenda des gouvernements. Des questions que le darknet, libre de toute soumission étatique, a déjà tranchées. Aujourd’hui, Isaure nous guide dans cet eldorado méconnu.
« Darknet », « Deep-web », « Tor », des expressions et mots que j’entends depuis des années et derrière lesquelles j’ai rangé des images tout droit sorties de mon imagination. Quelque chose entre Mr. Robot et la mafia Russe, une sorte de page noire recouverte de code, remplie de choses forcément illégales. Je voyais cela comme un web un peu archaïque, sans mise en page, réservé aux initiés. Je n’aurais pas été étonnée qu’il faille remplir des conditions préalables pour avoir l’autorisation de se connecter.
Un imaginaire certainement nourri par les Unes des journaux, adeptes du marronnier de cet « autre web où tout est permis ». Folle épopée de Silk Road, ex-Amazon du darknet, et de son créateur Ross William Ulbricht, histoires d’espionnages et théories du complot : voilà ce à quoi est bien souvent résumée la partie immergée d’internet.
Des bitcoins et un oignon
Lorsque j’ai demandé à mon frère, Arthur, trader formé en tant qu’ingénieur télécom, de me faire découvrir cet antre du web, il ne pouvait deviner la profondeur de mon ignorance. Il ne soupçonnait pas, lorsqu’il me dit sur un ton amusé que « je n’étais pas prête », qu’il nourrissait en réalité mes fantasmes. Ma réaction a néanmoins dû lui donner quelques indices. La veille de notre périple en terre du web profond, il m’annonça : « Par contre on va utiliser ton ordinateur, je ne veux pas compromettre le mien, avec tous les bitcoins que j’ai dessus ». Une blague, que je pris évidemment au premier degré. Car, très vite, Arthur m’explique que le darknet n’est pas dangereux, à moins de ne pas prendre de précautions. Au contraire, il serait même plus sécurisé que le web visible, celui sur lequel nous allons tous les jours.
Le jour-j, je suis décidée à affronter les images choquantes, les pages incompréhensibles, les manipulations complexes. Carnet en main, je m’apprête à tout noter, pas bien certaine néanmoins que je saisirais l’ensemble des explications. Cela fait un moment que mon frère ne s‘est pas rendu sur le darknet. Il l’a exploré à de nombreuses reprises, curieux de comprendre, sans en faire une habitude. Connaissant la vitesse d’évolution des technologies, il vérifie tout ce qu’il affirme, soucieux que je ne marque rien d’incorrect.
Avant une première connexion sur Tor (The Onion Router), mieux vaut s’assurer d’avoir les bons outils. En l’occurrence être équipé d’un VPN, m’apprend Arthur. Pas question de se connecter à Tor, le « réseau informatique mondial et superposé », sans en avoir un. Un Virtual Private Network (réseau privé virtuel) est un système qui permet de se connecter à n’importe quel réseau. En clair, on peut se connecter depuis l’Allemagne tout en étant en France. Un système indispensable pour éviter d’être tracé (car, comme me le rappelle mon frère, nos box internet enregistrent toutes nos actions sur internet).
En soit, utiliser Tor n’est pas dangereux, mais si mon FAI (fournisseur d’accès internet) détecte que je me suis connectée au darknet, il pourrait trouver ça suspicieux. Je pourrais très rapidement être fichée par l’Etat. J’aime ce que je fais, mais je n’avais pas prévu ce scénario pour l’écriture d’un article. Installons donc un VPN.
Afin de comprendre l’utilité d’un tel système pour accéder au darknet, Arthur tente de m’expliquer le fonctionnement de Tor. À l’appui, des schémas d’oignons violets. Le réseau est en effet organisé en « couches d’oignons », commence-il à m’expliquer.
Ainsi, lorsque je me connecte à un site, mon adresse IP est cryptée et doit passer à travers les « couches » ou « nœuds » de l’oignon pour y accéder. Ce sont concrètement des serveurs répartis partout dans le monde et gérés par des bénévoles, ainsi que les ordinateurs des autres utilisateurs de Tor dans le monde. Chaque couche est un relais différent, dont la seule information est la dernière couche que j’ai quittée. La dernière couche, le site, ne peut donc pas retracer l’itinéraire de mon adresse IP. En théorie, je suis donc protégée.
Mais il existe une faille dans le système. Lors de ma connexion au premier site, je ne suis pas protégée, m’explique Arthur. Tor ne peut en effet pas protéger la connexion entre mon ordinateur et la première couche de l’oignon. En revanche, un bon VPN pourrait tout sécuriser.
« La fameuse métaphore de l’iceberg »
J’ai donc mon VPN, et alors que je tente encore de visualiser concrètement comment il peut y avoir des « couches d’oignons » sur internet, Arthur commence à installer Tor Browser, le navigateur qui me permettra d’accéder aux sites du darknet. Il introduit également la naissance de ce « web parallèle ». La première version, m’indique-t-il, a été mise en ligne en 2001, par des volontaires qui caressaient des rêves de web libre et anonyme.
Car si le web primitif jouissait d’une certaine liberté, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Lorsque nous nous connectons à internet, nous avons tous une identité : une adresse IP. Sur le web conventionnel, cette identité est visible, ce qui permet aux sites de nous identifier et d’avoir accès à nos informations de navigation. En tant qu’amoureux du web libre, pour qui leur « ordinateur est une continuité de leur cerveau », cette idée est insupportable. « Que quelqu’un d’autre ait accès à mes données sur mon ordinateur ou lors de mes connexions, je le vis un peu comme un viol », affirme mon frère, très sérieux.
Enfin, nous arrivons sur Tor. Mais dès l’accueil du navigateur ouvert, mes fantasmes s’évanouissent. La page est violette, un texte clair nous explique les bonnes pratiques à adopter sur le navigateur, et nous propose un moteur de recherche pour les sites « conventionnels » dont le logo est un canard. Mais je ne sais toujours pas comment accéder à l’autre web. Car si surfer sur le net référencé en tout anonymat est accessible à tous à partir du moteur de recherche, trouver les sites du darknet est plus complexe.
Mon frère m’explique : « En fait, c’est une question de référencement. Tu peux accéder avec Tor à des sites non-référencés sur le web visible. Leurs adresses, ou url, est en « onion », avec devant, une suite de lettres et de chiffres aléatoires (par exemple, http://zqktlwi4fecvo6ri.onion). Cette adresse change régulièrement, pour ne pas laisser trop de traces, justement. Il y a d’ailleurs plus de sites qui existent en « onion » que dans le web visible, c’est la fameuse métaphore de l’iceberg ». Le web « visible » et référencé par les moteurs de recherche serait la partie visible de l’iceberg, tout le reste la partie immergée, bien plus importante.
Mais comment retrouver les sites .onion ? « Il existe des « hidden wiki » qui répertorient certains sites, et sont régulièrement mis à jour. Sinon, il y a également des moteurs de recherche qui tentent de référencer ces sites, mais ils ne peuvent pas tous les répertorier. En pratique, soit tu connais une page et tu la mets dans tes favoris, soit tu vas de lien en lien. »
Pour commencer, nous rentrons donc l’adresse d’un « hidden wiki ». Avec tous les traits d’un Wikipédia classique et bien ordonné, je suis une nouvelle fois étonnée de ne pas être dépaysée. Après des articles qui expliquent l’idéologie du darknet ou comment devenir volontaire pour développer le système, des liens sont rangés par catégories : « financial services », « commercial services », « books », « drugs », « erotica », « forum », « anonymity »… Tout semble tout à fait normal, mises à part les thématiques abordées.
Ainsi, nous parcourons des pages assez austères d’achat de fausses cartes d’identité de tous les pays, d’armes, de vente de faux billets, de drogue et de toutes sortes de choses volées et revendues. « Quand tu prends l’habitude d’aller sur ces sites, tu en viens à te demander quel est le vrai prix des objets, celui-ci, ou celui que tu retrouves en magasin ? » remarque Arthur. De mon côté, l’aspect lisse et rassurant de tous ces sites m’inquiète. Ici, le pire semble être accessible avec la même facilité que sur le portail d’un supermarché. La tentation est si facile.
Mais Arthur souhaite attirer mon attention sur d’autres potentialités du darknet, loin des clichés souvent partagés et qui ne représentent qu’une fraction des utilisations. Nous allons par exemple sur le site d’un hackeur professionnel - pas si loin finalement de mon fantasme autour de Mr. Robot - qui assure pouvoir réaliser absolument tous nos souhaits, à condition que l’argent suive.
La page, angoissante, correspond en tous points à mes idées préconçues sur le darknet : fond noir, logo tête de mort et kalachnikov. En bas, un onglet « contact » attire ma curiosité. Arthur m’explique à nouveau. Pour dialoguer avec des personnes qui souhaitent à tout prix préserver leur anonymat et leur sécurité, il faut passer par un protocole de contact anonyme, un « PGP », qui crypte les messages grâce à une clé de lecture. Cette logique, avec celle du réseau en oignon, a notamment permis l’émergence du Bitcoin et des cryptomonnaies - aujourd’hui sorties du darknet à travers une technologie baptisée « blockchain ».
Si je veux contacter ce hacker, il faudra que j’écrive mon texte, puis que j’entre sa clé personnelle avant de lui envoyer le message, qui sera chiffré. Lui seul pourra le lire avec l’autre face de la clé, dont il est l’unique détenteur. La clé est une suite de chiffres, nombres et signes aléatoires, longue d’à peu près une demi page Word. « Il faudrait dix mille milliards d’années pour craquer une clé PGP et essayer toutes les combinaisons possibles avec une attaque « brute force » », m’indique mon frère.
Les lumières du Darkweb
Sur le deepweb, tout est apparemment accessible : des publications interdites, comme Mein Kampf, ou des manuels pour fabriquer des explosifs, du poison et toutes sortes de choses qui dépassent mon imagination. Arthur me prévient : « Si tu souhaites télécharger quelque chose, fais attention à être totalement déconnectée avant d’ouvrir ton document ». Si un virus se cache quelque part, il ne pourra en effet pas se déclencher si je suis offline.
Mais contourner la censure n’est pas forcément synonyme d’activités illégales, et mon frère tient à me présenter cette autre facette du darknet : celle qui permet à des personnes du monde entier de dialoguer, même dans des pays sous censure ; celle qui offre aux lanceurs d’alerte un moyen de déposer en toute sécurité des documents de façon anonyme, par exemple sur Wikileaks ; celle, aussi, qui protège les données des journalistes et blogueurs et leur permet de faire leur travail partout dans le monde.
Nous nous retrouvons ainsi rapidement sur des plateformes qui nous expliquent comment protéger efficacement nos données. Sur le site « We fight censorship », lancé par Reporters sans frontières, des articles censurés sont publiés en toute sécurité. On y retrouve par exemple des enregistrements audios de l’affaire Bettencourt, publiés par Mediapart et interdits par la justice française. Certains journaux, comme The Guardian, The New Yorker ou The Wall Street Journal, proposent également des « secure drop », qui permettent aux journalistes et à leurs informateurs de déposer leurs articles ou des documents de manière sécurisée et anonyme.
Un peu pressé, et avant de me laisser explorer moi-même toutes les possibilités de ce réseau, Arthur clique sur un site qui rassemble toutes les statistiques de Tor (Tor Metrics). Fasciné, il le met dans mes favoris et me dit « retournes-y, pour une journaliste c’est génial » !
J’y suis donc retournée, et voilà les chiffres les plus parlants : en janvier, il existe environ huit mille serveurs-relais dans le monde, dont deux mille sont « secrets » et non-répertoriés. Environ quatre millions de personnes utilisent actuellement Tor. Quatre millions d’utilisateurs aux profils totalement différents : curieux, soucieux de l’anonymat et de la sécurité de leurs données, malfrats, journalistes, membres d’ONG, hackers, codeurs… C’est la diversité des profils et leur nombre qui garantit la sécurité du système et sa pérennité.
Loin d’avoir fini d’explorer le darknet, j’aurai appris grâce à ce périple nombre de choses utiles à mon utilisation quotidienne du web. Je connais maintenant les règles rudimentaires pour protéger mes données et ai un peu mieux compris le fonctionnement d’un outil que j’utilise pourtant tous les jours, et auquel je faisais naïvement confiance.
Par Isaure Magnien
En partenariat avec :
Cet article a été publié dans le cadre d’un partenariat avec Cafébabel. Premier média européen en ligne édité en six langues, Cafébabel est un magazine fait par et pour les jeunes qui vivent et imaginent l’Europe au quotidien.
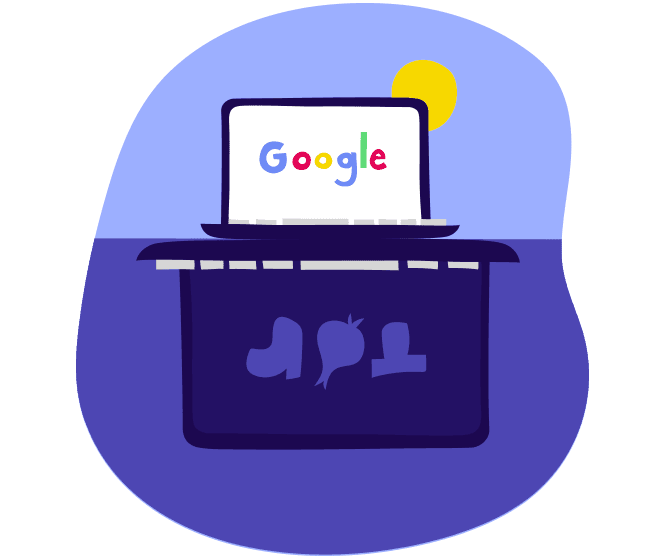
Berlin : à la recherche de gentils hackeurs russes
Au-delà des campagnes d’influence russe dans le monde, les Russes sont-ils tous de grands méchants hackers à la solde du Kremlin ? Tentative de réponse à Berlin, où une communauté de blogueurs lutte contre les stéréotypes associés au pays des Tsars.
Ce sont des jours mouvementés pour les amateurs de politique et de conflits internationaux. Ou plutôt des semaines, des mois, des années. Depuis les élections présidentielles américaines de 2016, tout se passe comme si les campagnes électorales des pays européens se déroulaient sous « influence russe ». Comme si le Kremlin était capable de jeter un sort chaque fois qu’un scrutin pointait le bout de son nez. Pays-Bas, France, Allemagne, République tchèque… toutes ces nations ont vu, au moment fort de leurs élections, un terme leur être associé : le « Russiagate ».
Un remake d’un vieux James Bond
La stratégie est désormais bien connue : dans tous les pays précités, la Russie soutiendrait les partis d’extrême-droite dans le but de déstabiliser les équilibres politiques occidentaux. Au centre du jeu : des hackers, qui s’infiltreraient dans des systèmes informatiques soi-disant inviolables ou dans des réseaux - à l’influence inégale - afin de diffuser de fausses informations. Si bien qu’à force d’en entendre parler, de plus en plus de monde finisse par se poser une question : existerait-il vraiment une domination russe incontestable en matière de piratage, au sommet de laquelle des programmateurs mal intentionnés déstabiliseraient les systèmes politiques des pays ennemis ?
Personnellement, je n’en sais rien. Mais, comme beaucoup, cela m’intrigue et j’ai donc rencontré des personnes susceptibles d’en savoir davantage. C’est à Berlin que j’ai décidé de me rendre, là où vit et travaille une importante communauté russe, et là où la menace d’une « influence russe » semble plus prégnante qu’ailleurs.
Avant de sortir de chez moi, je dévoile ma mission journalistique à ma colocataire - une Suissesse à moitié russe et 100% perplexe - qui me laisse entendre qu’en gros, je n’en saurai jamais rien. Je l’observe alors en train de travailler sur son lit avec son ordinateur portable sur les genoux. L’espace d’une seconde, un frisson me parcourt le corps et une pensée me gagne : « Serait-elle elle-même une hackeuse ? ».
Malgré ces premiers doutes, j’essaye avec bienveillance d’obtenir quelques informations qui pourraient m’être utiles. Problème, j’obtiens toujours la même réponse. Ma colocataire me rétorque que le sujet est trop compliqué et qu’avec les Russes, peu importe ce que l’on écrit, on finira toujours par prendre parti : soit pour eux, soit contre eux.
Le contexte international ne m’aide pas. Depuis quelques jours, l’actualité est plongée dans une improbable affaire d’empoisonnement, qui passe pour un remake d’un vieux James Bond. Un ancien membre des services secrets russes, Sergeï Skripal, a été retrouvé inconscient avec sa fille dans une ville du sud du Royaume-Uni. Les autorités ont retrouvé des traces de gaz neurotoxique, un poison donc, qui aurait été utilisé pour tenter de tuer l’ancien espion.
Depuis, c’est évidemment l’escalade sur la scène diplomatique. Theresa May parle de sanctions, la Russie menace de représailles. Et dans l’esprit d’un tas de gens germe encore l’image du grand méchant russe, venu faire un mauvais tour à Mr. Bond. Pas dans celui du tous, cela dit. Avec sa demi-âme russe, ma colocataire semble moins émue que les autres : « En choisissant cette profession et en agissant comme un agent double, c’était inévitable », conclut-elle. Un raisonnement simple, linéaire et froid.
Bons baisers de Berlin
Mon premier rendez-vous est fixé avec la blogueuse fondatrice de Berlinograd, un blog qui s’est donné pour objectif de présenter la communauté russe et artistique de la capitale allemande.
Je suis désormais assis dans un café du quartier paisible de Prenzlauerberg, situé au nord de Berlin. J’attends Bea, mon interlocutrice censée chasser mes doutes sur les fameux Russiagates. La demi-heure passée, je suis assailli par l’angoisse de faire chou blanc. Bea Grundheber est une blogueuse spécialisée dans la communauté artistique russe berlinoise. Avec ce nom de famille salutaire – contraction de « Grund » (le motif) et de « Hervorheben » (la raison) – je me raccroche mentalement à l’idée qu’elle ne peut être que la bonne personne. Pourtant, en soufflant sur son cappuccino, Bea fait directement tomber mon château de cartes.
« Le monde numérique, et plus particulièrement celui des hackers, je ne m’en occupe pas, dit-elle calmement. Ça ne m’intéresse pas. » La blogueuse m’explique qu’elle se passionne plutôt pour « les gens et ce qu’ils ont à offrir ». Elle est née à Trêves, une ville d’origine romaine, historiquement et géographiquement bien éloignée de la terre des Tsars. Pourtant, dès son plus jeune âge, Bea me raconte qu’elle a grandi entourée de personnes russes et arabes.
Cette enfance l’a vite conduite en Russie. Dans le Saint-Pétersbourg du début des années 2000, elle me décrit une population passionnée par l’Occident, attirée par ses vêtements, sa musique et son mode de vie. En gros, la Russie selon elle était clairement séduite par ses voisins européens.
En arrivant à Berlin, elle était déjà au courant de la grande activité culturelle de la capitale allemande, historiquement connue pour son mélange de cultures entre l’Europe de l’Ouest et celle de l’Est. Une richesse appréciée par la communauté russe qui y vit. Elle avait hâte de rencontrer les artistes de ce monde qui lui était si cher. D’entrée, elle s’y sent bien et nous décrit une communauté très ouverte, capable d’accueillir sans réserve des personnes de tout genre et tout type d’orientation.
« Quand j’entendais quelqu’un parler russe dans la rue, même au téléphone, je me précipitais pour aller à sa rencontre », raconte-t-elle. L’histoire de Bea est indubitablement liée à une ambition : raconter l’influence culturelle russe sur la ville et, par ceci, lutter contre les clichés associés au pays des Tsars. « Ce qui m’intéresse, c’est de savoir comment la personne en face de moi contribue à rendre Berlin plus belle », explique-t-elle. Si sur son blog, les belles rencontres se multiplient, la blogueuse n’est pas dupe. Elle sent que le climat se dégrade autour de la communauté russe, accusée de tous les maux.
Son regard est plus fuyant. Elle ne sait pas ni pourquoi, ni comment toute cette méfiance est apparue. Difficile d’enlever à Béa les bons souvenirs qu’elle a ramené de son pays voisin. Pour elle, il est tout bonnement impossible d’imaginer une horde de Russes passant leur temps à essayer de voler nos données personnelles et à hacker les systèmes informatiques des gouvernements. Le sujet est sensible et peut-être trop éloigné de l’esprit bienveillant de Bea pour obtenir ce que je cherche.
« Les médias allemands ont un avis très partial sur les Russes »
C’est à présent au tour d’Anton Himmelspach, collaborateur du journal en ligne дekoder o dekoder, de m’aider à décoder la Russie, de m’éclairer. Anton me raconte que l’aventure de Dekoder, qui a vu le jour en 2015, « est née d’un besoin de raconter une Russie différente de celle montrée par les médias allemands, avec leurs avis souvent très partiaux ».
La tâche qu’ils se sont proposé d’accomplir n’est pas aisée, face au risque de retomber dans ce manichéisme pro/anti Russie. Pour éviter l’écueil, les fondateurs ont décidé de servir de porte-voix aux initiatives indépendantes qui ont beaucoup de difficultés à émerger. Avec le peu de temps à ma disposition et la friture de la ligne téléphonique, je tente de lui demander si les hackers font l’objet de chroniques tout comme dans le monde occidental, mais la réponse est clairement négative : « Cela arrive, mais pas souvent ».
Anton ne pose aucun mystère sur le manque d’objectivité des médias russes. Le journaliste me fait remarquer que, selon les classements sur la liberté d’information, la Russie occupe le 148ème rang sur les 180 pays examinés. Mais il affirme aussi que c’est justement grâce au monde numérique qu’émergent des voix dissidentes.
Lorsque je lui demande ce qu’il sait précisément à propos des hackers russes, question d’une certaine manière paradoxale, il me répond qu’il est vrai que la Russie est une pépinière de personnes habiles avec des ordinateurs. Il m’explique aussi que même dans l’informatique, les salaires russes sont relativement bas et qu’au bout du compte, les meilleurs tendent donc à émigrer vers l’ouest, à la recherche d’un meilleur cadre de vie.
« C’est comme ça depuis les années 90 », déclare-t-il. Il me confie connaître personnellement deux ou trois programmeurs munis d’un passeport russe et m’indique qu’ils n’ont rien à voir avec les fanatiques dépeints par certains médias.
La propagande russe existe et fonctionne vraisemblablement. Après tout, Vladimir Poutine choisit encore les journalistes des grands médias, leur apporte son soutien quand tout va bien et les écarte d’un claquement de doigt quand cela tourne mal. C’est grâce à ce système archaïque que l’actuel président devrait être réélu sans difficulté à l’issue des prochaines élections présidentielles, dont le premier tour aura lieu le 18 mars prochain.
En revanche, imaginer une armée de hackers russes à sa botte, codant dans les sous-sols du Kremlin des programmes pour diriger le monde semble un peu farfelu. En tous les cas, Anton qui travaille aussi depuis des années sur sa thèse intitulée « Dispositif de légitimation du Poutinisme » n’y croit pas. Quant à Bea, elle pense que cette idée est véhiculée par de vieux fantasmes.
Lorsque je rentre chez moi – tête basse - je donne raison à ma colocataire. Je ne serai finalement pas vraiment parvenu à répondre à ma question initiale. J’ai fait chou blanc. Le sujet est extrêmement complexe et tenter de le résoudre s’avère être une équation à plusieurs inconnues. Mais j’ai au moins appris une chose : je ne regarderai plus jamais un James Bond de la même façon.
Par Jacopo Dionisi.
En partenariat avec :
Cet article a été publié dans le cadre d’un partenariat avec Cafébabel. Premier média européen en ligne édité en six langues, Cafébabel est un magazine fait par et pour les jeunes qui vivent et imaginent l’Europe au quotidien.
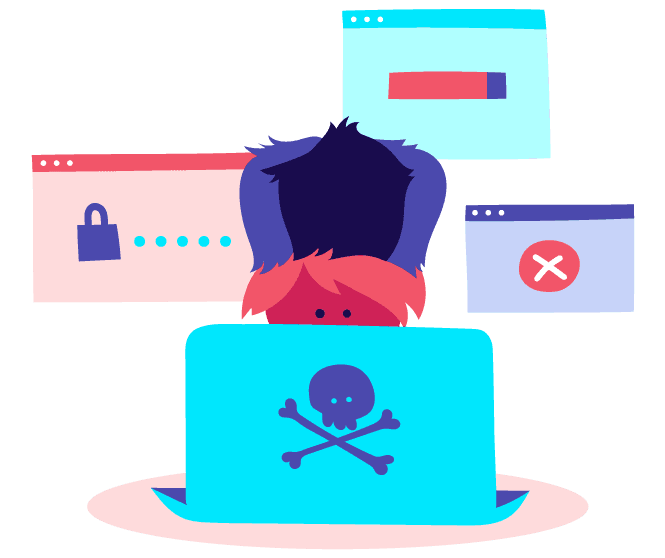
Supprimer Facebook : alors, facile ?
Données volées, usurpation d’identité, publicités ciblées… Notre présence numérique peut échapper à notre contrôle. Pour y faire face, certains décident de réduire drastiquement leur présence sur Internet. Rencontre avec deux journalistes “déconnectés”.
Je traverse Berlin dans un S-bahn à moitié vide, lorsque je sens soudainement mon téléphone vibrer dans ma poche. Je découvre alors un message Facebook de Malika, une journaliste de 24 ans originaire de Bichkek, au Kirghizistan que je ne connaissais pas encore. Elle vient tout juste de répondre à un post que j’avais publié sur mon mur, pour savoir si mes « amis » connaissaient des gens qui s’étaient volontairement retirés du web. Imaginez mon soulagement à la lecture de la réponse de Malika, alors que je réalisais que j’étais l’une de ses dernières interactions sur Facebook.
Malika n’est pas la première et ne sera certainement pas la dernière à quitter l’Internet. L’ensemble du monde digital a remis les pieds sur Terre lorsque le scandale Cambridge Analytica a éclaté. On apprenait alors que les données de 87 millions de comptes Facebook auraient été siphonnées, à l’insu même du réseau social. Comme un contre-feu, le hashtag #DeleteFacebook (Supprimer Facebook, ndlr) est devenu l’une des nouvelles tendances de la Toile.
Mais certaines personnes, aux quatre coins du globe, n’ont pas attendu la vague d’indignation pour s’intéresser à la protection des données personnelles en ligne. J’ai donc décidé que le moment était venu de me renseigner sur la difficulté (ou pas) de s’effacer d’Internet. D’autant plus que quatre des apps IOS les plus téléchargées en 2017 sont toutes liées à Facebook. Et ce n’est que la partie émergée de l’iceberg.
Twitter, publicités ciblées et trahisons
Journaliste, Malika a commencé à se soucier l’année dernière de sa présence en ligne. Lorsqu’elle s’est intéressée à la question de la surveillance sur Internet et à l’utilisation des données personnelles, la jeune Kirghize a décidé de supprimer son compte Twitter.
En tant que reporter, elle surfait sous le pseudonyme @darklordwannabe pour, chaque jour, scanner l’actu, rester en contact avec différentes organisations et trouver de potentielles sources pour ses articles. Sa décision, la jeune reporter l’a prise après un changement soudain de l’algorithme de Twitter qui a modifié le fil d’actualité des utilisateurs : « [Du jour au lendemain], mon fil d’actu s’est transformé en une sélection aléatoire des re-tweets les plus populaires mélangés à une panoplie de pubs », se souvient-elle.
Désireuse de comprendre ce qui se passait derrière le calcul mathématique, Malika s’est intéressée aux paramètres de son compte et a demandé un compte-rendu détaillé de ses données Twitter, avec une liste des annonceurs publicitaires qui la ciblaient. Elle a attentivement étudié les informations reçues de façon à comprendre où elle se situait en matière de mesure d’audience.
Twitter autorise les annonceurs publicitaires à lancer des campagnes ciblées pour créer des « campagnes marketing très pertinentes » destinées à un public défini : des listes d’utilisateurs spécifiques, de personnes qui ont récemment visité leurs sites internet, ou des groupes qui ont eu recours à une certaine application. Malika fût frappée par sa découverte. « Il s’avère que plus de la moitié du contenu Twitter proposé n’était pas du tout pertinent pour moi. Déboussolée, je me suis dit : ‘Ok, vous faites du profit sur mes données personnelles et traquez mon comportement sur Internet pour me vendre tous ces trucs, mais vous n’avez toujours pas idée de ce dont j’ai réellement besoin’ » Ce jour-là, elle a supprimé son compte.
Puis Instagram est arrivé. Comme avec Twitter, Malika a décidé qu’elle ne se laisserait plus importuner par les pubs intempestives et les contenus inutiles. C’était trois mois et demi plus tôt. Elle est alors devenue experte en suppression de ses traces sur Internet, en lisant un paquet d’articles sur le sujet.
Malika m’explique que c’est un vrai parcours du combattant pour supprimer son compte Instagram : « D’abord, tu dois supprimer tout le contenu que tu avais posté. Ensuite, tu dois changer l’adresse email liée à ton compte en utilisant une autre spécialement créée pour l’occasion. Ça va te permettre de boycotter les mails généraux ou les notifications [des réseaux sociaux]. Même chose pour ton numéro de téléphone portable. Ce n’est seulement qu’après avoir fait tout ça que tu peux véritablement supprimer ton compte ».
La disparition soudaine de Malika de Twitter et Instagram n’est pas passée inaperçue. Certains de ses amis croyaient qu’elle les avait bloqués sur ces sites, et lui demandaient pourquoi : « J’ai dû expliquer que j’avais tout simplement supprimé mon compte, mais aucunement bloqué ni arrêté de suivre qui que ce soit, raconte Malika. Certaines personnes ont approuvé ma décision, d’autres l’ont trouvée étrange ou inutile. Mais dans l’ensemble, la réaction des gens était plutôt positive ». En premier lieu ? Ses parents qui « ont toujours été en faveur d’un style de vie sain, en m’encourageant à passer moins de temps sur les écrans ».
Quand je lui demande si sa vie professionnelle a été affectée par sa décision, elle réfléchit quelques secondes : « Pas tant que ça », répond-t-elle, en secouant la tête. Difficile à imaginer quand on est journaliste web. Mais j’ai quand même envie de croire Malika.
Actuellement en dernière année de Master, elle envisage d’ailleurs de changer de voie. « J’espère vraiment travailler davantage avec la collecte et l’analyse de données. Je n’aurai pas besoin d’être en contact avec qui que ce soit, et je serai en mesure de réduire mon utilisation de différentes plateformes en ligne », explique-elle.
Au final, la jeune journaliste affirme être contente de sa décision. Elle est devenue « plus sensible » à la façon dont elle occupe son temps ainsi qu’à sa manière d’interagir avec les gens.
Bye-bye, Zuckie !
Nous arrivons à la question à deux milliards d’utilisateurs : qu’en est-il de Facebook ? Est-ce le seul réseau social que Malika a continué d’utiliser, malgré son intention d’effacer sa présence sur le web ? Compte tenu du scandale Cambridge Analytica, et du fait que le réseau ait été accusé de surveillance de masse via ses applications, je m’attendais à ce que la jeune Kirghize ait choisi de dire bye bye à Zuckie (Mark Zuckerberg, ndlr).
Pourtant, je trouve en face de moi une personne incrédule, qui répond avec calme et nonchalance : « Je n’ai pas été surprise. La question des données personnelles sur Internet se démocratise de plus en plus et il est désormais aisé de savoir comment les grandes entreprises peuvent en tirer profit ».
Même si le PDG de Facebook prétend que la campagne #DeleteFacebook n’a pas eu d’effet significatif sur sa société, la grande couverture médiatique qui s’en est suivi semble avoir impacté nombre d’utilisateurs, tout du moins aux États-Unis. D’après une étude menée par Creative Strategies, 9% des Américains auraient supprimé leurs comptes pour des questions de respect de la vie privée.
Alors que nous poursuivons notre conversation Skype - que Malika a dû réinstaller pour notre interview -, plusieurs notifications Gmail me distraient. Je m’excuse et les ignore, même si je sais pourquoi ma boîte de réception est bombardée. Le nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) vient d’entrer en vigueur dans l’Union européenne.
Les organisations, les organes de presse, les sociétés et toutes les autres structures opérant au sein de l’Espace Économique Européen doivent l’appliquer, et l’exportation de données personnelles hors UE est aussi concernée. Des organisations m’informent de la manière dont mes données vont être collectées et traitées, et/ou me demandent d’accepter qu’elle soient utilisées de telle ou telle manière, des modalités qui ne sont qu’une goutte d’eau dans un océan de conditions générales.
Toujours d’après le site officiel de l’UE, le RGPD est défini comme « le changement le plus important de ces 20 dernières années en matière de réglementation des données confidentielles ». Quatre ans ont été nécessaires à son élaboration. Après les débats, il a été approuvé le 14 avril 2016, pour être finalement appliqué le 25 mai de cette année.
En voyant ma réaction, Malika propose une solution alternative à Gmail. Cela fait un bon moment qu’elle est passée d’un service de messagerie ordinaire à un système plus sécurisé muni d’un cryptage de bout en bout appelé ProtonMail. Elle adopte ce même principe pour ses recherches sur le web. Au lieu d’utiliser Google, elle opte pour DuckDuckGo, un moteur de recherche censé protéger la vie privée de ses utilisateurs.
Malika a également choisi de faire un saut du « côté obscur » de la communication anonyme, et utilise Tor (le routage en oignon) un réseau qui cache l’activité de ses utilisateurs en déplaçant le trafic sur différents serveurs. Ces serveurs sont appelés « réseaux superposés de volontaires » et se composent de plus de 7000 relais, dissimulant l’emplacement et toute activité d’un utilisateur donné. Comme un oignon, il faudrait éplucher des milliers de couches pour en trouver la source.
Si l’objectif de Malika de réduire sa présence sur Internet est en bonne voie, Tom – un journaliste américain âgé de 26 ans – a choisi une approche plus radicale. Il a officiellement supprimé ses traces de tous les réseaux qu’il utilisait autrefois, en l’occurrence Twitter, Instagram, Facebook et LinkedIn. J’ai contacté Tom à l’ancienne, grâce à une amie qui a répondu au fameux post que j’ai publié sur mon mur Facebook avant de me donner son adresse mail. Après avoir longuement communiqué, je lui ai à tout hasard proposé de faire une interview sur Skype, Tom m’a répondu qu’il préférait échanger par mail.
Depuis 2016, Tom a progressivement commencé à supprimer ses comptes sur les réseaux sociaux. Journaliste lui aussi, il les utilisait au quotidien pour son travail. Comme Malika, il contactait des sources potentielles, ou des personnes à interviewer en utilisant Twitter, Facebook ou LinkedIn. Mais contrairement à sa consoeur kirghize, la motivation derrière sa décision est simple : Tom voulait être une personne plus productive et plus saine. « J’avais l’impression de passer trop de temps sur ces réseaux et de ne pas évoluer en tant qu’être humain. Je pensais que ça me réussirait mieux de lire des livres, de faire de l’exercice à l’extérieur, d’avoir de vraies conversations avec d’autres personnes et d’aiguiser mes talents de cuisinier », explique-t-il en insistant sur sa passion pour les recettes végétariennes.
Pendant que je lis les arguments de Tom en faveur d’une vie libérée des réseaux sociaux, je pense à Tristan Harris, ancien responsable de Google Design Ethicist devenu responsable du mouvement Time Well Spent, et à sa théorie selon laquelle la technologie moderne pirate notre esprit.
Harris a comparé nos téléphones portables à des « machines à sous » que l’on contrôle constamment pour voir si l’on a obtenu de nouveaux likes, davantage de followers, ou une autre récompense. Tout ceci nous encourage à rester en ligne aussi longtemps que possible et phagocyte notre attention. Aussi simple que cela puisse paraître, à long terme, une telle dépendance pourrait avoir un effet dramatique sur notre santé mentale, nos relations sociales et notre bien-être en général.
Il a fallu près d’un an à Tom pour supprimer peu à peu sa présence sur la Toile, et contrairement à Malika, sa famille et ses amis ont réagi moins favorablement. Ils étaient un peu consternés, « mais ils ont compris ma décision une fois que je leur ai expliqué », se souvient-il.
Comme Avatar en noir et blanc
Conserver un réseau professionnel sans être présent sur Internet est le plus grand challenge de Tom. Il en va de même pour trouver un nouveau travail : « Les employeurs apprécient quand les candidats ont leurs propres sites internet, des comptes actifs sur les réseaux sociaux et une [forte] présence sur internet qui démontre leurs compétences, explique leurs objectifs professionnels et facilite le contact ».
Tom explique qu’il a tout de même été parcouru d’une seule hésitation, vis-à-vis de la suppression de son compte Facebook, et ce pour des raisons sans rapport avec le travail. Comme beaucoup d’entre nous, il utilisait Facebook pour rester en contact avec des amis éloignés. Mais quand on veut on peut. Tom a réussi à résoudre le problème en exhortant ses amis à rester en contact avec lui par mails, et jusqu’à présent, cela a parfaitement fonctionné.
Lorsque nous évoquons Facebook et LinkedIn, Tom souligne le caractère consumériste des deux plateformes dont les caractéristiques et la conception nous incitent à y passer un maximum de temps. Qui plus est, supprimer un compte n’est pas toujours chose facile : l’option est souvent enfouie dans les profondeurs de l’application, prise en sandwich entre les petits caractères et la FAQ.
« Ces plateformes sont spécialement conçues par de très brillants ingénieurs dans l’optique de capter l’attention et de la garder, coûte que coûte. On parle alors de ‘récompense variable’. Fondamentalement, c’est lorsque les notifications aléatoires obligent une personne à continuer à vérifier son compte dans l’espoir d’y trouver une nouvelle activité », explique Tom.
Partie intégrante du « Hook model » (modèle d’accroche, ndlr), les récompenses variables font partie d’un cycle qui rend les utilisateurs dépendants. Beaucoup de réseaux sociaux utilisent le hook model pour créer une habitude, une routine quotidienne avec leurs utilisateurs, en les poussant dans un cycle infernal : déclencheur, action, récompense variable et utilisation continue.
Je demande à Tom s’il utilise un téléphone portable, et lorsqu’il acquiesce, il m’envoie une capture d’écran de l’écran de son Iphone. Il possède trois icônes sur son écran d’accueil : les contacts, les appels et les messages. « J’utilise mon portable pour les SMS et passer des appels, confirme-t-il. Je prends parfois des photos. C’est tout. J’ai aussi personnalisé la colorimétrie de mon écran en gris pour réduire son caractère addictif. »
Par curiosité, je suis allée dans le menu réglages de mon Iphone et j’ai changé la couleur de l’écran. Ce qui est habituellement un monde débordant de couleurs, de notifications et de connectivité devient vite terne, c’est comme regarder Avatar en noir et blanc. Et je ne vous parle même pas d’Instagram.
Récemment, j’ai rencontré une amie qui m’a confié avoir trouvé l’amour de sa vie sur Internet. Tout de suite, une question m’est venue à l’esprit : qu’en est-il des applications de rencontres ? Je la pose à Tom en lui demandant quel impact avait la suppression de sa présence en ligne sur cet aspect de sa vie.
« Je connais beaucoup de gens de mon âge qui utilisent les réseaux sociaux (comme Tinder ou Bumble) pour des rencards mais aussi pour draguer. Je sais que je me limite un peu en n’y participant pas. Mais j’aspire à une histoire plus originale pour mes relations amoureuses. Utiliser Internet pour trouver l’amour a un côté un peu désespérant, trop lisse, et c’est chiant. Je souhaite quelque chose de beaucoup plus spontané ».
Je termine de lire les mails de Tom. Il me parle du livre qu’il a lu et partage sa récente expérience : il a cuisiné un shakshuka, une recette qu’il a volontiers jointe à son dernier mail. Je l’ai ouverte et y ai trouvé des photos colorées avec des descriptions pittoresques du plat. Je me suis mise à penser au banana cake que j’ai toujours voulu faire, sans jamais trouver le temps pour m’y consacrer. J’étais probablement trop occupée par le travail. Je passais peut-être trop de temps sur Internet.
Par Varvara Morozova.
En partenariat avec :
Cet article a été publié dans le cadre d’un partenariat avec Cafébabel. Premier média européen en ligne édité en six langues, Cafébabel est un magazine fait par et pour les jeunes qui vivent et imaginent l’Europe au quotidien.

Instagram : l’appli qui a changé nos vies
En deux ans, l’application a infiltré tous les réseaux de nos sociétés modernes : nos vies, nos boulots, nos assiettes, nos soirées. Alors que ses membres fondateurs viennent de raccrocher, j’ai tenté de savoir comment Instagram nous avait rendus dingues.
Je ne connais Nina ni d’Eve ni d’Adam. Nos échanges se sont résumés à deux emails. Et pourtant, avant de prendre le combiné du téléphone, j’ai la sensation d’être rentré dans sa vie par effraction.
Je sais qu’elle aime les plats sans gluten et les légumes moches. Là, je peux vous dire quelle tenue elle porte et qu’en ce moment, elle a super mal au dos. À tel point que cela l’empêche de dormir. Alors, pour passer le temps, elle se venge sur les derniers morceaux de Disiz la Peste.
Vivre l’Insta présent
Nina est un pur produit de son époque. Celle qui porte 400 millions d’individus à travers le monde à téléverser leur vie quotidienne sur les Stories d’Instagram. Lancées en août 2016, ces petites tranches de vie virtuelles d’une espérance de 24h séduisent de plus en plus les usagers du réseau social. En règle générale, les gens en postent entre 5 et 10 par semaine. Nina, elle, en laisse près d’une vingtaine par jour.
Alors que je déroule le fil interminable de ses photos carrées, la jeune femme m’explique au bout du fil « qu’elle ne partage pas toute sa vie non plus ». « Par exemple, ce matin j’ai renversé mon café et j’ai failli bousiller mon ordi, bon ben je ne l’ai pas montré. Il y a des choses de ma vie de tous les jours que je ne partage pas, même si les gens sont persuadés de tout savoir de mes journées », resitue-t-elle.
C’est un peu le cas de tout le monde : on voit rarement des gens se couper les ongles ou faire la vaisselle sur Instagram. Connu pour sa superficialité, facteur d’anxiété et de malaise, le réseau social a même été désigné comme le pire réseau social pour la santé mentale des jeunes d’après un sondage.
En préparant cet article, j’ai demandé à des gens le premier mot qui leur venait à l’esprit en pensant à l’application. Réponses ? « Fake », « Paraître », « Show-off », « Maquillage »…
Et pourtant, Insta est à la mode. Des grands médias sociaux, c’est même celui qui aura convaincu le plus de nouveaux adeptes. Depuis cet été, l’application réunit un milliard d’utilisateurs actifs. En France, ils sont 11,8 millions à l’avoir adoptée. Un chiffre qui a presque doublé en moins de deux ans. Instagram aurait même ringardisé Facebook, qui l’avait pourtant racheté pour près d’un milliard de dollars en 2012. « Aujourd’hui, toute une génération est sur Instagram, reconnaît Leila Lévêque, responsable web influence d’une agence de webmarketing à Paris. On sent que quelque chose s’est très vite déplacé. »
Il suffit de regarder encore une fois les chiffres : entre juin 2017 et juin 2018, 70% des jeunes Américains ont supprimé Facebook de leur téléphone. Et au même moment, Instagram et Snapchat se disputaient la place de réseau social préféré des ados. Mais pourquoi ? Si je pose des questions à cette « génération Instagram », c’est que je constate comme vous que l’appli a envahi notre quotidien : au travail, au resto, dans la rue, dans notre lit. Cela dit, loin de la neutralité qu’inspire WhatsApp, Instagram divise. Jusqu’à la schizophrénie, tant les usages du réseau social contrastent avec ce qu’on en dit.
Touche pas à mon post
Nina a posté sa première photo en mars 2015. Un selfie, parce que c’était tendance et qu’elle aimait sans doute bien son look en partant à la fac. Mais de son propre aveu, « elle a tout de suite adoré le principe. Les hashtags, les filtres, l’ouverture internationale… ». La jeune femme cuisine un peu à la maison. Et quand elle prend une salade composée en photo, elle trouve ça beau, alors elle poste. « Je me sentais comme une artiste qui s’amuse à associer des photos avec des citations d’auteurs que j’aimais bien, raconte-t-elle. Et en plus je pouvais parler avec des gens qui avaient les mêmes passions que les miennes. »
Au fur et à mesure des posts, Nina devient Callmevoyou - l’affirmation de son côté rap - et trouve le slogan de son compte « Good mood & food ». « Ça fait bisounours mais franchement l’esprit c’était ça, je partageais ce que j’aimais. » Paradoxal, parce que l’étudiante en journalisme n’est pas vraiment du genre à se montrer. De naturel, elle se dit « timide et réservée ».
Sur Insta, il suffit de toucher deux stories pour s’apercevoir que Nina gère son image comme une star de cinéma. « Dans ta communauté, tu as l’impression de t’adresser à des gens qui te veulent du bien. Du coup, tu n’as jamais besoin de te justifier, tu te sens libre de dire et de poster ce que tu veux », explique l’intéressée.
#nofilter, c’est aussi comme ça que l’application a popularisé un mode d’expression direct, épuré, sans filtre donc. Loin du fourre-tout de Facebook et du ligaturage de tweets en 180 signes. Dans la lorgnette du futur numérique, d’aucuns avaient prédit le succès du réseau. En 2015 déjà, le monde 2.0 parlait d’une porosité totale avec une époque obsédée par l’image, l’instantanéité et son smartphone.
Trois ans après, il semblerait que la prophétie continue de se réaliser, quitte à poser une grande question métaphysique : Instagram aurait-il changé la manière dont nous voyons le monde ? Ce qui est sûr pour Nina, c’est que ce qui paraissait « complètement creepy » il y a deux ans est désormais pleinement intégré.
« Avant quand je mangeais avec quelqu’un au restaurant, je faisais ma mise en place pour une photo (sic) et quand je la prenais, il y avait toujours ce moment extrêmement gênant où je devais me justifier en disant : “Ouais, je sais, c’est pour mon compte Insta en fait”. Maintenant, la personne en face de moi le fait aussi et on ne s’en rend même plus compte. »
Les Instagrameurs que j’ai interviewés appellent ça des « moments Instagram », compris comme ces instants suspendus où une personne ferait corps avec son téléphone, comme un intense sur-moi virtuel.
« Ils sont quand même très forts, reconnaît Fabien. En tant qu’utilisateur, on se dit toujours qu’on va se lasser. Mais ils innovent, intelligemment, progressivement et proposent sans cesse de nouvelles fonctionnalités qui font mouche. » Hyperlapse, Layout, Boomerang, Stories, IGTV… des nouveautés qui ont fait le succès d’Instagram autant qu’elles ont confisqué l’attention des internautes.
En 2017, les utilisateurs de moins de 25 ans passaient en moyenne 32 minutes par jour sur l’application.
(Mise en exergue) « Aujourd’hui, les gens ont conscience que ce qu’ils voient est un peu fake. Du coup, il y a un plaisir un peu masochiste à utiliser Instagram. »
Photographe indépendant, Fabien Voileau - 33 ans - a utilisé Instagram « quand c’est sorti », en 2011. En chattant sur Messenger, il m’explique qu’à l’origine, il suivait des photographes, des marques et des gens inspirants. Puis il commence à poster ses photos en 35mm et son compte décolle tranquillement. Aujourd’hui, Fabien a plus de 65 000 abonnés.
Louis, même pas 20 ans, a commencé à s’intéresser aux réseaux sociaux il y a trois ans. S’il préfère YouTube pour s’exprimer, le jeune étudiant regarde Instagram comme un bon moyen de partager ses tenues. Mais scroller le feed de Louis Cznv, c’est surtout faire face au même visage pris de 1001 façons à 1001 moments différents.
« Je ne fais pas vraiment attention à ce que je fais, me répond-t-il par email via son agence d’influence. Ça paraît futile mais c’est quelque chose que j’aime beaucoup. » Et que les gens aiment beaucoup suivre aussi puisque l’Instagrameur peut aujourd’hui compter sur 26 000 abonnés.
Avec ses cakes sans gluten et ses belles assiettes de saison, Nina a elle aussi réussi à embarquer des milliers d’internautes. À l’heure actuelle, ils sont 17 000 à commenter ses posts et à lui envoyer des smileys. Quand je lui demande ce qu’elle fait de particulier pour accroître sa communauté, elle me répond qu’elle ne fait rien de spécial. Même chose pour Louis. Même chose pour Fabien.
Difficile à croire dans un réseau où chacun semble y aller de son post with a view pendant la golden hour ou de sa vingtaine de hashtags qui vont bien. « Mes amis me demandent souvent comment on fait, rigole Leila Lévêque. Ils pensent que parce que je bosse dans la web influence, je connais la recette magique. La vérité, c’est que beaucoup d’Instagrameurs ont du talent et c’est pour ça que les gens les suivent. »
Au téléphone, Nina n’osera jamais m’avouer qu’elle est talentueuse. Mais elle reconnaît tout de même qu’il existe une recherche de reconnaissance. « Dans la mesure où tu places une création perso sur Internet, c’est qu’à l’origine tu penses que ça mérite d’être vu. Tu as une certaine confiance en toi qui peut donc s’apparenter à du narcissisme. » Faut-il lui jeter la pierre ?
Sur le réseau social de l’apparence, tout le monde semble avoir accepté une règle : se montrer sous son meilleur jour fait partie du jeu. Dit autrement, Instagram est une vaste mise en scène 2.0 avec ses codes qui standardisent les contenus et couvrent l’application d’un autre reproche : la tyrannie du cool.
« C’est assez connu mais je pense qu’on a dépassé le moment où l’on pensait naïvement qu’il existait une vie parfaite, nuance toutefois Leila Lévêque. Aujourd’hui, les gens ont conscience que ce qu’ils voient est un peu fake. Du coup, il y a un plaisir un peu masochiste à utiliser Instagram. »
Un réseau sous influence
Un autre type d’acteurs a lui aussi décidé de se flageller sur l’appli. En l’espace de cinq ans, 90% des marques ont augmenté leur budget de promotion sur Instagram. « Ça a commencé à exploser en France en 2017, explique Leila Lévêque. Quand elles se sont rendu compte du pouvoir des influenceurs. »
Les influenceurs ? Des personnalités, connues ou pas, capables de changer le comportement d’achat des abonnés avec un post ou une story sur leur compte. Intox ? Pas du tout selon Leila Lévêque.
La responsable en web influence a conduit une étude l’an dernier pour l’Argus de la Presse/Cision sur le rôle des influenceurs auprès des consommateurs et les chiffres sont clairs : 75% des internautes ont déjà acheté un produit après avoir vu ou lu des contenus publiés par un influenceur.
« Quand on sait que 80% des gens sur Instagram suivent des marques, le potentiel est énorme, soutient-elle. On ne va pas tarder à voir les entreprises miser beaucoup d’argent dans la web influence. » En vérité, cela a déjà commencé. Des sociétés sont déjà prêtes à aligner beaucoup de zéros pour se procurer les services d’un influenceur.
Les recherches d’une start-up américaine indiquent que ce genre de prestations peut s’envoler jusqu’à 75 000 dollars pour un post tandis que d’autres estiment déjà le marché de l’influence à 10 milliards de dollars en 2020.
Avec leurs dizaines de milliers d’abonnés, Nina, Louis et Fabien ont tous déjà travaillé avec des marques. Avec plus ou moins de succès et plus ou moins d’envie. Pour nos trois Instagrameurs, l’intérêt reste financier et ne sert qu’à arrondir les fins de mois. Mais aucun ne revendique le titre d’influenceur. Fabien : « C’est un job. Et je ne réponds pas à ce genre de requête ou mission. C’est une manière de communiquer qui n’est pas la mienne ». Nina : « Je n’aime pas dire que je suis influenceuse. C’est péjoratif. Pour moi, c’est un panneau publicitaire, moins cher qu’un panneau publicitaire. »
D’une manière générale, très peu d’Instagrameurs - même avec un gros volume d’abonnés - revendiquent le terme. Trop connoté, trop cliché, trop superficiel. « Les influenceurs, c’est un peu les nouvelles stars de la télé-réalité, ose Leila Lévêque. On se moque énormément de la nana qui pose au milieu de la rue mais on la regarde en secret. » Voire, on la jalouse.
Pour preuve, l’experte en web influence prend l’exemple des relations professionnelles qu’elle entretient avec une génération qui court après une vie faite de goodies, d’invitations et de tapis rouge. « Il y a vrai processus de starification. Parfois, certains qui n’ont même pas 200 abonnés me demandent d’abord de passer par leur “agent” », confie-t-elle, en mimant les guillemets avec ses doigts.
Mais quel impact sur le réseau social ? Avec son compte intitulé « Coucou les girls », Juliette tourne en dérision les banalités du monde de l’influence. Et si elle fait rire quotidiennement ses 128 000 abonnés, la direction que prend Instagram ne lui plaît pas du tout. « Franchement, ça n’a rien à voir. Je n’ai pas envie que ça devienne uniquement un endroit où les pubs sont omniprésentes. Et en vrai, c’est déjà le cas. N’oublions pas pourquoi ce lieu a été créé : partager des photos avec ses potes. »
Le problème pour Nina, c’est que cela fait bien longtemps que ce n’est plus d’actualité. « On n’est plus du tout dans le partage là. Plus du tout dans la petite vie d’Insta où le but était de rencontrer des personnes avec le même centre d’intérêt. Quand je croise d’autres personnes sur une prestation, les discussions sont toujours les mêmes désormais : “Ah et tu as vu celle-là, combien elle s’est fait”. On ne parle que de thunes. Ça craint. »
Selon la jeune femme, le réseau aurait été sali par les marques et un tout nouvel algorithme qui privilégie davantage les contenus sponsorisés. Coïncidence ou pas, les deux fondateurs historiques du réseau social, Kevin Systrom et Mike Krieger, ont annoncé leur démission il y a deux semaines. Vraisemblablement en raison de désaccord avec l’orientation donnée par un certain Mark Zuckerberg.
Difficile de prédire ce que deviendra le réseau social préféré des jeunes, si votre feed ressemblera bientôt à une succession de clichés de pubs déguisées ou s’il faudra payer pour que vos abonnés aient des nouvelles de vous. Quoi qu’il en soit, aucun de nos Instagrameurs ne se raconte trop d’histoires sur le futur d’Instagram. « Tout bouge, tout évolue, philosophe Juliette dans un email. Pour l’instant, c’est Insta qui fonctionne et c’est super mais demain on retournera peut-être tous sur Myspace ? ». #instalol.
En partenariat avec :
Cet article a été publié dans le cadre d’un partenariat avec Cafébabel. Premier média européen en ligne édité en six langues, Cafébabel est un magazine fait par et pour les jeunes qui vivent et imaginent l’Europe au quotidien.