Les jeunes abonnés : nouvelle cible des influenceurs adeptes du dropshipping ?
Leur audience est jeune, fan d’eux pour leur chaîne YouTube ou leurs aventures en téléréalité. Alors ces influenceurs se sont mis à faire la promotion de peluches, de bonbons… Décryptage d’un phénomène et conseils pour éviter ces pièges.
Pile : elle affiche un grand sourire. Face : sa mine est boudeuse. Vous l’avez sûrement croisé sur votre fil Instagram, ou dans les stories d’influenceurs, qui ont fait, en nombre et en boucle, la promotion de cette peluche poulpe réversible.
Il suffit de « swiper » leur story, c’est-à-dire, de glisser l’index de bas en haut sur son écran, pour atterrir sur un site qui vend le jouet à la mode. L’e-commerce est attrayant : coloré, bien construit, facile d’utilisation. L’animal aux deux humeurs y est vendu presque 15 euros.
Le droshipping : savoir de quoi il s’agit
J’ouvre mon application Instagram : je vois cette peluche. Je garde ma petite cousine de 11 ans : je vois cette même peluche dans le décor de sa chambre de pré-adolescente. Et quand je flâne sur AliExpress : je vois encore cette peluche. Sauf que, sur le site chinois, l’article, identique à celui présenté par les influenceurs d’Instagram ou de Snapchat, coûte entre 0,32 et 2,53 euros, selon les vendeurs et la taille choisie de la peluche.
C’est ce que l’on nomme le dropshipping : un business model qui consiste à vendre un produit que l’on ne possède pas en stock. L’article est acheté par le « dropshipper » sur des plateformes de vente au rabais, à l’instar d’AliExpress, d’Alibaba ou de Wish, sur lesquels il entre directement l’adresse du client quand celui-ci lui passe commande. Il ne se charge même pas lui-même de l’étape « livraison ». Le prix affiché sur la boutique en ligne bien léchée du dropshipper est donc gonflé artificiellement. Marge considérable assurée pour ce dernier.
Les influenceurs, complices de cette pratique douteuse
L’internaute est entrainé sur son site-vitrine via une publicité ciblée sur les réseaux sociaux et/ou un placement de produit sur le compte Instagram ou Snapchat d’un influenceur aux centaines de milliers voire aux millions d’abonnés.
Qui est alors dupée par cette stratégie de vente ? Ma cousine âgée 11 ans, qui n’a pas la vigilance ou la compétence d’identifier ces pratiques douteuses. Elle a simplement fait confiance à son influenceuse préférée qui lui a expliqué en trois stories trouver ce nouvel article « génial », « extraordinaire », ou « unique », et lui a raconté avoir dégotté un code promo rien que pour ses fans adorés, comme elle. Un abus de confiance - voire de crédulité - alarmant de ceux qui ont la responsabilité d’« influencer ».
Des placements de produits de gadgets d’ados, de jouets et de bonbons
Selon le profil des membres de leurs communautés, les influenceurs font la promotion de montres ou de bracelets « de luxe », ou encore, d’appareils pour se boucler les cheveux ou perdre du poids. Ils semblent alors viser un public de jeunes adultes.
Mais, entre deux stories dans lesquelles ils testent ce genre d’articles, voilà qu’ils font désormais la promotion de produits qui ciblent les adolescents, et les plus jeunes encore. Avec ces fameuses peluches poulpes, par exemple. Mais aussi, parmi les plus promus : avec des figurines d’ours en roses artificielles, des peluches bébé Yoda, des projecteurs « ciel étoilé », des bracelets personnalisés pour « BBF », à s’offrir avec sa meilleure copine du collège, des palettes de maquillage très colorées, du rose au dorée, dont le design rappelle celui de certains jouets.
Certaines influenceuses, elles-mêmes dropshippeuses, sont allées jusqu’à créer leur marque de make-up. La stratégie ? Dropshiper ces palettes et cosmétiques, mais y apposer leur logo et les emballer dans un packaging aux couleurs de leur marque. Une étape supplémentaire pour un prix qui s’envole.
Le Youtubeur beauté Fabian CR, suivi par 394.000 abonnés, a comparé dans une vidéo plusieurs produits commandés sur Ali Express à ceux de la marque MLIPS*, fondée par l’influenceuse aux 2,6 millions de followers sur Instagram et candidate de téléréalité Maddy Burciaga. Le vidéaste a maquillé la moitié gauche de son visage avec les produits de la marque de l’influenceuse, l’autre moitié, avec ceux du site chinois. Crash-test filmé : le spectateur a l’impression que le visage a entièrement été maquillé avec la même palette. Fabian CR constate : « Aucune différence, que ce soit au niveau des packagings, de la pigmentation, de l’effet sur la peau. (…) On ne peut pas cacher que les produits sont extrêmes similaires, voire identiques. »
Parlant aux plus jeunes avec tous ces gadgets et peluches, les influenceurs réalisent même des placements de produits pour… des paquets de bonbons.
« Vous souvenez vous des bonbons Fini que tout Instagram présentait à n’en plus finir ? Bizarrement, plus de nouvelles ces derniers temps suite à une polémique sur le fait qu’ils coûtaient bien moins chers en supermarché. Et bien ils sont réapparus sous un autre nom, Dream Candy, de nouveau vanté par tous les candidats de téléréalité… », déplore sur Linkedin Sophie Lebel**, directrice communication chez Wizbii, société de services pour faciliter l’entrée dans la vie active des jeunes.
« En plus du tarif quelque peu élevé pour des bonbons, il semblerait que certains consommateurs ne reçoivent pas leurs commandes », s’indigne-t-elle encore, après avoir lu de nombreux commentaires d’acheteurs en colère sur la page Facebook de la marque.
Un système de ventes qui flirte avec l’illégalité
Commandes jamais livrées, mais aussi service après-vente (SAV) inexistant, publicité mensongère quant à la qualité du produit… Ces déceptions surviennent souvent après une commande d’un article dropshippé.
Et si le dropshipping demeure légal (tant que l’activité en ligne est déclarée), il est souvent accompagné de ces pratiques commerciales déloyales, qui sont, elles, répréhensibles par le droit du commerce.
Quelques conseils pour éviter ces pièges
Pour que les jeunes (et moins jeunes) internautes détectent ces arnaques, il leur faut effectuer un court et simple travail d’enquête avant de valider leur panier.
D’abord, vérifier le site web : la plupart des adeptes du dropshipping utilisent la plateforme de commerce électronique shopify pour construire leur e-shop.
Autre indice : si la boutique en ligne affiche des soldes considérables sur la totalité de ses produits. Pour exemple, la peluche poulpe est prétendument soldée à 13,90 euros. Son prix « initial » barré ? 24,90 euros. Sur un autre site, l’ours en roses artificielles est vendu au prix de 54,90 euros HT. Et nous sommes chanceux, tente de nous faire croire le dropshipper, en affichant juste à côté un autre prix qui a été rayé : 110 euros HT.
Parfois, les dropshippers et les influenceurs qui acceptent cette stratégie de communication créent un marketing de la rareté autour du produit proposé, en prétextant qu’il s’agit d’une série limitée - alors qu’ils n’ont pas de stock. D’autres fois, ils affichent de manière très visible, sur toutes les pages du site, un badeau qui nous informe qu’il s’agit d’une promotion flash, accompagné même d’un minuteur, dont le décompte créé un sentiment d’urgence, pour que l’on s’empresse de dépenser avant de passer à côté de l’affaire du siècle.
Une fois ces indices collectés, l’ultime vérification sur le site se fait du côté des avis. Si ceux-là sont unanimement dithyrambiques ou que la pire note est 4 étoiles sur 5 : méfiance.
Enfin, si les dropshippers ont pensé à naviguer sur les sites chinois, pensez-y vous aussi. En quelques recherches sur ces plateformes, vous aurez le cœur net sur la valeur du produit et, au passage, sur la sincérité de l’influenceur que vous suivez fidèlement.
Si aucun résultat ne s’affiche lorsque vous taper le titre du produit ou sa description dans la barre de recherche : utilisez Google Images. L’option « Image inversée » (l’icône appareil photo à droite de la barre de recherche) sera votre ultime outil d’apprenti enquêteur, conseillé sur le blog de l’entreprise française de télécommunication NordNet***. Enregistrez l’image de l’article du site marchand sur votre ordinateur, puis importez-la dans Google Images (« choisir un fichier »). Le moteur affiche alors toutes les pages qui utilisent cette même image… dont celles des sites chinois.
- « ALIEXPRESS VS MLIPS (Maddy) », sur la chaîne YouTube de Fabian CR
** « Top 8 des plus grosses arnaques des « influenceurs » », par Sophie Lebel, sur LinkedIn
*** « Ne vous faites plus avoir par le dropshipping, ces faux bons-plans », par « Mélanie De NordNet », sur blog.nordnet.com.

Le phénomène de désespoir par comparaison, l’autre mal des réseaux sociaux
Les retouches peuvent créer des complexes physiques mais ce ne sont pas les seuls contenus qui peuvent avoir un effet néfaste sur la santé mentale des utilisateurs. Plus d’informations sur le moins connu phénomène de désespoir par comparaison.
Qu’est-ce que le phénomène de désespoir par comparaison ?
Mais comment fait-elle ? Cette camarade classe, pour poser avec une nouvelle brochette d’amis, à chacune de ses nouvelles publications ? Mais comment fait-il ? Cet influenceur, pour se filmer sous le soleil des tropiques une semaine sur deux ? Et que fais-je, moi, au fond de mon lit, en pyjama depuis 19h30, à « scroller » leur vie de rêve ?
Assister à la vie de l’Autre - que l’on observe via ses réseaux sociaux qu’il approvisionne d’instants joyeux - revient, souvent, à la comparer à la sienne. Quoi de plus humain ? Mais être spectateur des vacances de l’un, des sorties des évènements branchés de l’autre, peut conduire l’internaute à trouver, en comparaison à ces vies animées, la sienne ennuyante, voire à se trouver lui-même ennuyant. Une reproduction XXL de ce qu’un adolescent pourrait ressentir dans la cour de récréation de son collège, lorsqu’il se compare au délégué de classe, star de la bande des « populaires », qui est, lui, invité aux évènements les plus « cool » de la promotion, quand ce n’est pas lui qui les organise et trie sur le volet ses convives.
Insidieusement, une forme d’aigreur et de frustration se créent à travers l’écran, ainsi qu’un sentiment d’exclusion. Le jeune sujet peut même développer un complexe d’infériorité jusqu’à, parfois, faire une dépression.
Shirley Cramer, directrice de la Royal Society for Public Health (RSPH), nomme ce mal le « phénomène de désespoir par comparaison ». « Le fait de voir en permanence des amis en vacances ou sortir peut amener les jeunes à se sentir exclus alors que d’autres profitent de la vie. Ces sentiments peuvent provoquer chez eux une attitude de désespoir par comparaison », explique-t-elle simplement.
L’association caritative qu’elle dirige, dédiée à la santé publique, a mené une étude aux conclusions alarmantes. 1479 jeunes âgés de 14 à 24 ans, ont fait part de leur anxiété, de leur solitude, voire, de leur dépression. Leurs témoignages ont conduit à la conclusion suivante : Instagram et Snapchat sont les deux pires réseaux sociaux en matière de bien-être et de santé mentale pour les jeunes.
Sur Instagram, 95 millions de photos et vidéos sont postées chaque jour, rappelle « l’association de protection de l’enfance sur Internet » e-Enfance. Le concept-même de la plateforme repose sur l’image, l’illustration filtrée de sa vie. Et comme Snapchat, le but est aussi de poster des « stories », des publications éphémères de ses sorties : au restaurant à la mode, en festival, sur une plage dansante, bref, là où il faut être pour profiter et, au passage, montrer à l’autre qu’on s’y trouve. Ce qui donne immanquablement à ce dernier l’impression de ne pas bénéficier d’une vie aussi trépidante.
Un cercle vicieux qui entraîne chacun à présenter un portrait irréaliste de soi
Pourtant, cette vie effervescente affichée est souvent mise en scène. Les publications sur le fil des influenceurs, dont le métier est de produire du contenu qui « fait rêver » (quand elle ne frustre pas et ne conduit pas au désespoir), sont souvent des shootings, réalisés par des photographes professionnels, avant d’être retouchées et filtrées. Le cadre est idyllique car il s’agit d’un partenariat. L’influenceur semble heureux, car son métier est de paraître ainsi.
Conséquences : leurs publications irréelles produisent des attentes irréalistes, « qui peuvent pousser les jeunes à des sentiments de gêne, de mauvaise estime de soi et une recherche de perfection qui peut prendre la forme de troubles d’anxiété », alerte la RSPH.
Il s’agit là d’un cercle vicieux : les influenceurs enjolivent leur vie pour la gagner, et leurs abonnés, poussés par un sentiment de frustration face à leurs publications parfaites, souffrant à la fois d’un « désespoir par comparaison » et d’une quête d’approbation sociale, par les likes, travestissent à leur tour leur vie pour que celle-ci paraisse moins banale.
Plus d’une personne sur dix (12%) avoue mentir quant à ses activités postées et les lieux où il se trouve pour embellir son existence virtuelle et s’attirer plus de likes, selon une étude menée en 2017 par Kaspersky Lab, une société privée multinationale spécialisée dans la cyber-sécurité, et repérée par le Journal du Geek.
On peut par ailleurs imaginer que le phénomène de désespoir par comparaison est lié à un autre nouveau mal : le syndrome du FOMO, acronyme anglais de « fear of missing out ». Ou quand la peur de rater un évènement génère une anxiété sociale. Certains abonnés en désespoir de comparaison, et qui lutterait contre celui-ci par la mise en scène d’eux-mêmes, pourraient développer une crainte de manquer un évènement qui leur aurait donner une occasion de se mettre en situation, et d’interagir avec leurs abonnés.
La pandémie mondiale a-t-elle apaisé ces sentiments de désespoirs par comparaison ?
On serait d’abord tenté de penser que la crise sanitaire a fait régresser ce sentiment de désespoir par comparaison, puisque les célébrités comme les anonymes étaient logées à la même enseigne : confinés. Les professionnels du « contenu qui donnent envie » ne pouvaient publier rien de plus original que leurs abonnés. Plus que jamais, les vies des internautes se confondaient, créant même, dans un premier temps, une proximité complice entre eux et les artistes ou influenceurs. Il était par exemple rassurant de les savoir s’ennuyer, avec nous, dans leurs vidéos live sur Instagram, et dans lesquelles ils interagissaient simplement avec leur public.
Mais dans ces zones du globe où un premier confinement avait été déclaré, le trafic Internet mondial avait inévitablement progressé : un bond de 70%, selon l’institut Omdia, cité par Forbes. Sur le podium des domaines les plus impactés par cette augmentation spectaculaire : les réseaux sociaux, bien sûr, aux côtés des plateformes de streaming et des sites commerçants. Les internautes ont sur-consommé les médias sociaux durant cette période. Ils ont donc davantage été au contact de ces fausses vies merveilleuses, devant les stories « souvenirs » ou les publications pérennes des feeds ultra-filtrés.
Et puis, un à un, les influenceurs ont commencé à voyager de nouveau, voire à déménager loin de la France et du quotidien de leurs abonnés, dont la vie n’a jamais été aussi banale, du fait des restrictions sanitaires.
En quelques mois, ils se sont installés par dizaines (et dizaines) à Dubaï, pour bénéficier d’une réduction d’impôt, comme on peut l’imaginer, mais aussi, dans la visée de partager avec leurs followers des photos et des vidéos qui invitent, selon eux, à la rêverie. C’est ce qu’expliquait l’une d’eux chez le Youtubeur Sam Zirah. « Pour un influenceur, c’est dur de faire du contenu quand tu es enfermé chez toi, de montrer des beaux paysages », plaide Kellyn Sun, 21 ans, suivie sur Instagram par presque 800.000 abonnés. « Ça reste un métier. Chacun a un métier et le mien, c’est de partager des beaux contenus », balaie-t-elle, sans se questionner quant aux complexes que peuvent générer ses mises en scène auprès d’une jeune audience, dans un tel contexte de surcroît.
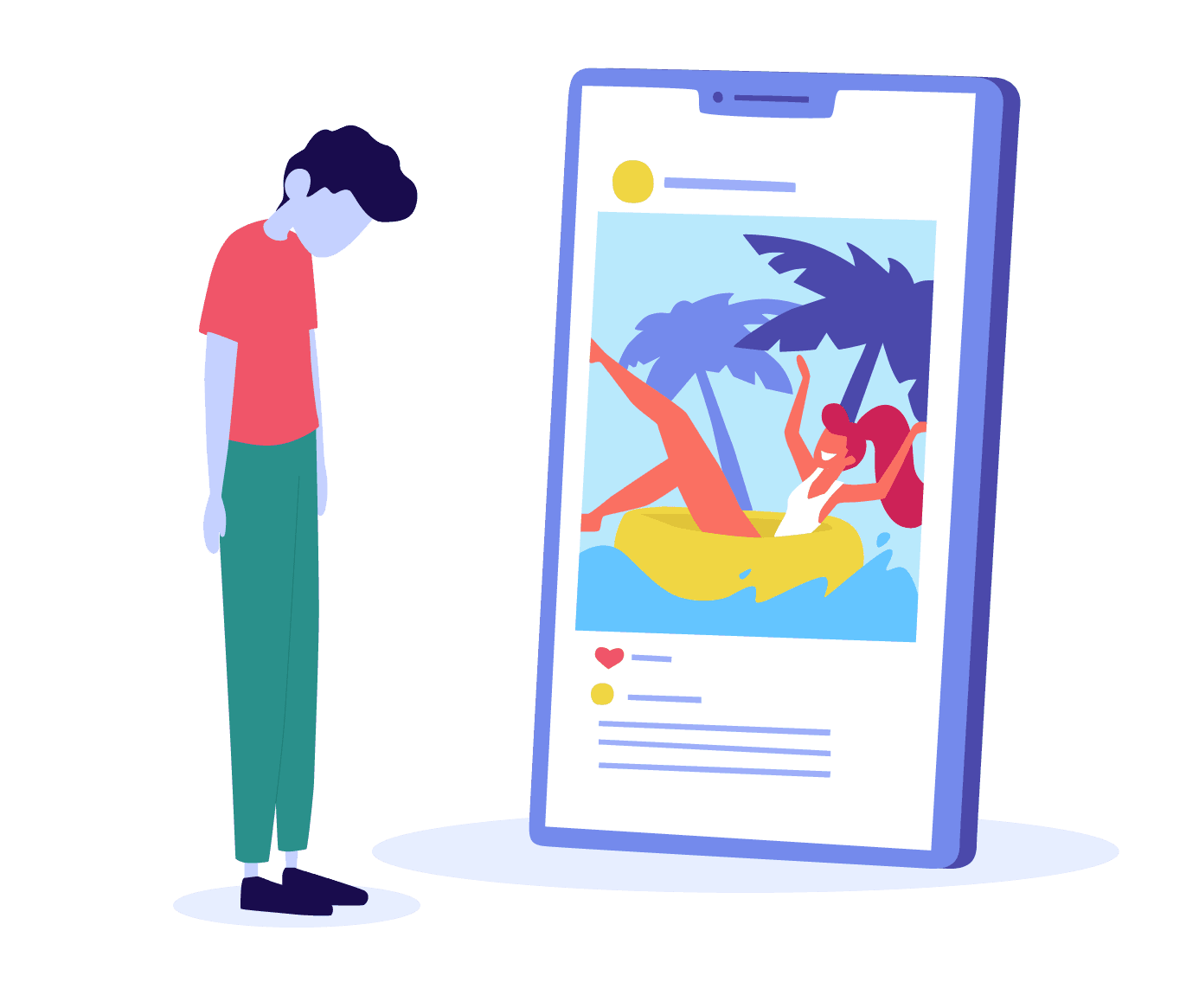
Enfants youtubeurs : que dit la loi ?
Les plateformes de vidéos comme les parents de vidéastes de moins de seize ans doivent respecter une nouvelle loi, entrée en vigueur en avril dernier. Plusieurs mesures encadrent (enfin) la pratique.
« Bonjour à tous. Je vous remercie pour toutes mes vues et tous mes abonnés (…). Donc on va commencer maintenant le maquillage de La Reine des Neiges avec un petit peu de fond de teint. » Amy a tressé sa chevelure bonde, comme Elsa, princesse Disney à qui elle va tenter de ressembler. Diadème en toc posé sur sa petite tête d’enfant, la (très jeune) Youtubeuse détaille face caméra chaque étape de son tutoriel de maquillage. Derrière l’écran ? Presque quatre millions d’internautes ont vu cette vidéo de 9 minutes.
Amy n’est pas l’exception qui confirmerait la règle. Nombreux sont les enfants Youtubeurs qui cumulent des centaines de milliers, voire des millions de vues sur la plateforme de vidéos, interdite - c’est un comble - au moins de 13 ans.
En France, la chaîne YouTube de « Swan & Néo », deux frères de 9 et 13 ans, et celle des sœurs Athéna et Khalys, 8 et 13 ans, nommée « Studio Bubble Tea », sont suivies respectivement par 5,52 millions et 1,75 millions d’abonnés.
Outre leur popularité, leurs vidéos (des challenges, des dépaquetages de jouets, des pranks, des tests de jeux vidéo…), ont un point commun : la présence, tantôt derrière tantôt devant la caméra, de leurs parents.
Les enfants influenceurs sont-ils influencés par leurs parents ?
Les chaînes « familiales » sur YouTube interrogent : les enfants apprécient-ils réellement cette activité ? Leurs parents les poussent-ils à tourner toujours plus de vidéos, dans la visée de faire toujours plus de vues, donc d’argent (puisque les créateurs de contenus sont rémunérés par la plateforme au nombre de clics) ? Les adultes vivent-ils leur rêve à travers le succès de leur enfant ? S’agit-il de travail dissimulé ? Pourquoi les enfants mannequins ou acteurs sont-ils soumis à un contrat de travail et pas ces enfants vidéastes ? Oui, mais… comment contrôler le nombre d’heures d’un travail si celles-ci sont effectuées à l’abri des regards, entre les murs du foyer, et non dans un studio ou un plateau de tournage ?
Il n’y avait jusqu’à peu aucun texte de loi pour répondre à ces questions. Vide juridique. Mais le 19 octobre 2020, une loi pour règlementer la pratique a été promulguée.
Déposé au Parlement en décembre 2019, examiné puis voté à l’unanimité par les élus début octobre 2020, le texte porté par le député LReM du Bas-Rhin Bruno Studer qui contient plusieurs mesures pour encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’un mineur de moins de 16 ans, est en vigueur depuis le mois d’avril 2021.
La fin du vide juridique
Parmi ces mesures : l’obligation pour les parents d’enfants de moins de seize ans Youtubeurs, influenceurs, ou e-sportifs, de demander avant diffusion une autorisation ou un agrément auprès de l’administration compétente, soit, le préfet du siège social de l’entreprise qui engage le mineur.
Si l’enfant est à la fois le producteur de l’enregistrement audio-visuel, le principal sujet de celui-ci, et enfin, que son contenu est diffusé à titre lucratif sur une plateforme vidéo, alors, il est aussi imposé aux parents d’avoir une autorisation ou un agrément préalable, avant tournage. En l’absence de ces documents, l’administration peut saisir le juge des référés.
Enfants youtubeurs, influenceurs ou e-sportifs : des enfants du spectacle comme les autres
Lorsqu’ils formuleront ces demandes obligatoires, les parents seront informés des droits de l’enfant et des conséquences de son exposition sur la Toile. La partie « sensibilisation » de cette loi, qui n’est autre qu’un prolongement de la législation pour les enfants du spectacle.
Et comme c’est la règle pour les enfants du spectacle, les parents de « baby Youtubeurs » ont désormais l’obligation financière de placer une partie des revenus perçus par leur progéniture (par YouTube, grâce aux nombres de vues sous ses vidéos, mais aussi, par les marques qui ont payé pour des placements de produits), à la Caisse des dépôts et consignation, où ils seront bloqués jusqu’à leur majorité ou leur émancipation. La loi prévoit des sanctions - applicables depuis avril 2021, donc - pour les parents profiteurs qui refuseraient de se plier à cette nouvelle règle et garderaient le pécule.
Quid des vidéos « faites maison », ces « vlogs » (mot-valise créé à partir de « vidéo » et « blog ») tournés en famille ? Cette « zone grise » a elle aussi été réglementée, dans l’article 3, qui tranche : « Lorsque la diffusion de ces contenus occasionne, au profit de la personne responsable de la réalisation, de la production ou de la diffusion de ceux-ci, des revenus directs ou indirects supérieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat », mais aussi, dès lors que les productions de ces vidéos dépassent un certain temps ainsi qu’un certain volumes de contenus (nombre de vidéos publiées en ligne), alors, les vlogs seront soumis aux mêmes règles de protection des jeunes protagoniste que pour les travaux plus professionnels d’enfants vidéastes. Déclaration obligatoire, sensibilisation aux parents, et consignation d’une partie des revenus de l’enfant, donc.
Le droit à l’oubli : droit fondamental de l’enfant influenceur
Le droit à l’oubli, aussi appelé le droit à l’effacement (différent du droit au déréférencement, moins radical), prévu par la loi Informatique et libertés, et grâce à ce nouveau texte, ouvert aux mineurs influenceurs. Ainsi, sur demande directe de ces derniers, les plateformes de vidéos ont désormais l’obligation de retirer leurs contenus, et ce, sans passer par le consentement des parents.
Une précieuse protection pour ceux, qui, en grandissant, ont le droit de ne plus vouloir de ce passé numérique consultable en deux clics.
Les parents ne sont pas les seuls à être pointés par la loi. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) est chargé d’inciter les plateformes de vidéos à signer une charte qui informe les mineurs sur les conséquences de la diffusion de leur image à plusieurs niveaux : sur leur vie privée, mais aussi d’un point de vue psychologique et juridique, comme le demandaient, inquiètes, les associations de protection de l’enfance.
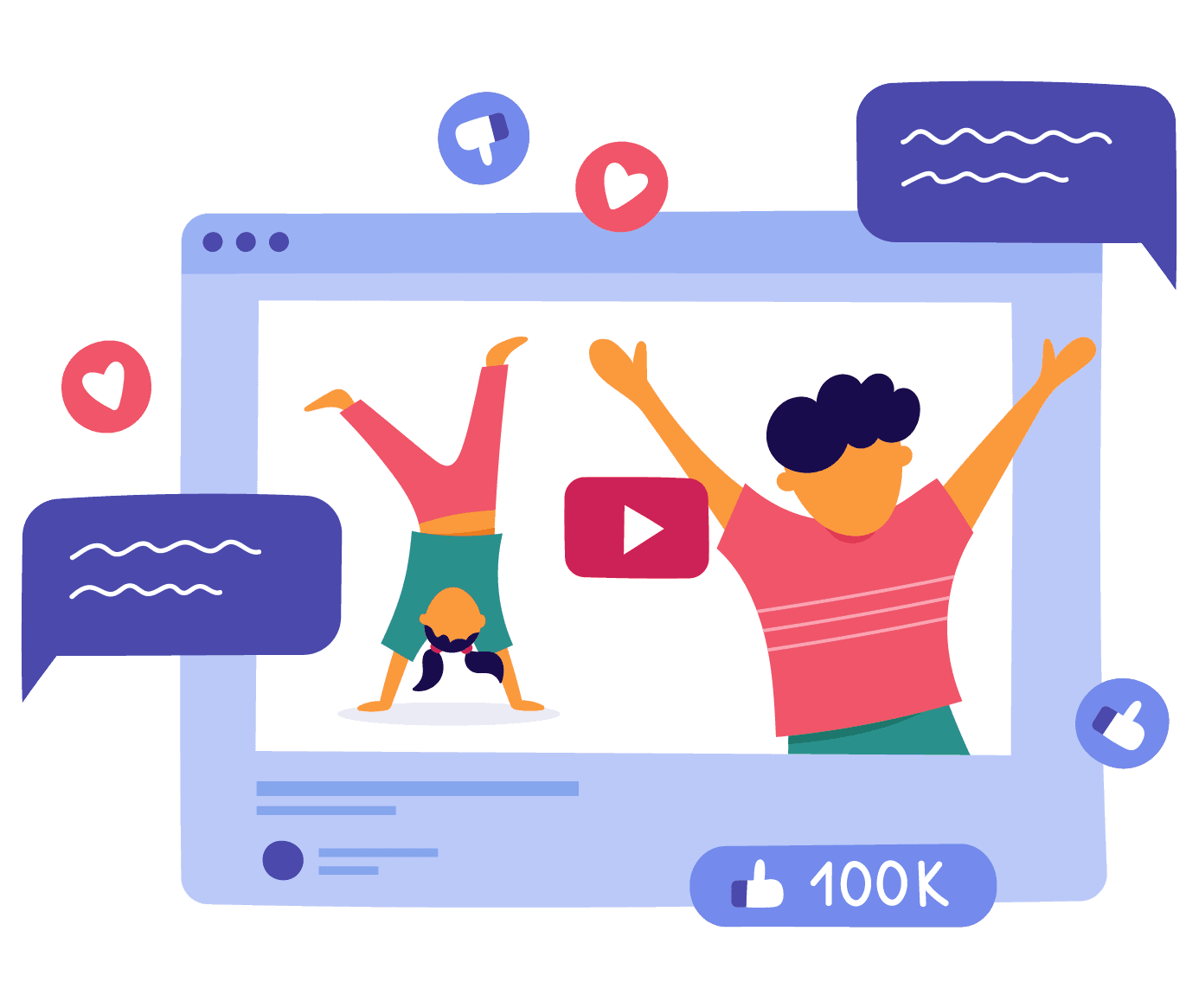
Quand l’émoji devient l’arme des cyber-harceleurs
Oui, les émojis c’est tout mignon, coloré, et ça permet d’exprimer nos émotions en un clic… Mais attention, derrière ces petits pictogrammes se cachent parfois des messages bien plus sombres ! Ils peuvent dissimuler des codes secrets, être utilisés par les jeunes pour parler de sujets sensibles, ou même servir d’armes de cyber-harcèlement. Ce détournement d’émojis devient une tactique redoutable qui permet d’échapper aux modérateurs… et aux parents ! Si vous découvrez des émojis qui vous semblent suspects sur les comptes de vos enfants, ne paniquez pas mais ouvrez le dialogue pour comprendre ce qu’ils font et pourquoi !

Filtres : quelles conséquences sur la santé mentale des jeunes utilisateurs ?
Habitués à retoucher virtuellement leur apparence, certains adolescents peinent à supporter leur image dans la vraie vie et complexent sur ces détails physiques que les filtres corrigent. Décryptage d’un mal être.
Le grain de peau est lissé, les pores comme l’acné sont effacés, et les dents, blanchies. Son doigt est une baguette magique, qui, en trois mouvements sur l’écran tactile, a modifié son apparence. En quelques secondes, l’utilisateur du smartphone a pu et su rectifier son portrait, alors qu’il y a quelques années, seuls les professionnels, armés de logiciels d’éditions d’images, savaient retoucher.
S’auto-modifier est devenu un jeu d’enfants
Intuitives, les applications ont simplifié le procédé, l’ont « dé-professionnalisé ». Facetune, la plus célèbre d’entre elles, a séduit 180 millions d’amateurs. La société d’analyse de trafic Sensor Tower indiquait même, en 2018, que Facetune était la deuxième application payante au monde à être restée le plus longtemps à la tête du top de téléchargement de l’AppStore. Chacun peut donc s’auto-modifier avec facilité avant de se présenter - et tant pis s’il s’agit d’un « faux soi » - à ses abonnés.
Certains préfèrent l’éphémère, publient davantage en story. Et là, plus besoin d’utiliser une seconde application : Instagram et son catalogue infini de filtres se chargent des retouches. Une fois le visage face caméra identifié, les filtres en réalité augmentée affinent le nez de l’utilisateur, creusent ses joues ou gonflent ses lèvres, changent sa couleur des yeux, et donnent bonne mine. Certains filtres, comme les populaires Cherry on the cake, Butterfly look ou Lil Icey Eyes parsèment artificiellement les pommettes des « Instagrammeurs » de taches de rousseurs.
L’injonction au bonheur, travers d’Instagram depuis ses débuts, avec cette obligation sous-jacente de publier ses vacances dans des paysages paradisiaques et partager aussi souvent que possible des selfies tout sourire – est aujourd’hui supplanté par l’injonction à la beauté.
Les jeunes utilisateurs sont nombreux à se sentir fragilisés par ces outils addictifs et leurs règles tacites. Instagram et Snapchat, père et mère du filtre, sont d’ailleurs les réseaux sociaux qui exercent le pire impact sur la santé mentale et le bien-être des adolescents, selon une étude menée par l’association caritative dédiée à la santé publique Royal Socialty for Public Health (RSPH) auprès de 1479 jeunes âgés de 14 à 24 ans, faisant part de leur anxiété, de leur solitude, voire, de leur dépression.
Un avatar qui fait complexer
Le photographe britannique Rankin a tenté de prouver l’impact d’Instagram, de Snapchat, et surtout de leurs filtres, sur la santé mentale des adolescents. Pour cette expérience, l’artiste a réalisé une série de portraits de quinze jeunes, âgés de 10 à 18 ans, à qui il a ensuite demandé d’éditer leur portrait, pour arriver au résultat qu’ils auraient posté sur leurs réseaux sociaux. Aucun des adolescents photographiés n’a gardé le cliché d’origine signé Rankin. Certains ont agrandi leurs yeux, d’autres rétréci leur nez, et tous ont lissé leur peau. L’avant et après, mis côte à côte, illustrent le « mal du selfie » chez ses jeunes, selon le titre du projet du photographe, qui dénonce ainsi les « effets néfastes des médias sociaux sur l’image de soi ».
Si, lorsque l’on se place devant notre écran, Instagram nous renvoie une version corrigée de nous-même, cela signifie-t-il que notre visage n’était pas suffisamment « beau », « conforme » à ses codes de beauté, ou dans la (sa) norme ? Si l’application nous corrige, c’est qu’il y a des choses à corriger, ici et là, peut-on se mettre à penser, et à s’angoisser.
Imaginez un miroir qui vous renverrait votre reflet « amélioré »… De quoi lourdement complexer. En d’autres termes : les filtres nous mettent face à nos défauts, ils les soulignent. En voulant les faire disparaître, ils les rendent visibles, flagrants, voire démesurés aux yeux de l’utilisateur.
La volonté de ressembler à son « moi » filtré
Un trouble psychologique de dysmorphophobie, c’est-à-dire, une focalisation jusqu’à l’obsession sur une partie du corps ou un défaut physique imaginaire ou surestimé par le sujet, peut alors se déclencher par une consommation intensive de ces filtres, ont averti un groupe de chercheuses de l’université de Boston dès 2018.
Leur étude, publiée dans la revue médicale JAMA Facial Plastic Surgery, a révélé que les adolescents étaient de plus en plus nombreux à présenter à un chirurgien esthétique un cliché d’eux, filtré, afin de lui montrer ce à quoi ils souhaiteraient ressembler.
Des chirurgiens plasticiens américains ont confirmé cette « dysmorphie Snapchat », voyant taper à la porte de leur cabinet de plus en plus de patients désireux d’améliorer leur physique, selon les normes de beautés imposées par les filtres. L’Annual American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery (AAFPRS) a sondé la profession en 2017 : 55 % des chirurgiens déclaraient alors avoir reçu des patients avec cette volonté - ils étaient 42 % en 2015. La part de demandes de ce type a donc augmenté de 30 % en seulement deux ans.
L’exemple le plus extrême est peut-être celui de Levi Jed Murphy, qui, en décembre 2019, a dépensé plus de 20.000 euros en chirurgie esthétique pour ressembler à un filtre Instagram. Opéré du nez, des sourcils et des lèvres, il a aussi subi une cathoplastie pour étirer ses yeux comme s’ils étaient naturellement en amande.
En réponse à ce malaise, Facebook - qui détient Instagram - s’est engagé en octobre 2019, via un communiqué de la compagnie Spark AR, créatrice de l’option « filtre », à supprimer les filtres Instagram « effets chirurgie esthétique ». Pas encore de mise à jour depuis l’annonce, s’excuse sur Facebook Spark AR. Mais ces effets, qui transforment de façon radicale, sont-ils les plus importants à bannir ? Les filtres qui modifient les imperfections par touches, insidieusement, pour un rendu dont on ne peut plus se passer, ne sont-ils pas plus dangereux ?
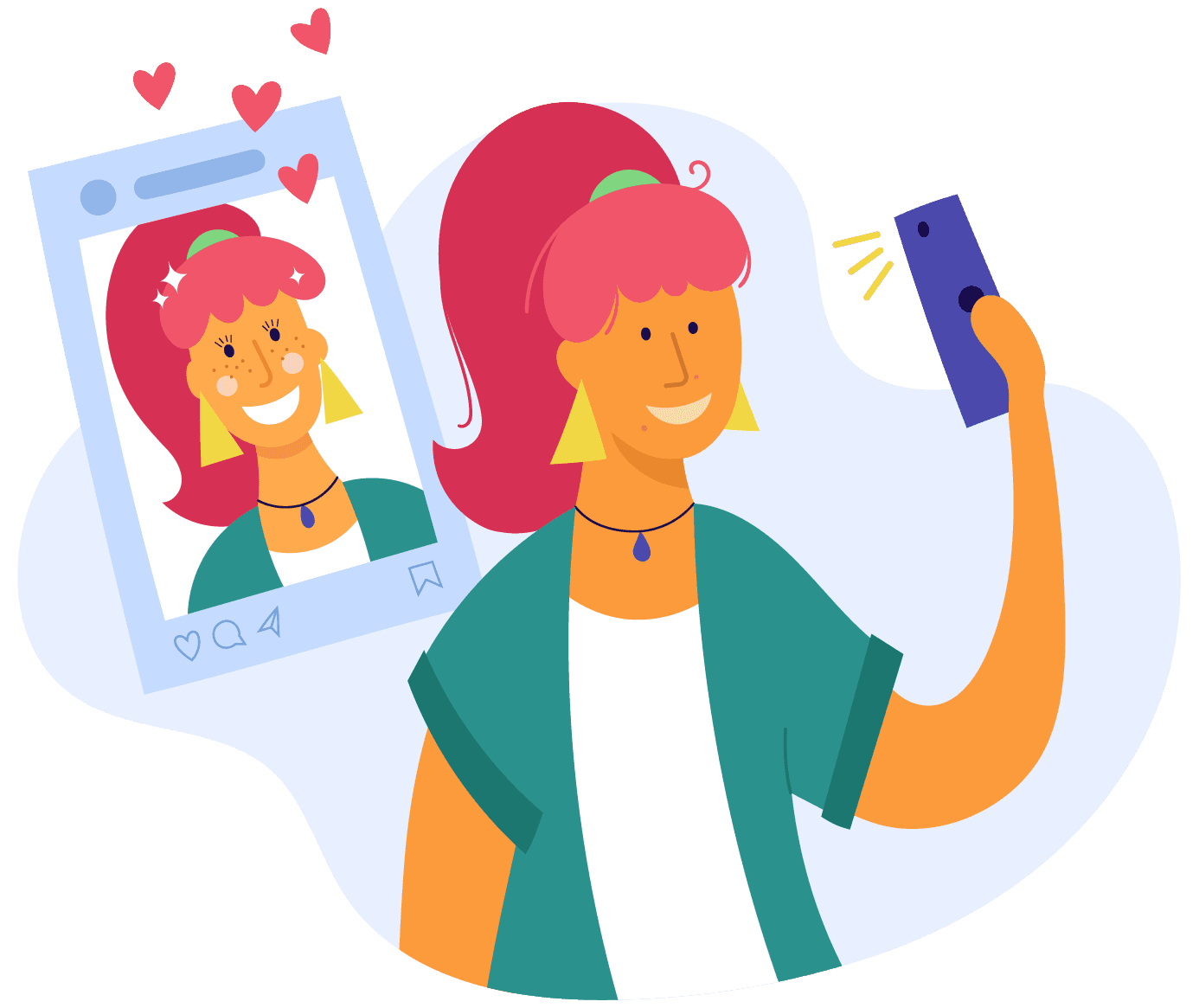
Exclusion numérique : 50 nuances d'illectronisme
Sans être en situation d’illectronisme, plus d’un usager sur trois, en France, manque d’au moins une des compétences numériques de base, fondamentales. Un inconfort au quotidien.
Dans l’enfance, ma grande-tante Danielle me paraissait si moderne. Sœur de ma grand-mère, elle sortait davantage qu’elle, allait au cinéma plusieurs fois par semaine, se rendait chez Virgin pour écouter dans les casques en libre service les dernières nouveautés en tête des ventes. Elle ne se baladait jamais sans son walkman, et lorsqu’elle rentrait chez elle, elle se précipitait devant son lecteur DVD portable.
À la même époque, ma grand-mère, elle, s’allongeait devant sa télévision, zappait de la 2 à la 1, de la 1 à la 3, point. C’était là son rapport le plus poussé à la technologie.
Les courbes se sont finalement croisées avec la démocratisation d’Internet à domicile. « Moderne Danielle » n’a pas pris le train en marche. Ça ne l’intéressait pas, elle préférait sortir, a-t-elle répété les premières années, avant de se murer depuis dans un silence honteux, chaque fois qu’elle n’arrivait plus à suivre les conversations sur les trolls Twitter ou les stories Instagram.
Défauts de matériel et de compétence sont souvent liés
Danielle est aujourd’hui sans ordinateur, tablette, smartphone, ni même abonnement à un cyber-café. Sans aucun outil donc pour se connecter à Internet, qu’elle ne sait de toutes façons pas utiliser. Comme elle, 23% des Français de plus de 12 ans ne possédaient pas de smartphone en 2019, et 24%, pas d’ordinateur, selon l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep)1. Plus précisément, une personne de plus de 75 ans sur deux n’a pas d’accès à Internet depuis son domicile.
On considère aujourd’hui que 17% de la population seraient victimes de la fracture numérique2, dans une société de plus en plus digitalisée, à la faveur des confinements qui ont exacerbé l’importance du numérique dans nos vies et accéléré la dématérialisation de l’administration. Cette part de Français souffre « d’illectronisme », ou encore, d’ « illettrisme électronique », lié à un défaut matériel (absence d’équipement ou d’accès à Internet) ou de compétence, qui vont dans de nombreux cas de pair. Leur situation les isole, les exclut, inévitablement.
Pas toujours « illectronique », mais privé d’au moins une compétence essentielle
Un gouffre sépare les conversations et les quotidiens des sœurs octogénaires désormais. Car ma grand-mère, elle, s’accroche à cette époque, tente d’en comprendre les codes et les langages 2.0, de manier son iPad avec dextérité…
Mais il ne lui semble pas toujours évident de savoir chercher là où il faut : sur le bon site, et même, au bon endroit de ce site. Elle n’est pas née avec une souris dans la main, utiliser ces outils numériques lui demandent un effort certain. Elle n’est pas touchée par l’illectronisme. Mais comme le Sénat le pointe dans un rapport d’information3, l’illectronisme forme en réalité un « halo », regroupant des personnes qui disposent d’au moins une compétence de base (contre aucune chez les illectroniques, selon la définition de l’Insee), sans pour autant être à l’aise avec le numérique.
Selon la dernière étude de l’Insee, citée dans ce même rapport, 38% des usagers, en France, manquent d’aptitudes considérées comme basiques, dans - au moins - l’un des quatre domaines essentiels identifiés par Eurostat : la recherche d’information (sur des services marchands ou administratifs…), la communication (envoyer ou recevoir des e-mails), la résolution de problèmes (accéder à son compte bancaire par Internet, copier des fichiers, …) et l’utilisation de logiciels (tels que les logiciels de traitement de texte). Cette dernière compétence est, selon l’INSEE, celle que les Français maîtrisent le moins : 35% des usagers d’Internet et 45% de l’ensemble de la population se trouvent dans l’incapacité d’utiliser un logiciel de traitement de texte. Un outil pourtant clef aujourd’hui dans de nombreuses vies professionnelles et démarches administratives.
Autres données édifiantes : 11% des usagers et 24% de la population, soit presque une personne sur quatre, ne savent pas rechercher des informations sur Internet, tandis qu’une sur cinq est dépourvue de la compétence « communication » et ignore donc, comment échanger en ligne.
38% d’internautes en difficulté au total : c’est plus d’un usager sur trois. « En rapportant ces chiffres à l’ensemble de la population, autrement dit, en intégrant les non-usagers, on en conclut que près de la moitié de la population française âgée de plus de 15 ans (47,3 %) manque au moins d’une compétence de base », appuient les rapporteurs du Sénat. Par ailleurs, 2% ne savent pas utiliser un ordinateur, bien qu’ils disposent de l’équipement nécessaire.
Qui sont les usagers les moins à l’aise ?
Dans son rapport « Les bénéfices d’une meilleure autonomie numérique4 », l’organisme d’expertise et d’analyse rattachée au premier Ministre France Stratégie a divisé la population en cinq catégories pertinentes : les non-internautes, qui rassemblent 16% des Français qui ne se connectent jamais à Internet ; les internautes « distants », qui représentent 12% de la population et dont les compétences semblent insuffisantes pour réaliser des opérations simples (la recherche d’information ou un achat en ligne, par exemple) ; puis il y a ceux qui maîtrisent convenablement les outils numériques. Ce sont les internautes « traditionnels » (à 14%), les internautes « utilitaristes » (32%) et enfin, les « hyper-connectés », à hauteur de 26%.
Si l’on additionne les populations des deux premières catégories - les non-internautes et les internautes distants - on atteint les 28% de la population en difficulté vis-à-vis du numérique. Soit, 14 millions de Français.
Si la population de 75 ans et plus a 8,8 fois plus de risque d’être en situation d’illettrisme numérique que les 15-29 ans, et les 60-74 ans 5 fois plus, Stéphane Legleye, chercheur à la division « Conditions de vie des ménages » de l’Insee et responsable de cette étude, tient à nuancer : « Bien que l’âge constitue un facteur particulièrement discriminant, il ne faut pas perdre de vue des formes parfois plus complexes d’exclusion numérique chez les jeunes. Ces derniers sont certes beaucoup moins concernés par la catégorie « illectronisme », notamment car il est plus rare qu’ils soient totalement dépourvus de compétences numériques. Mais il est moins rare que des adolescents ou jeunes adultes, particulièrement actifs sur les réseaux sociaux et aptes à communiquer par Internet, soient en difficulté pour d’autres tâches, comme l’envoi de courriels ou la recherche d’informations administratives ».
Par ailleurs, un tiers des personnes peu ou pas diplômées, comme les 16% des ménages les plus modestes, sont touchées par un manque d’équipements, qui leur permettraient d’acquérir des compétences numériques premières et fondamentales.
Pour comprendre les machines, il faut encore des Hommes. Alors, si vous n’êtes pas à l’aise avec les outils numériques, sachez qu’un numéro vert existe pour vous aider à vous y familiariser : 0800 11 10 35.
1 [Arcep, Baromètre Numérique, novembre 2019 - « Enquête sur la diffusion des technologies de l’information et de la communication dans la société française en 2019 »] (https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/rapport-barometre-num-2019.pdf)
2 [Enquête réalisée par l’Insee sur la fracture numérique] (https://www.vie-publique.fr/en-bref/271657-fracture-numerique-lillectronisme-touche-17-de-la-population)
3 [« L’illectronisme ne disparaîtra pas d’un coup de tablette magique ! »] (https://www.senat.fr/rap/r19-711/r19-711.html), sur Sénat.fr
4 [« Les bénéfices d’une meilleure autonomie numérique »] (https://www.strategie.gouv.fr/publications/benefices-dune-meilleure-autonomie-numerique), sur Stratégie.gouv
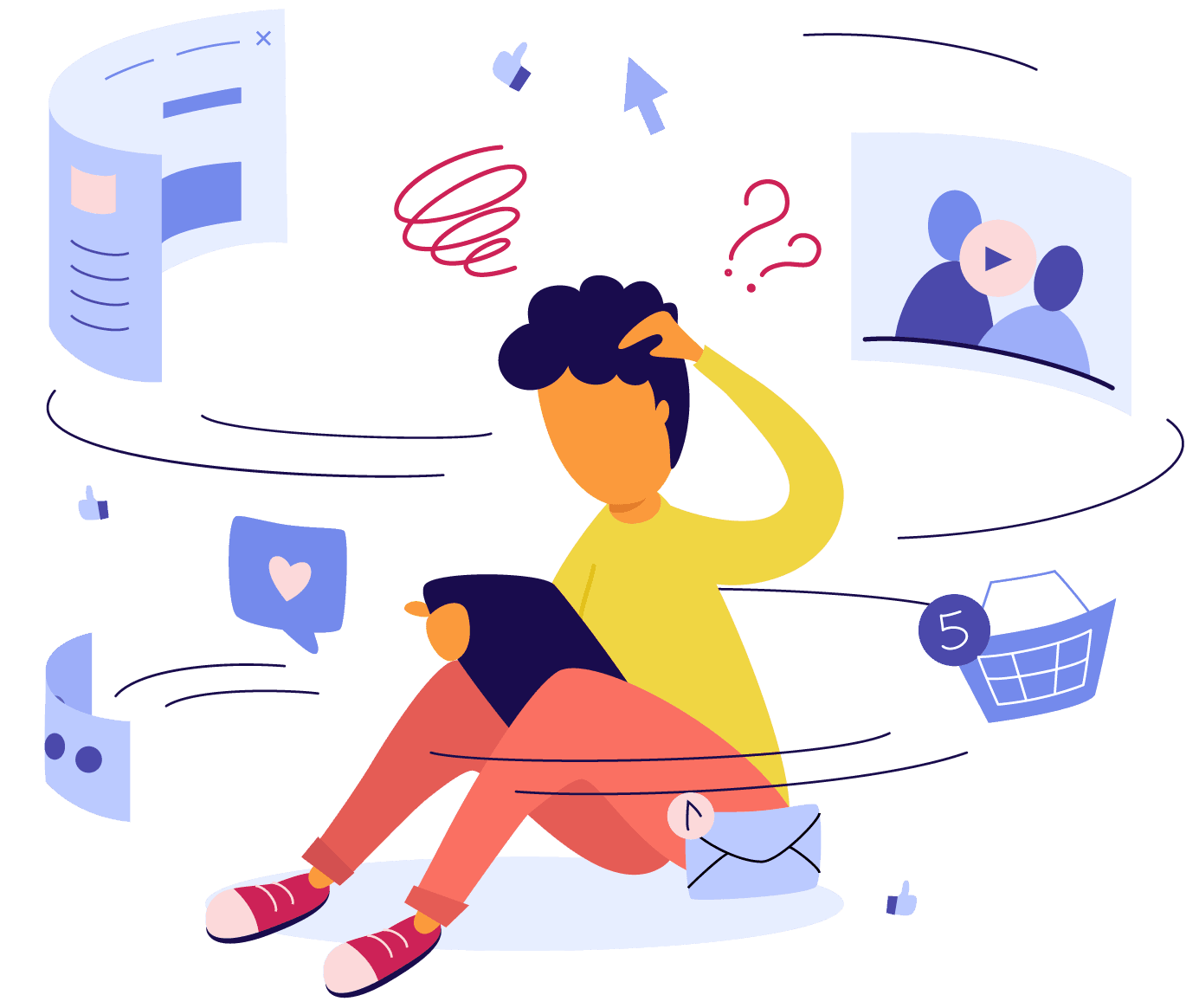
Instagram & co : des loisirs gâchés par le diktat de l'image parfaite ?
Les internautes s’obligent parfois à partager sur leurs réseaux sociaux leurs plaisirs quotidiens, leurs loisirs, leurs vacances…quitte à détériorer la qualité de ces précieux instants. Décryptage.
Les derniers rougeoiements du soleil s’éteignaient sur les dunes, à perte de vue. Après quarante minutes de route sur les bosses flottantes de sable brûlant, nous voilà garés au milieu du vide et du calme. En position pour un éblouissant spectacle…que je me suis brillamment gâchée.
Plutôt que de mémoriser l’instant avec mes yeux, j’ai dégainé l’iPhone. Je ne l’ai pas lâché, angoissée par l’idée de capturer LE cliché et LA vidéo de rêve. J’ai aperçu le soleil se coucher, l’œil coincé derrière l’écran. De quoi vivre la même expérience que si j’avais visionné la vidéo d’un.e autre.
Se gâcher le plaisir en jouant au community manager de ses vacances
J’avais abandonné l’idée d’avoir un beau portrait devant ce décor orangé de carte postale, puisque la route sinueuse du Safari m’avait rendue nauséeuse, transpirante, et décoiffée. Il fallait donc tout miser sur le paysage pour publier un diaporama « waouw » sur Instagram.
Instagram d’ailleurs, ou plutôt ma consommation du réseau social de l’image et du beau, détériora a bien des égards la qualité du moment.
D’abord, parce que j’ai pensé à ma future publication, au regard des autres, avant de penser à mon propre plaisir dans l’instant. Ensuite, parce que j’avais déjà cliqué sur la localisation « Red Desert » sur l’application. Je m’étais en quelque sorte « spoilée » le spectacle, en zoomant sur chaque publication filtrée des influenceurs. J’en avais même enregistré certaines, afin de reproduire la mise en scène qui me plaisait. On trouve bien sûr nos clichés moins léchés que ceux des autres, plus esthétiques, mieux retouchés, plus HD (pour réaliser le post idéal, des véritables shootings avec des photographes professionnels, qui transportent leur matériel de studio au milieu du désert, sont proposés aux touristes… Nous en sommes là).
Et puis, en rentrant de cette virée dont le souvenir aurait dû être plus mémorable que mes angoisses, il y eut, je le crois, le « stress de la performance » : la publication va-t-elle plaire ? Être suffisamment « likée », appréciée par mes abonnés ?
À vouloir démontrer que le moment était parfait, j’ai oublié qu’il aurait pu l’être pour de vrai.
Choisir ses vacances en fonction de son « capital photographique »
Quand j’évoque mes recherches sur Instagram via l’option localisation, qui regroupe toutes les images capturées dans une même place to be (et bien sûr les posts qui ont récolté le plus de « likes » et commentaires sont les premiers affichés, ce qui accroît certainement un sentiment de frustration), je me sens un peu nulle, mais je sais que je ne suis pas la seule à agir aussi bizarrement.
D’après une étude menée en 2020, commandée par l’entreprise française du secteur de l’hôtellerie Homair1, et réalisée par l’institut Opinion Way, 54% des Français avouent choisir leur future destination de vacances en fonction du « potentiel photo » des images du site postées sur les réseaux sociaux.
Une autre enquête2 confirme le phénomène en affirmant que pour les 18-35 ans (regroupés dans le terme « millennials »), le « capital photographique » d’un lieu compte à hauteur de 40% dans leur choix de destination.
« Les flux Instagram ou Pinterest dictent alors les tendances et les lieux à aller voir, alors en troupeau tout le monde se suit en quête de la même image », déplore Anaïs Guyon3, auteure du blog voyage The Travellin’Side, qui a fait le choix de déconnecter durant ses séjours.
Les réseaux sociaux empêchent le lâcher-prise
Un troisième pourcentage révèle ce que peuvent ressentir les internautes devant de telles publications ensoleillées. 29% des parents interrogés par Opinium Research, pour Groupon4, confient ressentir un pic d’anxiété lorsqu’ils consultent les clichés estivaux des autres parents, publiés sur leurs réseaux sociaux.
33% sont également angoissés lorsque leur enfant évoque les photos des activités de leurs amis sur Facebook ou Instagram durant l’été. Autre donnée éloquente : 22% des interrogés pensent qu’ils doivent dépenser plus d’argent durant les vacances d’été pour faire bonne impression sur Instagram et Facebook. C’est dire la pression monstre que l’on s’inflige, le stress que génère cette exigeante mise en scène de nous-même, durant la période de l’année pourtant supposée dédiée la décompression, au lâcher-prise, au temps vacant.
Le triste constat s’applique aussi aux autres loisirs, qui engendrent la même pression. Peut-on aujourd’hui aimer la décoration sans créer son moon-board Pinterest, un compte Instagram dédié, ou une chaîne tuto YouTube ? Et la lecture, sans devenir « booktubeuse », ni suivre la tendance de poser avec son Gallimard (parce que les influenceuses parisiennes ont décidé qu’avec ses couvertures épurées, beiges et rouges légèrement bordeaux, les ouvrages de cette prestigieuse maison d’édition étaient le nouvel accessoire tendance) ? Et la musique, sans diffuser en live Instagram les concerts ?
Dans son titre « Égérie », Nekfeu rappe : « Il filme mes concerts au lieu de les vivre ». En « Nekfan » assumée, je suis allée l’applaudir seize fois en cinq ans, partout en France, avant qu’un virus bouscule nos quotidiens. À chaque fois qu’arrive cette punchline, j’observe le public à la caméra activée. J’imagine ces spectateurs autant mal à l’aise que moi face à ce rappel à l’ordre, aussi en train de filmer, et de me gâcher le plaisir de l’instant pour… quoi, au final ?
Pour prouver que l’on y était ? Et si l’on apprenait à attacher moins d’importance aux regards des autres ? Quitte à ce qu’ils imaginent que notre vie est ennuyante, au prétexte que l’on ne poste pas tout ce que l’on vit. Car paradoxalement, moins poster la rendrait probablement beaucoup plus riche ! On profiterait pleinement de l’instant, et l’on gagnerait d’autres précieux moments, jusqu’alors perdus dans la mise en scène de nos vies, diffusées sur nos plateformes.
La solution pour rehausser le plaisir serait alors d’admettre qu’un évènement existe, même s’il n’est pas posté, liké, commenté. Accepter aussi - pour ne pas se sentir frustré.es ou complexer face aux publications parfaites, qu’il s’agit de mises en scène irréalistes, non représentatives de la vie entière de celui qui les publie. Et si l’on sait pertinemment que l’on choisit la meilleure photo de nous au moment de poster, il est plus difficile de se dire que les autres font de même. Le réaliser constitue alors le premier pas pour se détacher de ce tourbillon.
1 Étude réalisée en janvier 2020 auprès de 1.008 personnes représentatives de la population française
2 Enquête réalisée par l’éditeur de livres scolaires Schofields et publiée dans le média britannique de voyage Travolution.
3 Extrait d’une chronique d’Anaïs Guyon dans le Huffington Post : « Blogueuse voyage, j’ai décidé de moins publier pour ne pas passer mon temps dans la spirale infernale d’Instagram »
4 « Les vacances d’été : source de stress pour les parents », sur Groupon.fr


