Internet, c’est free mais on n’a pas tout compris
Principe fondateur d’Internet, la gratuité pose aujourd’hui énormément de questions aux acteurs du secteur. Jusqu’à remettre en cause le modèle économique de certaines industries du numérique ? Retour sur un concept cher en explications.
Il faudrait les y voir. Richard Stallman et Éric Raymond ne se sont jamais affrontés en duel mais n’ont cessé de batailler pour tenter d’imposer leurs visions respectives. Le premier a lancé le projet GNU dans les années 80 qui donnera naissance plus tard à Linux. Le second a cofondé l’Open Source Initiative à la fin des années 90.
Ensemble, ils sont considérés comme les pères spirituels du logiciel libre. En plus d’avoir vu naître les débuts d’Internet, ils partagent un nombre incalculable de points communs, une philosophie du réseau ouverte, collaborative et décentralisée. Et pourtant, depuis plus de 20 ans, Stallman et Raymond s’écharpent sur un terme : le mot « free » 1.
50 nuances de gratuité
Gageons que le terme est ambigu. En anglais, il recouvre à la fois l’idée de gratuité et de liberté. Alors quand Stallman veut embrasser les deux, Raymond lui oppose un certain réalisme. Pour ce dernier, Internet peut être libre mais pas forcément gratuit, puisqu’il faudrait rapprocher les véritables acteurs du Net du monde des entreprises.
Sans doute caricaturale, cette opposition finira de dépeindre Richard Stallman en idéaliste et Éric Raymond en réaliste. Il n’empêche, aussi loin des États-Unis que de la communauté du logiciel libre, les discussions entamées par les deux gourous ne cesseront d’alimenter celles qui, aujourd’hui, tentent encore d’expliquer le concept de la gratuité en ligne.
Car en 2018, force est de constater que l’un des principes fondateurs du world wide web des années 90, est en passe d’être remis en question par quantité d’acteurs. Monde de l’entreprise, gouvernements ou auteurs de biens culturels se sont progressivement interrogés sur le gratuit jusqu’à jeter les bases d’une vraie question : stop ou encore ?
Même Tim Berners-Lee, considéré comme l’inventeur du Web, se disait « dévasté » par ce qu’était devenu sa création. En cause ? La surveillance, les discours haineux mais aussi la tyrannie de la publicité et le défaut d’accessibilité du réseau.
Au-delà des professionnels du numérique, les nuances de la gratuité ont également interpellé les usagers. Le slogan « Si c’est gratuit, c’est que vous êtes le produit » a notamment fait la lumière sur l’action des GAFA concernant la récolte et l’utilisation de leurs données personnelles.
Mais comment en est-on arrivé là ? Pour le savoir, il faut - comme bien souvent - revenir là où tout a commencé. Et revenir aux origines d’Internet, c’est d’abord raconter une histoire.
Il était une fois donc, une bande de technophiles biberonnée à la contre-culture hippie qui ourdissent un projet utopique : créer un réseau informatique dans lequel il serait possible de s’échanger des informations.
Les premières utilisations d’Internet sont fortement marquées par une culture de la liberté, de la gratuité, de l’ouverture. Dans leur article intitulé « Internet et la culture de la gratuité », Serge Proulx et Anne Goldenberg soulignent que « l’accès sans entrave à l’information et sa libre circulation (…) apparaissent comme les conditions sine qua non de réalisation de ce projet utopique ».
Pourtant, dès le milieu des années 90, deux visions s’affrontent : l’une qui considère l’usager comme un client (qui doit donc payer), l’autre - plus citoyenne - qui voit dans l’Internaute un acteur clé de la logique contributive du réseau. Les premiers théoriciens d’Internet se rangent en grande majorité derrière la seconde.
Pour Richard Barbrook, il s’agit d’« un projet social émancipateur ». Pour Michel Gensolen, c’est « la partie hors économie marchande qui est la raison d’être d’Internet ».
En 1996, le parolier du groupe de rock Grateful Dead, John Perry Barlow, édictera même une « Déclaration d’indépendance du cyberespace » fondée sur une volonté de faire d’Internet un espace d’échanges sociaux autogérés, accessible librement, indépendant des logiques commerciales ou étatiques. Le groupe de rock avait choisi, dès les années 80, de diffuser gratuitement l’enregistrement de leurs concerts.
« Il n’y a pas de repas gratuit »
À la fin des années 90, la bataille d’idées qui anime les relations entre Stallman et Raymond commence à se dessiner. Les critiques directes sur la prétendue gratuité du réseau essaiment dans les années 2000, notamment par l’intermédiaire des propriétaire de biens culturels qui dénoncent le piratage d’un grand nombre de créations artistiques.
Au cours de cette décennie, les autorités sont finalement appelées à une certaine forme de pragmatisme en encadrant la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI en France par exemple). Et puis en 2010, on serait soudainement passé d’un « Web de hippies », peu investi par les professionnels et empli de partage, d’ouverture et de gratuité à une nouvelle économie numérique, remplie de publicité et de ROI (Retour sur investissement).
En 2017, le marché de la publicité digitale a dépassé pour la première fois le palier des 4 milliards de dollars. Un an auparavant, Facebook triplait ses bénéfices avec 10 milliards de dollars de profits et Google affichait 20 milliards de dollars de résultat sur un chiffre d’affaires de 90. À l’aune de ces chiffres, il devient de plus en plus difficile d’envisager Internet comme un espace gratuit, indépendant des logiques commerciales.
Sur le Web, certains se mouillent et situent la fin du « mythe de la gratuité » dans les années 2010, au moment où « l’idée que tout était disponible et gratuit sur le Web était ancrée dans les habitudes des utilisateurs ».
Aujourd’hui, les Internautes auraient conscientisé que la gratuité était possible contre un échange : celui de leurs données personnelles (même s’ils sont de plus en plus inquiets quant à leur utilisation). Huit ans après, une chose est sûre : la plupart des gens savent que la gratuité a un prix. Un nouveau slogan a d’ailleurs été déterré pour le signifier, celui de l’économiste de Milton Friedman : « Il n’y a pas de repas gratuit ».
Reste que si les modèles de l’e-commerce et des services proposés par les GAFA commencent à faire l’objet d’une compréhension progressive, le concept de gratuité sur le Web continue de vampiriser celui des consommations culturelles.
En première ligne : l’industrie des médias. En décembre dernier, neuf patrons d’agences de presse européennes lançaient un cri d’alarme pour que les géants de l’Internet reversent une part de leurs recettes aux médias qui leurs fournissent du contenu.
Pour eux, « la gratuité est bien un mythe ». Et dans ce système économique « duopolisé » par Facebook et Google, tous les autres acteurs auraient d’ores et déjà « beaucoup perdu ».
Sur la Toile des solutions ? 1001 choses. De l’accès à l’information payant, aux logiques de freemium en passant par l’intervention de l’État. Il y a près de dix ans, dans son livre Entrez dans l’économie du gratuit paru en 2009, Chris Anderson, l’ancien rédacteur en chef du magazine Wired, dévoilait déjà quatre grands modèles du gratuit : le freemium, le modèle classique des subventions croisées, le marché de la publicité tripartite (programmes financés par des marques) et enfin les marchés non-monétaires souvent soutenus par le don.
Logique de marché, questionnements existentiels, recherche éternelle de modèle économique, monopole des GAFAM… dans toute son étendue, la gratuité sur Internet aura quoi qu’il en soit échappé aux idéaux libertaires des pères fondateurs. 30 ans après, elle pose encore beaucoup de questions aux acteurs du secteur numérique. Et tout porte à croire que les querelles lancées par Stallman et Raymond autour de sa terminologie se transforment en vraie controverse collective.
1 “Libre” ou “gratuit”.

Municipales et e-citoyens : je clique donc je suis ?
À l’orée des Municipales de mars prochain, de plus en plus de listes ont placé des projets de participation citoyenne en ligne au coeur de leur programme politique. Mais pour quoi faire ?
Depuis 8 ans, Marion laisse passer les élections comme un mauvais rhume. La dernière fois, qu’elle a glissé un bulletin dans une urne c’était en 2012, au second tour de la Présidentielle. Puis, comme beaucoup, cette jeune designeuse de 32 ans en a eu marre de la politique. « J’ai l’impression que tout est devenu faux, anxiogène et futile », plaque-t-elle.
Et pourtant, il y a deux semaines, Marion a voté. C’était un dimanche, comme le veut l’usage. En revanche, la trentenaire parisienne ne s’est pas traditionnellement déplacée dans son école primaire. Elle a utilisé Internet, chez elle. Bien au chaud.
Mairie pop-in
En vérité, notre citoyenne n’a pas réellement participé à une élection. En se connectant au site du Budget participatif de la mairie de Paris, elle a simplement apporté sa voix à un projet d’éco-quartier dans son arrondissement, le 20ème.
Depuis que son frère l’a exhorté à user de son pouvoir citoyen sur Internet, Marion s’est peu à peu réconciliée avec la chose publique. « Je peux suivre le déroulé de la prise de décision jusqu’à sa décision finale. Bon, le projet qui m’a emballé n’a pas été retenu mais c’est comme ça ! », explique la jeune femme.
Sur le site, il y a la possibilité de choisir son combat parmi une douzaine de thématiques qui vont de l’éducation à l’environnement en passant par les transports et la propreté. Mais aussi, de consulter ceux qui ont été réalisés ainsi que des articles qui relatent le développement de chaque initiative.
C’est en 2015 que la mairie de Paris se trouve en mesure de permettre aux Parisiennes et Parisiens, sans condition d’âge ni de nationalité, de voter chaque année sur des projets proposés par les habitants eux-mêmes.
Relayée massivement sur les réseaux sociaux - notamment sur Twitter - la démarche est rapidement encensée comme un exemple de démocratie participative citoyenne en ligne. L’accroche ? Le Budget Participatif propose aux administrés de décider de l’utilisation de 5 % du budget d’investissement entre 2014 et 2020 (ce qui représente environ 500 millions d’euros).
Au fur et à mesure du mandat d’Anne Hidalgo - maire de Paris actuellement en campagne - la démarche ne s’essouffle pas. Bien au contraire. Un rapport publié en début d’année souligne qu’en 2019, plus de 143 000 citoyens ont voté. Une augmentation de 12 % par rapport à l’année précédente qui aurait permis la réalisation de 194 projets locaux.
L’administration de la capitale française ne compte pas s’arrêter là. En pleine campagne pour les Municipales dont le premier tour aura lieu le 15 mars prochain, Anne Hidalgo a présenté un programme ambitieux concernant la participation citoyenne en ligne.
Avec une promesse fracassante : porter la part du budget participatif d’investissement de 5 % à 25 %. Faisant ainsi de Paris la première capitale au monde à allouer autant d’argent à la prise de décision participative. « C’est un signe de plus que la ville de Paris est en avance en termes de civic-tech », précise un membre de la campagne d’Anne d’Hidalgo, contacté par téléphone.
« Changer le monde »
Pour mener à bien les opérations, l’équipe de campagne a fait appel à Cap Collectif, un portail déjà présent derrière la création du site du Grand Débat, qui avait rassemblé plus de 2 millions d’utilisateurs.
Si la ville de Paris et son landerneau de start-ups ès civic-tech semblent à la pointe de la démocratie participative numérique, qu’en est-il des autres villes en France à l’heure d’un scrutin majeur à l’échelon locale ? Une enquête relativement récente menée par la Caisse des dépôts permet d’apporter des éléments de réponse.
Selon l’institution, en 2018, 157 collectivités utilisaient des outils digitaux de participation citoyenne. Parmi elles, 9 régions, 14 départements, 18 métropoles ou encore 76 villes entre 5 000 et 100 000 habitants. D’après le même recensement, 67 villes auraient mis en place en 2017 un budget participatif.
De son côté, Cap Collectif rappelle sur son site certains grands moments de participation citoyenne numérique. Pêle-mêle : le lancement de la Fabrique Citoyenne par la ville de Rennes en novembre 2015, pour faire participer les habitants au budget participatif de la métropole ou encore une consultation citoyenne lancée par la nouvelle grande région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées au printemps 2016, qui a rassemblé plus de 160 000 participants pour aider les élus à trancher un nouveau nom : Occitanie.
L’ambition de « Capco » est aussi ambitieux qu’un programme présidentiel : « Changer le monde (…) en proposant une plateforme d’intelligence collective et une méthodologie de co-construction de la décision ». Il va bien falloir que Marion s’y fasse : même jeune retraitée de la vie publique, elle pourra toujours contribuer à dessiner le futur de la société. Tant mieux ?

Fracture numérique : les bricoleurs d’Internet
Face à l’inégalité d’accès au Net sur le territoire français, des bénévoles viennent en aide aux plus démunis en bricolant des connexions. Et tirent sur le fil d’un vrai enjeu de société.
Ils le crient littéralement sur tous les toits : « Internet ! ». Perchés sur des tuiles, dans l’Yonne, des techniciens à l’allure de charpentiers tapotent sur un ordinateur, règlent une antenne puis finissent par joindre les deux mains à leur bouche pour clamer haut et fort que, « c’est bon ! », le périmètre est couvert par une connexion.
Ils sont électriciens, antennistes, techniciens de réseaux, formateurs… mais dans ce département de Bourgogne-Franche-Comté, ils bricolent surtout Internet.
Sauver les campagnes
« On prend Internet là où il fonctionne pour l’emmener là où il ne fonctionne pas », explique Bruno Spiquel, l’un des bricoleurs du Web, à un journaliste de France 3. Depuis certains points de collectes à Joigny, Migennes, Sens ou Auxerre, il transporte avec d’autres une connexion qui fonctionne jusqu’à un endroit où il n’y pas de réseau.
Oubliez les ondes et les technologies sans fil, ces techniciens raccordent des antennes à l’ancienne, dont ils assurent le maillage grâce à des installations en altitude, « sur des églises, des silos agricoles, des poteaux ou encore des châteaux d’eau ».
Derrière cette petite bande d’artisans en baudrier, il y a une coopérative : Scani, dont le modèle est unique en France, assure Bruno Spiquel. Contacté par email, le membre bénévole de l’association précise à Mes Datas et Moi qu’il existe une structure similaire au Royaume-Uni et « peut-être une autre en Catalogne ».
Cela dit, Scani - qui comptait 650 membres actifs en août 2019 - fait partie de la fédération FDN (Fédération des Fournisseurs d’Accès Internet Associatifs, ndlr). Fondée en 2012, elle est une émanation d’une autre organisation, baptisée PC Light, dont les formations et autres tutoriels participaient déjà à rendre Internet plus accessible.
Avec Scani, Bruno et ses collègues comptent bien passer à la vitesse supérieure. « On fait un peu ça pour se marrer, continue-t-il, mais il y a un vrai problème de fond. »
Dans ce département situé à 2h de Paris, beaucoup de foyers se retrouvent encore sans connexion Internet. Scani leur vient directement en aide, en diagnostiquant leurs équipements, réalisant ensuite des tests de vitesse puis conseillant - en l’échange d’une participation à l’actionnariat de la coopérative de 10 euros - les habitants pour qu’ils puissent se tourner vers des fournisseurs d’accès indépendants, capables d’alimenter le territoire avec un bon réseau. Pour l’instant, la coopérative n’opère que dans l’Yonne et rend déjà service à pas mal de monde.
Dans l’article de France 3, un entrepreneur de la région confiait avoir gagné environ 20 % de temps de travail grâce à sa nouvelle installation. Scani rappelle souvent sur son site Internet que la problématique de l’accès au Net ne s’arrête pas à la frontière de la Franche-Comté. Dans une enquête publiée en mars dernier, UFC Que Choisir souligne que 6,8 millions de personnes sont « privées d’un accès de qualité minimale à Internet ». Soit l’équivalent de 10,1 % des consommateurs.
Cette discrimination face aux services numériques touche beaucoup plus fortement les zones rurales, les fameuses « zones blanches ». En haut-débit (ADSL), les communes les plus « reculées » subissent en moyenne des débits 43 % plus faibles que les villes de plus de 30 000 habitants.
Dans les faits, si vous habitez dans une campagne qui souffre d’un manque d’accès, vous mettrez deux fois plus de temps à charger une vidéo et trois fois plus à afficher une bonne résolution d’image. UFC Que Choisir rappelle que l’inégalité face au haut débit est immense en France, puisqu’aujourd’hui, ce sont encore près de 13 millions de personnes qui sont privées ce que l’on appelle le « bon haut débit ».
Retour à la ligne
Une situation qui a conduit le défenseur des droits à parler de « fracture numérique ». Dans un rapport publié en janvier 2019, ce dernier rappelle les enjeux qui président à la fabrication d’une vraie démocratisation du numérique, à savoir l’égalité devant l’accès aux services publics, de plus en plus dématérialisés.
En France, rappelle-t-il, « près de 75 % des communes sont mal équipées, soit 15 % de la population » qui connaît de vraies difficultés quand il s’agit de remplir leurs démarches administratives. Au-delà des campagnes de l’Hexagone, on notera les difficultés des territoires ultramarins, qui ne bénéficient pas du tout des mêmes développements que la métropole ni en termes de réseaux, ni en termes d’offres.
Enfin, le défenseur des droits pointe le véritable souci social et culturel derrière la question de l’accès à Internet à l’heure où, indique-t-il, « le taux de connexion varie ainsi de 54 % pour les non diplômés à 94 % pour les diplômés de l’enseignement supérieur ».
Le diagnostic qui met en lumière ces fractures territoriales semble paradoxal au regard des annonces du gouvernement. Au début du quinquennat, le président de la République annonçait un Plan France Très Haut Débit visant à couvrir l’intégralité du territoire en très haut débit d’ici 2022, mais également à garantir un accès au bon haut débit pour tous d’ici 2020.
Présentes dans les 15 réformes clés du mandat d’Emmanuel Macron, « l’e-inclusion » prévoyait d’empêcher le décrochage de certains territoires français, en formant plus de 3 millions de personnes au numérique. Selon les chiffres de l’enquête de UFC Que-Choisir, nous en sommes encore loin. Depuis, l’État a doté un nouveau dispositif appelé Cohésion Numérique des Territoire de 100 millions d’euros.
L’idée ? Subventionner chaque foyer français jusqu’à 150 euros du coût d’équipement, d’installation ou de mise en service. Reste à savoir qui en bénéficiera avant 2022. Bien heureusement, une chose est sûre : si vous vous installez dans l’Yonne, vous pourrez toujours compter sur Scani.
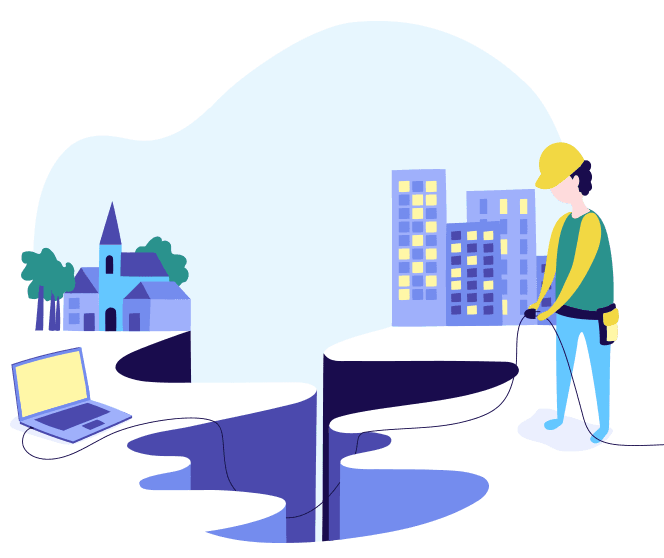
Internet et climat : la ligne verte
Malgré son potentiel collaboratif évident, Internet peine à faire éclore des projets écologiques d’envergure. Alors que les mobilisations se multiplient, certains jeunes acteurs du numérique comptent bien cultiver la Toile en terrains fertiles.
Généralement, l’écologie supporte mal les particularités. Il n’empêche, les faits viennent rappeler que les questions universelles qu’elle soulève peuvent télescoper des domaines bien spécifiques. Concernant le numérique, le choc est plutôt violent. C’est bien simple : d’ici 15 ans, le changement climatique va mettre fin à Internet. Point de collapsologues1 derrière cette assertion mais une équipe de chercheurs des universités de l’Oregon et du Wisconsin aux États-Unis.
En étudiant l’élévation du niveau de la mer, leurs résultats montrent qu’un certain nombre de villes côtières telles que New York, Miami, Seattle ou encore Los Angeles seraient immergées dès 2030 et avec elles, quelque 6 000 kilomètres de câbles de fibre optique et plus d’un millier de centres de maintenance. De quoi noyer Internet.
Le Web, responsable
Ce n’est pas la première fois que la planète menace l’équilibre 2.0. En 2015, les serveurs du deuxième plus grand fournisseur d’accès australien ont lâché suite à une vague de chaleur. La tempête Sandy à New York ou l’ouragan Irma en Floride avaient aussi largement perturbé les connexions dans toute l’Amérique duNord.
Au fur et à mesure que la planète seréchauffe, un aréopage d’experts en convient : le Web fondra bientôt les plombs. Alors que faire ?
Certains ont d’ores et déjà pensé le problème à l’envers en sensibilisant le grand public à leur empreinte carbone en ligne. Ce, dans une relative confidentialité. Combien sont-ils encore à ignorer qu’un e-mail génère en moyenne 10 grammes de CO2, l’équivalent du bilan carbone d’un sac plastique ?
En 2025, on estime que les data centers - qui stockent entre autres vos emails – contiendraient 175 zettaoctets de données, soit 175 milliards de téraoctets.
Nul besoin de faire le calcul pour réaliser que le monde numérique est tout aussi responsable que n’importe quelle autre industrie polluante de la dégradation de conditions de vie sur Terre.
Le duo de Youtubeurs derrière Greenweb, la série qui pointe les dégâts écologiques provoqués par le Web, rappelle qu’au Ghana, l’espérance de vie des jeunes qui travaillent sur la plus grande décharge de déchets numériques du monde est de 25 ans.
Assez terrifiant. Néanmoins, dans le sillage des mobilisations de plus en plus denses pour le climat, différents acteurs sont en train de tisser une Toile éco-responsable. Après avoir pointé le coût énergétique d’Internet, de jeunes startups s’attèlent désormais à penser la transition écologique du numérique.
En 2015, à l’orée de la COP 21, Elliot Lepers imaginait déjà une sorte d’assistant personnel - 90 jours - pour réconcilier les citoyens avec les bonnes pratiques, simples et basiques, qui préservent l’environnement. Depuis, des plateformes d’échanges de bonnes pratiques comme Tinkuy, des capteurs de pollution comme Plume Labs ou des annuaires du « consommer responsable » comme Le Marché Citoyen ont essaimé en France.
L’objectif de ces applications ? Rendre tangibles les petits gestes éco-compatibles du quotidien. Convaincus que les dynamiques collectives peuvent déplacer des montagnes, ces jeunes startuppers ont fait fleurir une constellation d’auto-entraînement en poussant les utilisateurs au changement grâce aux outils numériques.
Concrètement, Koom - la plateforme de crowdacting sur le développement durable - a convaincu 2 000 personnes de recycler leur vieux téléphone en l’envoyant à une entreprise sociale. Résultat : une économie faramineuse en termes de ressources nécessaires à la fabrication de portables neufs et deux emplois en insertion maintenus.
Le Wikipédia de l’écologie
Si les jeunes boîtes se mettent au vert, ces actions en faveur de l’environnement sur le Net restent des zones grises pour la plupart des gens.
Laur Fisher, chercheuse au Centre pour l’Intelligence Collective du MIT, a lancé en 2016 une plateforme de discussion en ligne où 50000 contributeurs travaillent ensemble à sélectionner les meilleures propositions pour résoudre le changement climatique.
Depuis Genève, elle rappelle que bien que nous soyons conscients depuis 40 ans du problème climatique, nous n’avons pas fait d’avancées importantes pour réduire nos émissions de carbone. Or, ces 40 dernières années sont aussi celles du développement informatique et numérique.
Que s’est-il passé ? Essentiellement, des promesses non tenues. Alors qu’à ses débuts, Internet irradiait de sa culture numérique et du potentiel collaboratif qui en découle, force est de constater que l’on cherche encore les projets écologiques d’envergure en ligne.
La trentaine à peine, Laur Fisher n’a toutefois pas encore eu le temps d’être désenchantée. En Suisse, elle abonde : « Un jour, comme pour Wikipédia, il y aura aussi une musique pour célébrer les propositions autour des solutions climatiques. Ce sera la symphonie du monde qui se réunit pour résoudre le problème du changement climatique. »
Lorsqu’elle découvre la force collégiale de Wikipédia en terminant un projet de recherche, l’étudiante au MIT prend conscience qu’elle peut enfin joindre son engagement écolo à l’intelligence collective virtuelle.
En 2015, elle crée Climate CoLab, un site où les idées responsables de milliers de bénévoles viennent épouser l’expertise de centaines de spécialistes. L’objectif est de déconstruire les problèmes climatiques complexes en sous-ensembles pour ensuite prendre en compte les solutions de la communauté, évaluées par des experts.
Si la plateforme revendique 50 000 contributeurs en 2016, elle en compte désormais plus de 115 000, représentant tous les pays du globe. Aujourd’hui, Climat CoLab réclame la paternité d’un dispositif conçu pour améliorer l’efficacité des panneaux solaires de 30% ou encore une solution de compensation des émissions carbone du transport maritime (qui représente 80% du fret mondial).
Finalement, ne serait-ce pas la culture numérique au sens large qui rendrait les espaces 2.0 fertiles ?
« La culture numérique montre dans ses façons même d’innover combien elle peut contribuer à la transition écologique, explique Daniel Kaplan, cofondateur de la Fing (Fondation internet nouvelle génération, ndlr) et spécialiste des transitions numériques. L’engagement, l’agilité, l’ouverture, la coordination ouverte sont des valeurs de la transition numérique qui doivent nourrir la transition écologique. La collaboration outillée par le numérique est la valeur clef de l’engagement qui permettra à la transition écologique de se réaliser. »
Internet porterait-il en lui les germes d’une révolution écologique ? Pour beaucoup d’acteurs,le réseau en a toujours disposé. Reste à affirmer un potentiel de quatre décennies à l’aune d’une problématique environnementale qui fait se soulever de plus en plus de monde. Surtout quand la mer monte.
1 Adeptes de la collapsologie, néologisme désignant l’étude de l’effondrement de la civilisation industrielle.

La Covid-19, point de fracture numérique ?
Il semblerait bien que la pandémie ait révélé de fortes inégalités entre les gagnants et les perdants du numérique en France. Mais en les mettant en lumière, la Covid-19 a aussi favorisé un réseau d’anti-virus solidaires. Autopsie.
Parce que les assiettes sont sales mais que la nappe est belle et que l’ombre du noyer strie parfaitement le plateau des tasses à café, vous décidez d’immortaliser ce moment. C’est une bonne photo, la meilleure de votre séjour. Elle s’intégrera parfaitement dans le fil d’actualité de vos créations champêtres. Mais si le cliché a le charme d’autrefois, votre connexion Internet aussi. Et tout à coup, c’est la panique. Vous voilà en train d’arpenter les quatre coins de l’hectare de terrain à la recherche de barres de vies numériques. C’est une question de temps avant que votre photo ne suffise aux contraintes de l’instantanéité. Tant pis si vos amis attendent et que votre café refroidit.
Skypéros, trafic et néolibéralisme
Vous vivez un (mauvais) moment caricatural mais détendez-vous, ces quelques minutes ont une vertu : vous faire prendre conscience de la réalité quotidienne de celles et ceux qui cherchent toujours du réseau, et qui pendant les longs mois de confinement, ne pouvait pas se vadrouiller pour en trouver.
Pour beaucoup, les mois à l’isolement qui ont jalonné nos vies à l’épreuve de la pandémie de Covid-19, n’ont fait que révéler une quasi-inébranlable fracture numérique. Comprendre : l’exclusion de l’accès et de l’utilisation d’Internet de certaines catégories de la population française.
D’après les premières estimations d’une étude Netscout (réalisée à partir des données des fournisseurs d’accès à internet français), le trafic internet a augmenté d’environ 30 % pendant le confinement. Le télétravail, les commandes en ligne, le e-commerce, les « Skypéros » et le binge-watching ont considérablement garni les bandes passantes de l’Internet. Ces dernières auront permis à des millions de Français de prendre l’autoroute du Web avec ses 1 001 fenêtres sur le monde, que l’on peut ouvrir depuis son canapé. En revanche, elles auront aussi laissé quelques millions d’autres sur le bas-côté, boutés par définition hors du « monde d’après » 3.0 puisque incapables d’y entrer. Vous l’aurez compris, l’ère numérique pendant le Covid-19 ressemble à une bonne vieille théorie critique du néolibéralisme : elle privilégie les privilégiés pour démunir les démunis.
Les raisons de la colère
À la fin de l’année 2019, l’INSEE établissait à 17 % la part de la population française touchée par « l’illectronisme », définie comme l’incapacité d’une personne à utiliser Internet. Dit autrement, une personne sur cinq est incapable de communiquer via Internet en France. Dans la même étude de l’INSEE, on apprend aussi que ce sont les plus âgés, les moins diplômés et les revenus modestes qui sont les plus touchés. Près de quatre mois après le jour du déconfinement, plusieurs experts sont en mesure de détailler les éléments qui couvent derrière l’e-exclusion de ces populations.
Premièrement, un calque géographique. Si au troisième trimestre de 2019, le gouvernement s’enorgueillissait de réels progrès quant à l’aménagement numérique du territoire, son Plan France Très Haut Débit laisse encore apparaître de nombreuses zones blanches : des lieux où aucun réseau n’est disponible. À savoir qu’un Français sur deux, résident hors des grandes villes, n’estime pas sa connexion satisfaisante selon le PDG de Capgemini. Or, ce sont souvent dans ces endroits de l’Hexagone que vivent les Français marginalisés cités plus haut.
Deuxièmement, des conditions d’usage. L’illectronisme renvoie en premier lieu à l’incapacité à s’emparer d’un outil technologique qui creuse le fossé entre les générations. Selon une étude des Petits Frères des Pauvres et de l’Institut CSA, 27 % des personnes de 60 ans et plus n’utilisent jamais Internet.
Troisièmement, des raisons économiques. Si l’on pense directement aux populations rurales et aux personnes âgées, on considère moins qu’une personne aux revenus modestes - même si elle réside dans une métropole hyperconnectée - accuse le coût du Web. Or, dans la tranche d’âge 22-36 ans, 56 % des non-connectés depuis plus d’un an déclarent que le coût de l’équipement ou de l’abonnement est la raison principale pour laquelle ils ont décroché des réseaux.
Plusieurs témoignages récoltés au mitan du confinement soulignent cette dernière tendance. Privés de tiers-lieux tels que les bibliothèques ou les cybercafés, des familles entières se sont retrouvées démunies. Comme cette femme interrogée par le jdd.fr qui n’a qu’un smartphone pour un foyer et qui déclare que « 60 % des familles autour d’elle n’ont pas d’ordinateur ». Dans ces conditions, impossible de télétravailler ni même d’assurer la continuité pédagogique des enfants. Plus grave encore, impossible de faire son deuil comme le rapporte une jeune femme à l’AFP : « Mon père est décédé du coronavirus, mais je ne l’ai su que 10 jours après parce qu’on nous a envoyé un mail ».
Solidarité chérie
La crise de la Covid-19 aura permis de révéler les grands enjeux qui campent au fond de la fracture numérique française… Avant de mettre en lumière les actions solidaires orchestrées par une multitude d’acteurs sur le territoire. Face à un défi de société, plusieurs organisations ont d’abord aidé les personnes « illectrées » à pouvoir recevoir des équipements à la faveur de dons. Fort de son engagement passé sur la question, Emmaüs Connect a lancé un dispositif baptisé « Connexion d’urgence » qui a déjà permis de récupérer plus de 500 équipements. La Fondation Simplon et le Collectif d’entreprises pour une économie plus inclusive en France ont aussi imaginé « Gardons le lien » qui vise à rompre l’isolement des personnes vulnérables et rassurer leur proche. Des tablettes ont ainsi été distribuées dans les EHPADs et les hôpitaux pour que les personnes âgées puissent communiquer avec leur famille.
Des actions antérieures à la crise sanitaire peuvent aussi porter leurs fruits comme « Mon centre social à la maison », une plateforme cofinancée par l’Union européenne depuis 2017 qui propose des ressources éducatives, des tutoriels mais aussi des permanences téléphoniques pour accompagner les gens dans leurs démarches. Citons enfin une initiative de l’Armée du Salut sur un public spécifique mais également touché par la fracture numérique : les sans-abris (dont seulement 50 % possèdent un téléphone portable). L’association a mis en place un dispositif intitulé « Free plugs » qui permet aux personnes qui sont à la rue de recharger leur téléphone. Des habitants d’immeubles situés au 1er ou au 2ème étage pouvaient laisser dépasser une rallonge électrique de leur fenêtre.
En sus des efforts consentis pour mailler l’ensemble du territoire avec ses connexions haut débit, le gouvernement a aussi tenté de se joindre aux actions solidaires. Ainsi la Med Num - acteur de la médiation et de l’inclusion numérique - avec le soutien du secrétariat d’État chargée du Numérique - a mis en ligne un site : solidarite-numerique.fr. Y figurent des ressources pratiques dans le cadre professionnel et personnel, pour se former simplement aux outils numériques mais aussi des réponses à des questions comme : comment faire mes courses en ligne ? Comment télécharger mon attestation de sortie ? Ou encore comment effectuer mes démarches auprès de Pôle Emploi ?
Depuis le début de la crise sanitaire, le virus a toujours fait l’objet de considérations ambivalentes. Car en mettant le doigt là où cela fait mal, il aussi permis à des réseaux d’acteurs de travailler ensemble et de mutualiser les efforts pour réduire la fracture numérique. Pour faire une belle jambe à tout le monde ?
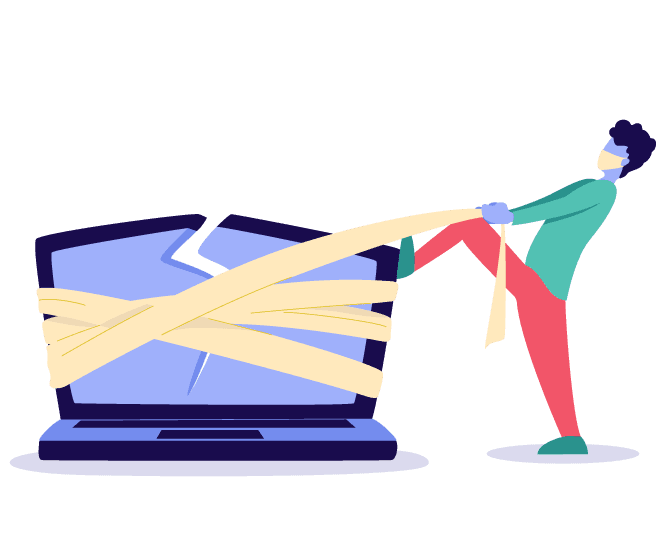
Estonie : le paradis du numérique (1/2)
Au Nord-est de l’Europe se trouve un petit pays dont la France aimerait s’inspirer. Bonne idée, car dans le domaine du numérique, l’Estonie est la championne du monde toutes catégories. Exploration d’un État nation qui a tout compris avant les autres.
Il y a parfois du bon à gouverner sous Jupiter. À l’abri des regards, chercher sa bonne étoile s’apparente à la traversée d’un fleuve tranquille. Pour Édouard Philippe, les planètes se sont alignées les 28 et 29 juin derniers. Alors qu’Emmanuel Macron nage en plein état de grâce, le Premier ministre peaufine sereinement son agenda diplomatique. Et décide de s’envoler pour l’Estonie.
Dans le jargon, on appelle ça « un geste fort ». Car c’est bel et bien dans ce petit pays d’1,3 millions d’habitants, situé sur la rive orientale de la mer Baltique, qu’Edouard Philippe a réservé son premier voyage officiel en tant que chef du gouvernement français. Sans triomphe, ni prééminence. Lors de sa rencontre avec le Premier ministre estonien, Jüri Ratas, il effectuera même quelques révérences et confiera que l’ensemble de la délégation française est venue jusqu’ici pour une seule chose : en prendre de la graine.
Simple comme une mise à jour
« La réalité estonienne, c’est l’objectif français en matière d’e-administration d’ici 2022 », annonce Édouard Philippe pendant la conférence de presse avec son homologue. De retour en France, lors de son discours de politique générale devant l’Assemblée nationale, il répète que l’Estonie a cinq ans d’avance dans le domaine du numérique. Les « gestes forts » ne cachent plus une ambition qui sonne désormais comme un aveu : il faut faire de ce pays de l’ancien bloc soviétique un modèle. Mais pourquoi ça ? Parce que l’Estonie est considérée comme le pays le plus le plus avancé au monde sur les questions numériques.
Depuis son indépendance en 1991, le gouvernement n’a cessé d’innover dans le secteur jusqu’à présenter, 26 ans plus tard, des chiffres qui frisent l’insolence. Aujourd’hui, 96% des échanges avec les services publics se font en ligne, 95% des Estoniens payent leurs impôts sur Internet, 100% des médecins recourent à l’ordonnance en ligne, 30% du corps électoral vote sur le Net…
Et ce n’est pas fini. Car le pays qui a enfanté Skype, actuellement en charge de la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne, compte bien afficher ses atouts aux yeux du monde entier. Fin 2014, le gouvernement estonien annonçait la création de son « e-résidence » qui permet aux entrepreneurs étrangers de bénéficier de l’accès à tous les services web du pays. Objectif : attirer 10 millions de « digital nomads » en 10 ans.
À l’heure actuelle, 21 000 personnes auraient été séduites par la simplicité du programme, et pour cause ! On estime par exemple qu’il faut compter 20 minutes pour monter son entreprise en Estonie. Un passeport et une centaine d’euros suffisent, le reste est intégralement couvert par l’administration.
La limpidité du système estonien ne convainc pas que des entrepreneurs. Arnaud Castaignet était l’un des anciens conseillers au numérique de l’Elysée. Profitant d’une visite entre François Hollande et la présidente de la République d’Estonie, Kersti Kaljulaid, le jeune français de 30 ans ne tarde pas à envisager un exil vers l’est européen. Aujourd’hui, Arnaud est responsable des relations publiques du programme de l’e-résidence, à Tallinn, la capitale. « Lorsque le gouvernement a retenu ma candidature, l’administration m’a dit qu’il fallait compter quatre jours pour s’occuper de mes démarches, confie-t-il. Le lendemain, tout était réglé. »
En deux mois, Arnaud Castaignet a déjà eu le temps de mesurer la différence qui existe entre l’Estonie et la France en matière de culture numérique. Il évolue au milieu de Canadiens, de Britanniques, d’Américains. La plupart ont moins de 30 ans. Et quand il faut délivrer, les ministres d’État lui répondent en direct sur WhatsApp ou Messenger.
« Les solutions digitales définissent ce que nous sommes »
« On surnomme souvent notre pays e-Estonia pour illustrer à quel point les solutions digitales font partie de notre quotidien. Elles définissent désormais ce que nous sommes, en tant que citoyens, entrepreneurs ou cadres de l’administration. ». Siim Sikkut ne s’y trompe pas. Le directeur des systèmes d’information (CIO) de la République d’Estonie sait bien que le savoir-faire numérique de son pays ne permet pas simplement d’attirer des investisseurs étrangers. « L’objectif est de créer une meilleure société, reprend-t-il.* Avoir un gouvernement et une économie plus efficaces apporte davantage de bien-être grâce aux bénéfices et au gain de temps que génère le digital.* »
Inutile de dire que le pays caracole en tête des classements internationaux, qu’il s’agisse de sa dette souveraine (qui représente 10% de son PIB) ou de son rang dans les enquêtes PISA. D’aucuns attribuent ces bons résultats aux innovations digitales. « C’est désormais avéré : le numérique permet à l’Estonie de boxer au-dessus de sa catégorie », glisse Arnaud Castaignet.
Mais comment un pays d’un peu plus d’un million d’habitants a-t-il pris autant d’avance sur un tel secteur d’avenir ? « Nous n’avons pas eu peur de prendre de risques en termes d’innovation, commence par éclairer Siim Sikkut. L’usage généralisé de la signature électronique (promulgué en 2000, ndlr) ou le vote Internet (introduit en 2005, ndlr) étaient inédits dans le monde. » Mais au-delà des initiatives audacieuses, l’Estonie n’a pas vraiment eu le choix. « En tant que petit pays avec très peu de ressources naturelles et une population vieillissante, il fallait tout mettre en œuvre pour avoir un État le plus efficace possible », continue le CIO.
Lire le 2e épisode consacré aux causes et contexte du succès estonien.

Le droit à la portabilité des données : les subtilités d’un nouveau pouvoir
Le 25 mai prochain, le Règlement général sur la protection des données encadrera un nouveau droit pour le citoyen, celui de récupérer ses données et d’en disposer comme bon lui semble. Mais comment en faire bon usage ?
En politique, les opérations de communication valent parfois mieux qu’un long discours. Mounir Mahjoubi le sait bien et ne s’y est pas trompé. La semaine dernière, le secrétaire d’État chargé du Numérique s’est offert un buzz dans le monde du digital : il a réclamé ses données personnelles auprès d’Amazon. L’ancien président du Conseil national du numérique a insisté sur la difficulté de l’expérience : « Ils ont mis sept mois à m’envoyer mes données. Il a fallu échanger plusieurs fois par mail. Ensuite, ils m’ont confirmé la réception d’un document signé, et j’ai reçu une lettre recommandée avec deux CD-ROM à l’intérieur ».
Responsabiliser les individus
Au micro d’Europe 1, Mounir Mahjoubi racontera également son histoire avec Uber. Si à première vue, l’opération semble pointer du doigt l’incurie des grandes plateformes du Web quand il s’agit de traiter des considérations liées à la vie privée, le vrai intérêt est ailleurs.
En se mettant lui-même en scène, le membre du gouvernement souhaitait faire la lumière sur un droit qui concernera bientôt tous les Européens : le droit à la portabilité des données. Instauré par le Règlement général sur la protection des données (dit RGPD) qui entrera en application le 25 mai prochain, ce droit permettra aux citoyens de récupérer leurs données auprès d’une organisation pour leur usage personnel ou de les transférer d’un organisme à un autre.
L’article 20 qui encadre ce droit à la portabilité des données a fait beaucoup de bruit au sein de la communauté du numérique. Les grandes entreprises auront fait pression jusqu’au bout pour pouvoir le modifier. Pourquoi ? Parce qu’il donne au citoyen un pouvoir qu’elles s’adjugent depuis longtemps : celui de mettre la main sur ses données personnelles, de les utiliser comme bon leur semble voire même d’en constituer une monnaie d’échange.
Le groupe de travail qui a participé à l’élaboration du droit à la portabilité le rappelle dans un document d’orientation : « Ce nouveau droit a pour objectif de responsabiliser les personnes concernées ». Il facilite leur capacité à déplacer, copier ou transmettre facilement des données à caractère personnel d’un environnement informatique vers un autre.
Le droit à la portabilité des données se distingue donc du droit d’accès, prévu par la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, qui permettait déjà à l’individu de demander directement au responsable d’un fichier s’il détenait des informations sur lui puis de les lui envoyer. Mais (presque) aucune obligation ne pesait alors sur les responsables du traitement. En d’autres termes, le droit d’accès renvoie au monde digital compliqué que décrivait Mounir Mahjoubi dans son expérience.
Demain, le droit à la portabilité vous permettra d’exiger de récupérer l’ensemble de vos données personnelles à travers une forme à la fois simple et lisible et dans un délai raisonnable (qui ne doit dans la plupart des cas pas excéder un mois à partir de la demande).
Un nouveau marché de la donnée personnelle ?
À partir du 25 mai 2018, toute entreprise qui possède certaines de vos données personnelles (réseaux sociaux, banques, assurances, club de sport etc.) sera donc tenue de traiter votre demande. Mais comme beaucoup de droits mis à la disposition du citoyen, l’administration peut craindre que ses administrés ne l’exercent pas. C’est la raison pour laquelle beaucoup d’organismes de défense du consommateur et certaines ONG s’appliquent à vulgariser les grands intérêts de la portabilité.
Première raison invoquée : l’aspect purement pratique. Admettons que vous vouliez changer de logiciel de mails. Nombreux sont ceux qui n’ont jamais passé le pas par peur de perdre tous leurs contacts. Demain, le RGPD leur permettra de migrer simplement leur carnet d’adresse d’un programme à un autre (comme si vous changiez d’opérateur téléphonique sans changer de numéro).
Deuxième atout du droit à la portabilité : la décentralisation du pouvoir sur les données personnelles. Comme invoqué par le groupe de travail sur le RGPD, le droit à la portabilité permettra de faire passer vos data des mains des entreprises qui les détiennent aux vôtres. Vous pourrez ensuite en faire ce que vous voulez, soit en les stockant dans un espace privé soit en décidant de les redonner à un responsable de traitement de votre choix.
Enfin, un argument plus libéral est souvent évoqué par les parties prenantes : la libre circulation des données à caractère personnel dans l’UE stimulerait la concurrence entre les organisations, renforcerait les possibilités d’innovation et de partage voire permettrait aux personnes de créer un nouvel écosystème de la data.
Ce dernier raisonnement est au cœur de l’action de certaines initiatives qui ont pensé l’accès, le contrôle et l’exploitation des données personnelles par l’individu bien avant la préparation du RGPD. Au Royaume-Uni, Midata 1 encourage depuis 2011 les services commerciaux désireux d’utiliser les data des citoyens. En France, c’est une initiative de la Fondation Internet Nouvelle Génération (FING), baptisée Mes Infos/Self Data, qui joue ce rôle 2. Elle a même publié un livret qui propose une manière d’organiser un projet de portabilité au sein d’une organisation.
Pour la FING, les opportunités sont nombreuses. En préparant un cadre dans l’entreprise consacré aux données personnelles, les sociétés pourront mieux responsabiliser leurs équipes et les préparer à sortir enfin de la confusion qui entourait la possession et la récupération de leurs données personnelles par des responsables aux motivations diverses.
Mais au-delà de ces projets sociétaux, le droit à la portabilité comprend aussi une grande part de risque. Éjecter des données personnelles complexes et sensibles pour les mettre dans les mains d’individus souvent non-sensibilisés aux usages, sujets au vol ou à l’escroquerie ou qui ne veulent tout simplement pas savoir qu’elles existent, peut s’avérer périlleux. Responsabiliser les citoyens suffira-t-il à faire du droit un bon usage ? C’est une question philosophique à laquelle Mounir Mahjoubi pourrait répondre par le début d’une autre histoire. Une histoire dans laquelle il est question d’« un grand pouvoir qui implique de grandes responsabilités ».
Consultez les autres articles et vidéos de notre dossier RGPD :
1 MyData/Midata : initiative britannique pour accéder, contrôler et exploiter ses données personnelles : http://www.cil.cnrs.fr/CIL/spip.php?article1645
2 Relire l’article de l’Observatoire sur le Self Data : https://www.mesdatasetmoi-observatoire.fr/article/le-self-data-une-nouvelle-economie-de-la-donnee
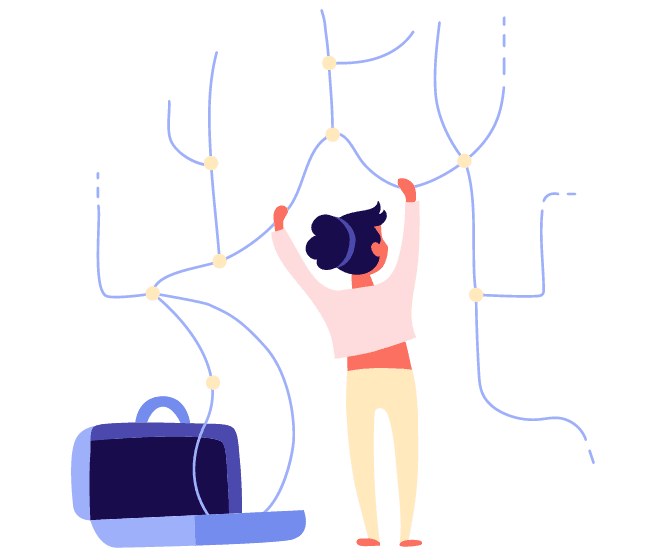
Innovations technologiques : les réseaux de la colère
Dans le « monde d’après », les débats sur le numérique se crispent autour de certaines innovations technologiques. Plus que toutes les autres, la 5G est perçue comme une menace pour l’environnement mais aussi pour notre intelligence. Explications.
Si nous sommes nombreux à ne pas savoir comment les fondations du monde d’après seront jetées, certaines surprises préfigurent déjà des lendemains qui changent. Comme, par exemple, le rétropédalage d’un grand patron français. Le 22 mai 2020, Martin Bouygues déconfine une pensée inattendue dans les colonnes du Figaro1. Sa tribune intitulée « La 5G n’est pas une urgence pour la France » plaide pour un report de la mise en place d’une technologie dont son groupe s’était pourtant fait l’un des fers de lance. Étonnant. Entraînant aussi, puisque les autres suivront. Quelques jours plus tard, c’est un autre opérateur, SFR, qui appelle à ralentir le pas dans la course à la cinquième génération des télécommunications.
On n’arrête pas le progrès
Les quatre coins du carré d’or des télécoms - SFR, Bouygues, Orange et Free - finiront tous par confier que le déploiement de la 5G n’est pas la priorité de l’État. Au sortir d’une crise sanitaire, la technologie serait même selon Bouygues « prometteuse mais loin d’être mature ». Pour eux, la France doit s’atteler à la reconstruction de son économie, et cela commence par déployer cette bonne vieille 4G dont un quart du territoire ne peut toujours pas profiter. Il s’agit donc de ralentir. Et de la bouche de capitaines d’industrie en 2020, la manoeuvre est rare, donc bienvenue. D’autant plus qu’elle fait justement écho aux nombreuses résistances récentes contre la mise en place de la 5G. En janvier dernier, les associations Priartem et Agir pour l’environnement avaient déjà publié une pétition signée par plus de 80 000 personnes2 et déposé un recours devant le Conseil d’État. Le 25 avril, une « Journée mondiale contre la 5G3 » s’est tenue en ligne, en plein confinement. Et depuis mai, partout en Europe, des manifestations voire des saccages d’antennes relais dénoncent le danger de la technologie sur l’environnement ainsi que sur la santé des populations.
Pour les opposants à la 5G, il est d’abord question d’urgence écologique. Dépasser les 4G, déjà énergivore, ce serait enfoncer le clou d’une économie déraisonnée dont la surconsommation signerait l’arrêt de mort du « vivant ». Une preuve irréfutable que nos sociétés n’auraient retenu aucune leçon pendant le confinement. Pour les conspirationnistes, c’est un argument de plus qui expliquerait un lien évident entre le déploiement de la 5G et la propagation du Coronavirus. Face à la pression, le président de l’Arcep (l’Autorité de régulation des communications électroniques, des Postes et de la distribution de la presse) se fendra lui aussi d’une tribune sur Reporterre4. « Plus la vitesse de nos communications s’accroît, plus nous avons l’impression que la technologie nous échappe, et nos vies avec. Depuis quelques mois, la 5G est devenue la cible de ces critiques », balise-t-il. Sébastien Soriano déconfine alors à son tour une idée-surprise : le lancement d’une plateforme de travail « pour un numérique soutenable ». L’idée ? Assujettir le déploiement des réseaux à un contrôle citoyen par la mise en place de plusieurs ateliers, comme une sorte de convention citoyenne pour le numérique. Avec sans doute beaucoup moins de médias autour.
Histoire de notre bêtise
Qu’importe, le président de l’ARCEP l’a bien compris : à travers les critiques contre la 5G, c’est un débat de société que l’on prépare. Alors qu’on cherche encore les rapports officiels et légitimes sur les risques écolo et sanitaires des innovations technologiques, certains se posent d’autres questions : a-t-on véritablement besoin de la 5G ? C’est en tout cas, mot pour mot, l’une des problématiques contenues dans les conclusions5 de la très médiatique convention citoyenne pour le climat qui réclame un moratoire sur la 5G. Un peu plus tôt, le 16 juin dernier, le maire de Bourg-en-Bresse et secrétaire national du Parti socialiste, Jean-François Debat, allumait déjà une mèche dans Libération6 : « Non, la 5G n’est pas un progrès indiscutable ». Dit autrement, oui, on peut arrêter le progrès. Un progrès qui créerait des besoins artificiels selon l’élu, dans le seul but de satisfaire l’appétit de l’industrie mondiale. Débat posé : « Nous avons certainement besoin de développer la télémédecine, qui serait bénéficiaire de la 5G. Pour autant, avons-nous besoin de monter le chauffage chez nous à distance, de réfrigérateurs ou de fourneaux connectés, de montres-ordinateurs à nos poignets ? ». Car qui a encore le temps d’ouvrir sa porte de frigo ou de regarder l’heure ?
Dans un article de 20167, Le Nouvel Économiste intronisaient les « techno-sceptiques », ces gens qui pensent que les nouvelles technologies ne produisent au mieux que du vent, au pire que des besoins inutiles. Depuis quatre ans, ces pessimistes modernes ont théorisé des concepts comme le « confort marginal » dont la technologie se servirait pour orienter nos actes d’achats vers des nécessités superflues. Pour eux, la 5G, ses objets connectés et ses voitures autonomes seraient la dernière vitesse d’une économie galopante qui se consacre uniquement à nous faire céder à la plus grande faiblesse du genre humain : la fainéantise. Dans son livre The Rise and Fall of the American Growth (2017), l’économiste américain Robert Gordon donne bien le change : « La révolution informatique est une diversion mineure par rapport aux inventions qui ont accompagné la deuxième révolution industrielle – électricité, voitures et avions ».
Un argumentaire proche du concept de « bêtise systémique », popularisé par Bernard Stiegler dans son ouvrage de 2009, Pour une nouvelle critique de l’économie politique. D’après le philosophe français, le capitalisme s’appuie tellement sur les nouvelles technologies qu’il parvient à priver la population de toutes les formes de savoir. C’est Google Maps quand vous cherchez votre chemin, c’est la caméra de recul de votre nouvelle voiture quand vous voulez faire un créneau ou votre correcteur orthographique quand vous écrivez un texto. Pour Stiegler, en plus d’épuiser les ressources naturelles de la planète, le progrès technologique consume notre attention. La solution ? Vieille comme le monde et aussi efficace qu’une prise de judo : utiliser le potentiel d’intelligence collective que ces nouvelles technologies recèlent pour créer un certain pouvoir de la connaissance. Cela a même un nom : la « noopolitique ». Mais avant de savoir si le monde d’après produira de la « bêtise systémique », consolons-nous avec un fait : la 5G fait déjà beaucoup réfléchir.
–
1 «La 5G n’est pas une urgence pour la France: repoussons l’attribution des fréquences» Martin Bouygues, publié le 22 mai 2020 sur Le Figaro
2 «Stop à la 5G», pétition sur le site Agir pour l’environnement
3 «Favorables à la 5G, nous souhaitons tout de même un contrôle citoyen», Sébastien Soriano, publié le 12 juin 2020 sur Reporterre
4 «Réseaux et environnement», publié le 11 juin 2020 sur le site de l’Arcep
5 «5G : pour un vrai moratoire», publié le 22 juin 2020 sur le site de l’association P.R.I.A.R.T.EM
6 «Non, la 5G n’est pas un progrès indiscutable», Jean-François Debat, publié le 16 juin 2020 sur Libération
7 «Les techno-sceptiques attaquent», publié le 4 novembre 2016 sur The Economist
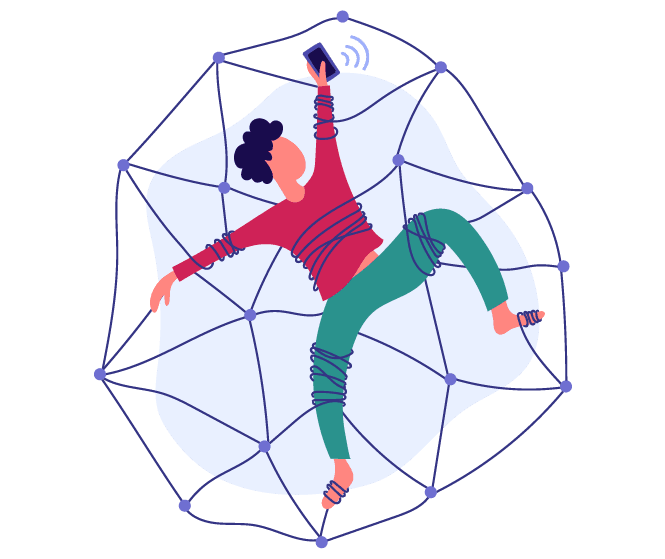
Numérique au travail : l’informatique, c’est pas automatique ?
Encore beaucoup d’études soulignent de nettes lacunes informatiques dans le monde de l’entreprise jusqu’à faire émerger un terme : l’incompétence digitale. Mais quelle est la véritable ampleur du phénomène ?
Le milieu de l’informatique a ses légendes. Des grands hackers qui se glissent dans les systèmes du Pentagone aux e-chevaliers blancs qui sauvent la démocratie en diffusant des informations classifiées, Internet regorge d’histoires fabuleuses. Mais loin du « Web of fame » 1, il y aussi Julien du service commercial qui n’arrive pas à se dépêtrer d’un rapport plutôt compliqué avec le digital.
Julien 2 est jeune trentenaire, membre de la génération Y dite des « digital natives » quotidiennement confrontée aux usages numériques et pourtant, chez lui, l’informatique n’est pas vraiment automatique. Commercial dans une grande société, il n’a pas « coulé la boîte » mais « a multiplié les bourdes » qui aurait pu mettre en péril l’entreprise.
Ses erreurs ? Avoir pris en photos ses chiffres en réunion et les avoir envoyés fièrement par email dans une boucle composée de clients et de concurrents potentiels, avoir téléchargé des séries en streaming sur son ordinateur professionnel, ne jamais fermer les applications de messagerie interne sur son Ipad, etc.
Trouver le coupable
De son propre aveu, Julien n’est « pas assez vigilant ». Mais son cas est loin d’être isolé. Le phénomène de la mauvaise utilisation du numérique au travail a même donné lieu à un nouveau concept : l’incompétence digitale. Et dans le monde de l’entreprise, le terme fait grincer les dents puisque selon plusieurs études, son coût est évalué à plus de 2000 euros par an et par salarié.
Alors, quelles sont les causes de cette ignorance informatique ? Encore aujourd’hui, la documentation sur la cybersécurité du milieu professionnel fait reposer sur les employés des sociétés une lourde responsabilité. Selon les données sur les sinistres dont dispose une entreprise internationale de conseil, de courtage et de solutions logicielles, les négligences et les actes de malveillance des salariés seraient ainsi à l’origine de deux tiers des atteintes à la sécurité informatique.
En cause, des erreurs banales : le téléchargement d’un logiciel malveillant, le défaut de mise à jour d’un antivirus ou l’utilisation répétée d’un même mot de passe. Une autre enquête fait remarquer que 24% des salariés utiliseraient les mêmes identifiants de connexion pour leurs comptes personnels et professionnels, et que 96% d’entre eux enregistreraient automatiquement les mots de passe sur leur ordinateur de travail.
Et pourtant, si l’on s’intéresse de plus près aux tenants et aboutissants de l’incompétence digitale, faire porter le chapeau à des personnes en situation de délicatesse avec le numérique est un peu réducteur.
Tout d’abord, le dernier rapport du CLUSIF (Club de la sécurité de l’information français) à propos des menaces informatiques et des pratiques de sécurité en France, daté de juin 2018, souligne que « le nombre de personnes qui déclarent avoir subi la perte ou le vol de données sur un ordinateur au cours des deux dernières années est en diminution sensible ». Et de conclure : « De manière générale, les internautes ont conscience que leur comportement sur internet peut être facteur d’augmentation des risques qu’ils encourent ».
D’autre part, les plus grands scandales en date liés à la sécurité des sociétés ne sont pas vraiment le fait des employés. Si l’on prend l’exemple du [tristement célèbre piratage du site de rencontre canadien Ashley Madison](https://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/08/19/les-donnees-piratees-du-site-de-rencontres-adulteres-ashley-madison-publiees-en-ligne_4729818_4408996.html “Le piratage du site Ashley Madison et la question de la “moralité” des hackeurs”) en 2015 ou de celui des trois milliards de compte Yahoo en 2013, l’infiltration malveillante aurait résulté de la négligence de l’équipe dirigeante.
« Un ordinateur aujourd’hui, c’est comme un arbre de Noël »
Alors à qui la faute ? Pour Stéphane de Jotemps, la question est déjà mal posée. Le directeur des ventes de Skillsoft France 3 indique que faire porter la responsabilité à une catégorie d’acteurs empêche de penser le changement complexe des outils numériques. En clair, les raisons de l’incompétence digitale relèvent selon lui de la perpétuelle mutation de l’écosystème numérique avec lequel chacun doit traiter.
« Un ordinateur aujourd’hui, c’est comme un arbre de Noël, explique-t-il pour Mes Datas et Moi. Les applications sont des boules qui s’illuminent et changent tous les jours. » Comprendre : l’employé doit faire preuve d’une capacité d’adaptation quasi quotidienne pour s’emparer des nouveaux outils, en apprenant au fil de l’eau.
Or, le niveau de culture numérique n’est pas le même pour tous. Pour preuve, le secrétaire d’Etat en charge du Numérique, Mounir Mahjoubi, déclarait le 11 septembre dernier que « 20% des Français étaient encore démunis face aux outils numériques ». « Il y a des clients qui impriment encore leurs emails parce qu’ils veulent tout posséder, alors qu’il y a des nouveaux outils digitaux pensés pour leur faire gagner du temps », reprend Stéphane de Jotemps.
Cela dit, une fois la porte ouverte, de nouveaux défis s’amoncellent tant le changement est perçu comme une aventure dans le monde de l’entreprise. « Modifier la culture d’entreprise revient à attaquer l’Everest par la face Nord », confiait Sylvie Joseph, directrice du programme de transformation interne de La Poste. « Et en France, on n’est pas bons », poursuit Stéphane de Jotemps en faisant référence à notre niveau de culture web en deçà des standards internationaux.
En revanche, le directeur des ventes reconnaît que les entreprises ont enfin compris l’importance que recouvrait leur mue numérique : « Depuis 4 ans, je peux dire que la transformation digitale est au cœur de la stratégie des grandes entreprises. Tout simplement parce qu’elles ont bien compris qu’elles pouvaient mettre la clé sous la porte face à une start-up qui pouvait évoluer beaucoup plus vite. »
Dans cette conception binaire qui oppose salariés et entreprise, Stéphane de Jotemps préfère parier sur une responsabilisation collective. « L’omniprésence du numérique dans nos vies, le RGPD ou encore les nouveaux modes de transmission de savoirs qui empêchent les silos… tout ceci porte à croire que nous allons vers une volonté de mettre l’individu en compétence », détaille-t-il. D’autant plus que malgré les lacunes informatiques, la compréhension des enjeux impliqués est de plus en plus grande.
« Grâce à cette prise de conscience, on évite davantage d’erreurs car les gens sont de plus en plus vigilants. D’un côté le risque numérique est décuplé, mais de l’autre, les individus sont plus intègres. » Et si, avec ses bricoles, Julien avait finalement aidé sa boîte à se développer ?
1 Web des célébrités
2 Le prénom a été volontairement changé
3 Propose « une solution de formation pour développer les compétences bureautiques des salariés »
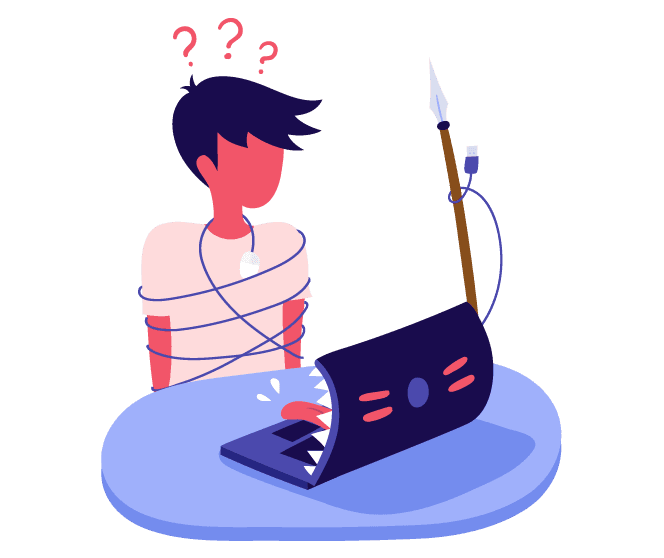
Numérique à l’école : quelles leçons en tirer ?
Sept ans après la création d’un service public d’éducation au numérique, l’enseignement se rapproche plus d’un tableau noir que d’une bonne note. Et pendant que le gouvernement tente de revoir sa copie, ce sont les GAFA qui semblent en profiter. Encore.
Nick ne comprend pas tout mais il sait reconnaître une bonne ambiance. Lorsque les voix de ses élèves prononcent « Bonjour », « Good morning » ou « Sabah-ul-khair », l’instituteur pressent qu’il est en train de cristalliser une portion de multiculturalisme dans sa classe. À l’école primaire Wilhelm Ferdinand Schussler de Düsseldorf, en Allemagne, Nick Kyriakidis change de langue tous les jours.
Parmi la vingtaine d’enfants que compose sa classe, ils sont une dizaine à détenir des origines différentes : syrienne, turque, irakienne mais aussi d’autres pays de l’Union européenne.
Sur les tablettes des GAFA
Le professeur des écoles ne parle pas plus de deux langues. Alors, pour assurer la conversation, il s’appuie sur les tablettes numériques d’Apple qui lui permettent de traduire en simultané les échanges. En vérité, cette expérimentation est le fruit d’un programme intitulée « The 1:1 iPad program » qui permet à tous les étudiants de l’école de posséder un iPad. À Düsseldorf, l’objectif d’Apple est ambitieux : « enseigner sans franchir la barrière de la langue » et « participer à l’intégration des enfants immigrés ou réfugiés ».
Selon l’entreprise américaine, depuis que l’établissement allemand a rejoint le dispositif, personne n’a redoublé. Dans une école de Malmo en Suède où 98 % des élèves ne parlent suédois qu’en deuxième langue, le programme d’Apple aurait permis 80 % de réussite en plus aux examens grâce notamment à des vidéos filmées avec une tablette. Enfin au collège Daniel Argote de Pau, en France, les enseignants transmettent les devoirs à faire avec des vidéos sous-titrées pour que les parents qui ne seraient pas à l’aise avec le français comprennent le contenu des cours proposés à leurs enfants.
La participation d’Apple aux programmes éducatifs numériques n’est pas isolée. Google vient de lancer un outil à destination des professeurs pour faciliter l’apprentissage du code en cours. Amazon a lancé un concours d’étudiants pour les formations digitales et Microsoft diligente des jeunes pour sensibiliser au numérique dans les classes.
Seul Facebook semble se tenir à l’écart des bancs de l’école. Mais qu’est-ce qui peut bien pousser les GAFA à investir le terrain de l’éducation numérique ? Pour les fédérations de parents d’élèves, cela ne fait aucun doute : il s’agit d’une politique volontariste pas très subtile pour habituer les enfants à tout un écosystème digital, dès le plus jeune âge. Le dispositif mis en place par chaque entreprise n’allant pas sans distribution de matériels et autres goodies.
Mais pour certains acteurs, cela traduit surtout une tendance lourde : la dépendance de l’école vis à vis de ces entreprises qui vient combler un vide inquiétant en matière d’éducation au numérique.
Des ordinateurs, des souris et des hommes
Comme un boomerang, les critiques sur le digital à l’école se concentrent justement sur la question des équipements personnels. Peu s’en souviennent, mais en mai 2015, le gouvernement français lançait « un plan tablettes ». L’idée à l’époque est de doter « 100 % des élèves en collège d’un outil numérique ». L’État engage un milliard d’euros sur trois ans et communique en grande pompe sur l’autonomie que suppose les tablettes dans les classes.
Sauf qu’au moment de faire les comptes, à l’approche de la rentrée 2018, le ministère de l’Éducation nationale s’aperçoit que seuls 43 % des collèges sont équipés et décident d’abandonner un dispositif qui coûterait beaucoup trop cher à mettre en oeuvre.
Quatre ans après, d’aucuns hésitent à stigmatiser le plan de François Hollande comme l’incarnation d’une erreur politique. La volonté d’individualiser l’éducation numérique et de s’échiner à penser que la formation à l’école et au collège s’élèverait grâce à des outils tactiles apparaît aujourd’hui comme un procédé coûteux et dépassé.
Malgré la conjugaison des appels de certaines associations comme La main à la patte (que nous interviewions en 2017) à privilégier la formation du personnel enseignant et les activités dites « débranchées », force est de constater qu’il reste beaucoup à faire. Si 80 % des professeurs se sentent à l’aise avec les outils numériques, moins d’un sur deux a bénéficié d’une formation spécifique depuis sept ans.
Un constat regrettable pour la Cour des comptes qui a publié en 2019 un rapport plein d’enseignements sur le numérique à l’école. L’institution rappelle que deux milliards d’investissement ont été alloués entre 2013 - date à laquelle le gouvernement français inscrivait le numérique à l’école dans la loi de refondation de l’école de la République - et 2017.
À la fin de la période, la dépense moyenne constatée des collectivités par élève s’élève à 34,5 euros pour un écolier, 77 euros pour un collégien et 82 euros pour un lycéen.
Les communes françaises ont dépensé quant à elle 62 % de leur enveloppe allouée au numérique éducatif dans les équipements contre 29 % pour les infrastructures réseau et 9 % pour le reste. Une orientation peu efficace quand on sait qu’aujourd’hui 88 % des jeunes de 12 à 17 ans possèdent un smartphone et 97 % une connexion Internet à domicile.
La Cour des comptes n’est pas la seule à fustiger l’absence de cadre exécutif dans lequel est censé s’inscrire ce service public à l’éducation numérique. Les enseignants eux-mêmes attendent encore un message clair de la part de leur ministère quant à la place du digital dans la pédagogie qu’ils exercent.
Au moment d’attaquer une nouvelle décennie, l’école française a encore d’immense défis à relever en matière d’apprentissage du numérique : la connexion des écoles et des établissements est encore insuffisante et même parfois inexistante, de fortes inégalités d’équipements des classes et des élèves persistent, les enseignants et les élèves se perdent encore dans la profusion de ressources numériques - abondante et souvent innovante - mais insuffisamment organisée en vue des usages.
Un chantier qu’il semble difficilement possible de tenir avant les délais de la fin du quinquennat d’Emmanuel Macron. À moins qu’Apple, Amazon ou Microsoft ne viennent en aide à l’Éducation nationale. Alors, choose France ?
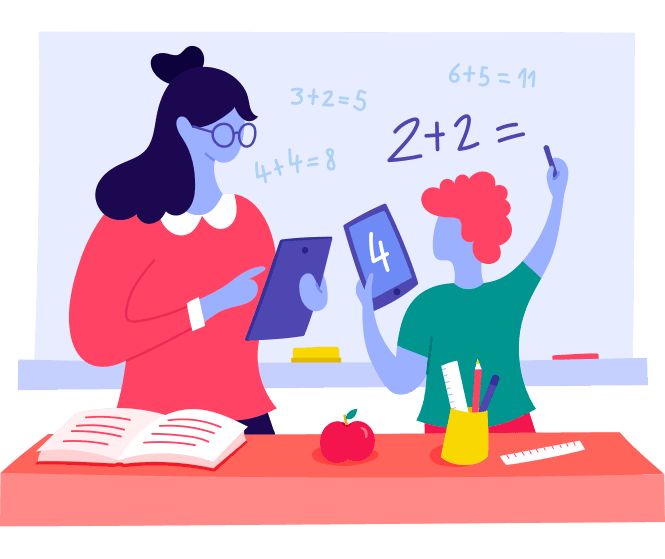
Deep learning : plongée dans les profondeurs d’une révolution
En 7 ans, le deep learning a conquis toutes les grandes entreprises du numérique. Aujourd’hui, le système lève autant de milliards de dollars que d’inquiétudes sur un futur à la Terminator. Mais au fond, c’est quoi l’apprentissage profond ?
Nous ne savons que trop peu précisément dater le déclenchement des révolutions. De la sienne pourtant, Yann Le Cun s’en souvient comme si c’était hier.
Il n’était pas sur place mais il raconte l’histoire au Monde comme s’il en avait été percuté : « Une révolution. On est passé d’une attitude très sceptique à une situation où tout le monde s’est mis à y travailler (…). Je n’ai jamais vu une révolution aussi rapide. Même si, de mon point de vue, elle a mis beaucoup de temps à arriver… ».
Proie à l’image
À l’époque, le chercheur parisien n’est pas encore le directeur du laboratoire d’intelligence de Facebook à Paris. À l’époque, cela fait plus de vingt ans qu’il tente de faire valoir l’importance essentielle du deep learning au sein de la communauté scientifique.
Dix ans auparavant, avec ceux qui deviendront ses plus proches collaborateurs - Geoffrey Hinton et Yoshua Bengio - Yann Le Cun est même considéré comme « à part ». Selon Le Monde, le trio se surnomme « la conspiration du deep learning ».
Mais un beau jour d’automne 2012, Hinton et deux de ses élèves de l’université de Toronto finalisent leur participation au célèbre concours de reconnaissance et de classification d’objets et de scènes dans les images naturelles d’ImageNet : l’ILSVRC pour ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge.
Pour mettre toutes les chances de leur côté, l’équipe canadienne a utilisé une méthode d’apprentissage profond qui permet à leur réseau de neurones d’identifier rapidement une série d’innombrables images.
Quelques semaines plus tard, ils apprennent que non seulement ils ont remporté la compétition mais qu’en plus, c’est la première fois que des participants parviennent à obtenir un taux d’erreur de moins de 25%.
Critère décisif du concours, ce taux d’erreur descendra par la suite à moins de 5%. Depuis la participation de George Hinton, son taux de réussite sera passé de 71,8% à 97,3%, surpassant ainsi les capacités humaines les plus folles.
Depuis, surtout, une révolution est en marche : celle de l’intelligence artificielle en général, et du deep learning (ou apprentissage profond) en particulier.
Yann Le Cun n’en démord pas. Toujours au Monde, il explique : « Je n’ai jamais vu une révolution aussi rapide. On est passé d’un système un peu obscur à un système utilisé par des millions de personnes en seulement deux ans ».
Que ce soit pour visualiser les numéros de rue dans Google Maps, identifier les images contraires aux conditions d’utilisation de Facebook ou détecter des tumeurs sur des images médicales, le deep learning est partout.
Grâce à lui, nous pourrions traduire les langues en temps réel, utiliser la parole pour commander des appareils, analyser le sentiment dans les évaluations des clients, détecter les mauvais comportements en voiture,…
Ce n’est pas pour rien que la méthode la plus hype de l’intelligence artificielle essaime dans toutes les grandes entreprises du numérique : Google, Adobe, Amazon, IBM, Microsoft. Symbole des fortunes engagées, le marché de ce qu’on appelle le machine learning représente aujourd’hui entre 5 et 7 milliards de dollars et pourrait caracoler à plus de 90 milliards en 2025.
Les vertiges d’un succès
Les chiffres de l’apprentissage profond donnent le vertige. Mais au fond, de quoi parle-t-on ? Le deep learning est une méthode d’apprentissage qui permet à un programme de représenter le monde, via l’image ou la voix par exemple.
Cette technique utilise la même approche que l’entraînement sur un enfant. De petites calculatrices artificielles fondées sur des logiciels sont reliées entre elles pour donner un fonctionnement quasi-similaire à celui des neurones du cerveau.
C’est en 1947 que l’on situe la première mention de l’apprentissage par une machine. Le terme de machine learning aurait été inventé par un pionnier du jeu sur ordinateur pour désigner « le champ d’étude qui donne aux ordinateurs la capacité d’apprendre sans être explicitement programmés à apprendre ».
Il faudra toutefois attendre les années 80 pour voir se constituer les premiers réseaux de neurones. Une décennie où l’on retrouve déjà Yann Le Cun qui soutiendra une thèse sur le sujet en 1987 et qui développera même un système de lecture de chèque assisté par une machine.
Après un manque criant de reconnaissance, le deep learning est aujourd’hui partout. Au choix, il commanderait les voitures et les avions, donnerait naissance à des assistants numériques personnels et rendrait la vue aux aveugles.
Mais le système s’est tellement généralisé qu’il fait peur. Dans un outing presque simultané, de grandes figures de la tech comme Bill Gates, Stephen Hawking ou Elon Musk ont exprimé leurs inquiétudes sur le risque lié à un manque de contrôle de l’IA.
À tel point que, comme une résolution, ils ont tous validé une charte de 23 principes pour une intelligence artificielle bienveillante en début d’année.
Par ailleurs, les machines n’ont pas tardé à dévoiler leur côté sombre. La nouvelle la plus embarrassante étant la faculté des logiciels à incruster des images de célébrités dans n’importe quel contenu, y compris des films pornographiques.
Si vous posez la question de la réalisation d’un scénario dystopique à Yann Le Cun, il vous répondra qu’à partir du moment où les gens « promettent la Lune », le public continuera de croire à la science-fiction. À moins qu’une autre révolution ne fasse irruption.

Isolement numérique : l’e-solitude
Ils sont des millions à ne pas pouvoir ou savoir utiliser Internet. À tel point que le gouvernement a décidé de faire de l’inclusion numérique un enjeu national. Plongée dans un monde où l’informatique n’est pas automatique.
Dans un petit village des Landes, l’été s’annonce mouvementé. Aux traditionnels ferias et hommages aux échassiers landais, vient de s’ajouter une nouvelle attraction dans le village. Sous la gouttière de l’épicerie, une borne Wi-Fi crache ses ondes et répand du réseau à une cinquantaine de mètres à la ronde. Depuis le comptoir-caisse de l’établissement, on peut facilement observer le bal des internautes qui viennent s’y connecter. De l’ouverture de la boutique à la fin de journée, il est même devenu quasi-systématique : c’est d’abord une jeune cadre en vacances qui l’ouvre pour consulter quelques mails, déboule ensuite une poignée d’ados qui s’installeront sur le banc pour « scroller » les fils d’actualités de leurs comptes Facebook, Snapchat ou Instagram, etc. Si les avis sont partagés au village, la plupart sont d’accord pour dire que l’installation de la borne Wi-Fi est un franc succès. Selon certains, elle aurait même remplacé le rôle que jouait la fontaine ou le boulodrome au temps jadis.
Terroirs 2.0
Et si le feuilleton de l’été de ce petit village landais n’était qu’une page d’un roman français ? Depuis peu, la France s’est fixé un cap pour son horizon numérique : en 2020, l’ensemble du territoire devra être doté d’un réseau haut-débit. L’enjeu ? Lutter contre l’isolement numérique des personnes résidant dans des milieux ruraux ou tout simplement non-couvertes, ni par le réseau Internet ni par le réseau téléphonique. Ces poches sans réseau sont appelées des « zones blanches ». Et selon plusieurs recensements officiels, il en subsisterait un peu plus de 500 en France, peu exemplaire à l’échelle du continent. En effet, un rapport de Bruxelles révélait en début d’année que « la proportion de foyers couverts par le très haut débit dans l’hexagone se chiffre à 45% contre 71% pour la moyenne européenne »1.
Mais pour tirer la couverture numérique sur les moindres recoins du pays, le gouvernement a un plan : la France Très Haut Débit. Lancé en février 2013, il vise à déployer des infrastructures numériques de pointe sur l’ensemble du territoire d’ici à 2022. Pour ce faire, l’État mobilise opérateurs, collectivités territoriales et différents acteurs comme la toute fraîche Agence du numérique ou le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET). Et ne lésine pas sur ses intentions : dans une lettre de mission distribuée le 19 juillet dernier, Emmanuel Macron faisait de l’e-inclusion l’une des 15 réformes clés de son quinquennat en matière de numérique. Objectif : former 3 millions de personnes sur 5 ans pour mener à bien les promesses.
« L’enjeu pour nous, c’est le décrochage de certains territoires », explique Anne Faure, chargée de mission au CGET, l’un des pilotes de la stratégie digitale de l’État. « Alors même que le numérique représente une véritable chance », poursuit-elle. En tant qu’administration centrale, le CGET coordonne une pluralité d’acteurs qui vont des opérateurs téléphoniques aux médiateurs sociaux en passant par la Banque Postale. Les Assises du numérique et la Convention nationale des territoires sont autant d’événements qui permettent de les rassembler autour de la question numérique. Car Anne Faure n’a qu’un mot à la bouche lorsqu’il s’agit d’inclusion : « la médiation numérique ». Pour elle, les objectifs affichés par le gouvernement seraient difficiles à tenir si on ne parvenait pas à rapprocher les citoyens lésés des personnes qui peuvent les aider. C’est pourquoi depuis 3 ans, le CGET a développé un vaste réseau de Maisons de services au public. Autrement dit, plus de 1000 centres positionnés sur des territoires ruraux qui permettent aux personnes en difficulté d’avoir accès à un accompagnement numérique.
L’illectronisme
Si câbler le pays est une chose, l’enjeu de la couverture ne préside pas seul à la destinée numérique de la France. Les profils frappés par l’isolement numérique sont multiples. On cite souvent les personnes âgées quand il s’agit d’identifier la frange de la population la plus en difficulté face aux outils digitaux. C’est oublier qu’en France, 2,5 millions de personnes sont encore illettrées et que précarité numérique rime souvent avec précarité sociale. En tout, on estime qu’entre 4 et 6 millions de personnes seraient en situation d’exclusion face au monde digital. En 2011, l’INSEE évaluait l’étendue du problème entre 12% et 18% de la population française. Depuis, le Défenseur des Droits a même posé un nom sur le phénomène : « l’illectronisme ».
Son ampleur a conduit la société civile à réagir. En dehors des sentiers battus par l’État, un réseau constitué de start-up et d’associations lutte chaque jour un peu plus contre l’« illectronisme ». C’est le cas de We Tech Care. Émanation d’Emmaüs Connect, l’organisation a vocation à ouvrir les opportunités d’Internet au plus grand nombre. Pour sa directrice générale adjointe, Cécilia Creuzet Germain, le sujet est multidimensionnel. « C’est une problématique au niveau individuel puisque tous ceux qui ne montent pas dans le train du numérique vont être impactés par une nouvelle forme d’exclusion, détaille-t-elle. Mais c’est aussi un sujet d’égalité sociale dans la mesure où on ne peut pas promouvoir une administration dématérialisée et en même temps ne pas mettre en capacité les personnes pour y accéder. » La référence est à peine voilée. À la rentrée 2016, l’État a accéléré sa stratégie de dématérialisation. Depuis lors, l’inscription à Pôle Emploi ne peut se faire qu’en ligne, idem pour l’obtention de la prime d’activité. Un an après, le nouveau gouvernement Philippe tranche encore plus fort : en 2022, tous les services administratifs seront numérisés. Selon Cécilia Creuzet Germain, la volonté 2.0 de l’administration justifie son action autant qu’elle marque une prise de conscience sans précédent sur « l’illectronisme ».
Vers une société du numérique
À l’heure où un Français sur trois est incapable d’effectuer ses démarches en ligne, We Tech Care pense des outils susceptibles d’aider les acteurs sociaux. En partenariat avec Pôle Emploi, l’association a expérimenté un projet intitulé « Les Bons Clics ». L’objectif ? Former des « aidants » à l’inclusion numérique grâce à une plateforme qui permet d’évaluer le niveau numérique des personnes en difficultés puis de construire des parcours adaptés selon leur autonomie. Si le projet est encore embryonnaire, Cecilia Creuzet Germain est formelle : « Jusqu’ici, les retours sont extrêmement positifs. Plus de 80% des personnes qui sont passées par la plateforme se déclarent désormais autonomes face aux démarches de Pôle Emploi ». Finalement, « la médiation numérique » d’Anne Faure n’a jamais été aussi tendance. À côté du CGET, la Mednum – une coopérative des acteurs de la médiation numérique – aide considérablement à paver le chemin qu’il reste à parcourir. À coté du « Plan France Très Haut Débit », l’Agence du numérique place quant à elle beaucoup d’espoir dans son « Programme société numérique » qui a pour ambition d’embarquer l’ensemble des citoyens vers la transformation digitale de la société.
Reste à lutter contre les vieux démons. Dans les rapports de l’OCDE, la France apparaît souvent comme la championne de l’e-administration. En revanche, « elle accuse un retard conséquent en matière de formation des citoyens à l’utilisation d’Internet » selon la directrice adjointe de We Tech Care. D’ici cinq ans, il va falloir investir massivement pour que tous les acteurs tirent dans le même sens. Et faire en sorte que les bénéficiaires de la nouvelle borne Wi-Fi de la supérette ne soient pas que des jeunes cadres dynamiques et des ados.
1 “Internet : le très cher plan «France très haut débit»”, Le Parisien, 31/01/2017 : http://www.leparisien.fr/economie/internet-le-tres-cher-plan-france-tres-haut-debit-31-01-2017-6642096.php

Mobilisations en ligne : tout est bon dans la pétition ?
En ces temps de désertion des places publiques, c’est sur les plateformes de mobilisation citoyenne que les associations, ONG et autres collectifs militants continuent leurs combats. Mais votre signature se fait-elle vraiment d’un clic innocent ?
Ils sont nus et prêts à tout. Non, on ne parle pas d’un nouveau concept improbable de télé-réalité à regarder pendant votre confinement mais bien des professionnels du tourisme qui se sont lancés dans une mobilisation sans précédent. Et dans le plus simple appareil. Ils sont hôteliers, restaurateurs ou commerçants et demandent dans une tentative quelque peu désespérée que la population française les soutienne à l’heure où leur activité se retrouve à l’arrêt, en plein épidémie du Covid-19.
La plateforme du changement
Leur page Facebook baptisée #Assurez-nus1 compte déjà des centaines de messages mais, pour avoir un réel impact, c’est sur une plateforme numérique de mobilisation citoyenne que ces actifs qui ne rouvriront le rideau probablement qu’à l’été prochain ont choisi de véhiculer leur message. Plus précisément, le numéro 1 français de la pétition en ligne : Change.org. Le texte2, mis en ligne le 8 avril dernier, a d’ores et déjà recueilli près de 50 000 signatures, surpassant par trois fois l’objectif initial fixé. Bien malin celui qui pourrait affirmer aujourd’hui s’il sera suivi d’effets mais une chose est sûre : l’action dévêtue des professionnels du tourisme s’inscrit dans une multitude d’autres, publiées sur la « plateforme du changement » depuis le début du confinement français. Aux lendemains de la première allocution présidentielle liée à la pandémie le 16 mars dernier, ce sont des centaines de réclamations qui sont postées sur Change.org, allant du droit de jardiner à l’extérieur à une manifestation du personnel soignant le 14 juillet prochain, en passant par le soutien aux centres équestres de Picardie. Entre toutes, certaines affichent des résultats d’engagement assez impressionnants. Comme ce texte3 emmenée par l’ancien ministre de la Santé, Philippe Doust-Blazy, qui recense à ce jour plus d’un demi-million de signatures en vue d’appeler le gouvernement à autoriser le traitement des patients atteint de Covid-19 par la fameuse chloroquine.
Ces chiffres ne sont pas à prendre à la légère. Si Change.org se targue d’être un « outil pour redonner le pouvoir aux citoyens », c’est que parfois, ça marche. En 2012, un texte qui réclamait davantage d’exposition pour les Jeux Paralympiques a forcé France Télévisions à les diffuser. En 2016, une pétition dépasse pour la première fois le million de signatures contre la loi Travail. Enfin, c’est sur la plateforme du changement qu’une certaine Priscilla Ludosky, lance le mouvement des Gilets Jaunes autour d’une mobilisation en ligne contre la hausse des prix de l’essence. Tout se passe comme si Change.org était devenu le nouvel espace idéal pour jauger puis sceller ses opinions politiques. En plein confinement, le site connaîtra sans doute un printemps fécond. Avant la propagation de l’épidémie, il était déjà devenu le réceptacle virtuel préféré des doléances écolos. En 2019, l’environnement est devenu la thématique phare en regroupant 16 % des signatures. C’est que la petite équipe d’une dizaine de personnes qui gère la plateforme a appris à se placer dans le sens du vent. Ils sont désormais une quinzaine en France à prendre le pouls de l’époque et hiérarchiser les combats entre les droits des minorités, ceux des animaux ou la justice économique.
Signer, c’est tromper ?
Après 8 ans d’exploitation dans l’Hexagone, le site déploie un spectre suffisamment large pour convaincre 12 millions d’utilisateurs français. Loin devant ses concurrents comme MesOpinions.com qui n’en compte que 4 millions ou sa rivale plus politique, Avaaz. Pour accroître son avance, le n°1 de la mobilisation en ligne a annoncé en septembre dernier la création à Paris de son premier bureau d’ingénierie. Offrir une meilleure expérience d’utilisation, fluidifier la navigation, entraîner un algorithme qui présentera des pétitions similaires à celles que vous venez de signer… Change.org s’arrime aux grandes intentions d’une start-up en hypercroissance. Car gageons-le, son suffixe est trompeur. Malgré le nom de domaine créé en 2007 aux États-Unis par Ben Rattray, la solution est bel et bien une entreprise. Née quelque part dans les couloirs de Stanford, elle s’est tout de suite dotée d’un modèle économique nécessaire à son expansion. Le deal ? Des associations ou des ONGs qui payent au nombre de signataires d’une pétition. Selon une enquête de France Culture4 sur la version française datant de 2016, les prix proposés varient entre 0,5 à plus d’un euro par signatures. En échange, ces structures seraient assurées de cibler une base qualitative d’aspirants militants qui leur permettra de porter leurs messages et d’élargir leur cercle de donateurs.
Cette transaction s’enrichit, toujours selon France Culture, de la collecte d’un nombre bien portant de données personnelles qui vont bien au-delà d’un nom et d’une adresse email puisqu’elles font apparaître les avis politiques et les aspirations des utilisateurs. Une manne numérique inestimable qui vaudra à Change.org d’être qualifié de « Google de la politique moderne » par le magazine américain Wired5.Entre-temps, l’entreprise aux 200 millions d’utilisateurs dans 196 pays différents, est devenu B-Corp, un label qui permet aux structures d’être crédibles quand elles promettent d’intégrer des objectifs sociaux, sociétaux et environnementaux à leurs missions. Elle est également scrutée par certaines organisations6 qui recensent diverses plateformes proposant pétitions, sondages et cyberactions en ligne en fonction de leurs financements mais aussi du pistage et de la marchandisation de données.
En septembre dernier, Sarah Durieux, nouvelle directrice de Change.org, annonçait7 avoir abandonné le modèle de vente de données personnelles des signataires. À la place, la plateforme profiterait de la contribution de près de 10 000 donateurs mensuels et de levée de fonds internationales dont la plus importante - 30 millions de dollars - a été conclue auprès de Reid Offman, co-fondateur de LinkedIn. Avec ses 22 millions d’euros de chiffre d’affaires mondial, l’avenir de la « plateforme du changement » semble assuré au moment où l’ensemble du globe connaît un bouleversement économique sans précédent. Reste à savoir si les acteurs dévêtus qui l’alimentent pourraient se rhabiller un jour.
2 “Pétition Ne laissez pas mourir les professionnels du tourisme. Soutenez-nous! sur Change.org”
3 “Pétition Traitement Covid-19: ne perdons plus de temps ! #NePerdonsPlusDeTemps sur Change.org”
4 “Pétitions en ligne : le marché des mobilisations”, émission Pixel du 19.02.2016 animée par Eric Chaverou, Abdelhak El Idrissi et Catherine Petillon, et à écouter sur France Culture.
5 “Meet Change.org, the Google of Modern Politics
” un article de Klint Finley à lire en anglais sur Wired
6 “Quelles pétitions signer sur internet ? - ÉTUDE DES DIFFÉRENTS SITES PROPOSANT PÉTITIONS, SONDAGES, CYBERACTIONS EN LIGNE”
7 “Change.org : qui se cache derrière le numéro 1 de la pétition ?” un article de Camille Wong à lire sur Les Echos Start
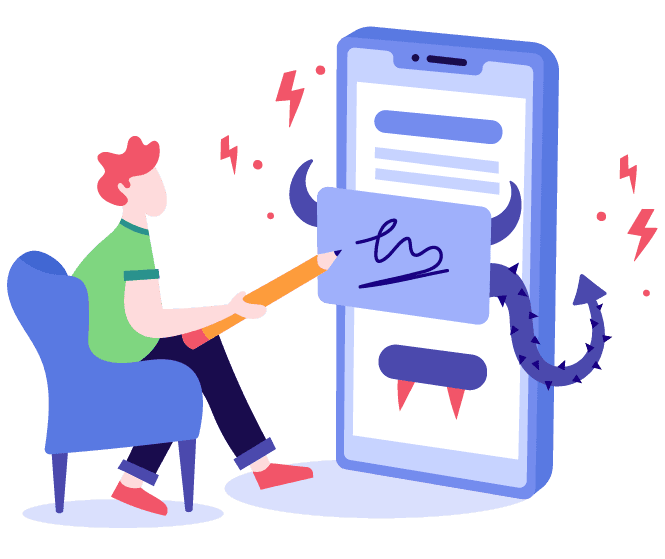
Conspirationnisme sur Internet : VOUS N’ALLEZ JAMAIS CROIRE CET ARTICLE
De l’aveu de beaucoup, le Web facilite la multiplication de théories fallacieuses. Endoctrinement, fake news, radicalisation… entre alunissage fictif et vrais reptiliens, qui tire les ficelles du complotisme sur la Toile ?
Sunkyspammy est conspirationniste. Et elle n’y croyait plus. Non pas au grand ordonnancement du monde, mais à l’amour.
D’abord, dans une ville comme New York, les relations se font et se défont comme un jouet dans un Happy Meal. Mais surtout, selon elle, beaucoup trop de monde n’est pas assez « éveillé ».
Alors quand elle a entendu parler d’Awake, l’application de rencontre qui permet « aux vrais gens de faire des vraies rencontres », elle s’est jetée dessus. Pensant enfin trouver une âme sœur réfléchie, vigilante et hyper attentive « à toutes ces choses qui affectent nos vies quotidiennes ».
You(en)Tube
Nous ignorons si Spunkyspammy a trouvé l’amour. Ce que l’on sait, c’est qu’à ce jour Awake existe encore et met toujours plus de personnes « éveillées » en relation.
Créé en 2016, le service ferait matcher des milliers de personnes qui échangent des théories abstraites sur la façon dont le « système » endort la population.
Certains se sont moqués en taxant l’idée brevetée par l’Australien Jarrod Fidden de « site de rencontres conspirationnistes ». D’autres, moins nombreux, se sont un peu plus inquiétés, soulignant que si une telle application pouvait prospérer, c’est que le conspirationniste avait définitivement infiltré la culture digitale.
Ce n’est sûrement pas Jonathan Albright qui dira le contraire. Ce directeur de recherche au Tow Center for Digital Journalism a disséqué l’algorithme de YouTube après la fusillade de Parkland, survenue aux États-Unis le 14 février 2018. En partant du mot-clé « crisis actor », le data journaliste a découvert un réseau de 8842 vidéos dont la majorité recèle une théorie conspirationniste. Au total, elles cumulent 4 milliards de vues.
Quelques jours avant la tuerie de Parkland, un ancien employé de YouTube décidait de révéler dans le Guardian comment l’algorithme de recommandation de l’entreprise avait joué un rôle déterminant dans la campagne présidentielle américaine de 2016.
Licencié par Google en 2013 (Google a racheté YouTube en 2006, ndlr), Guillaume Chaslot est un développeur en informatique français qui a désormais fondé son association baptisée AlgoTrasnparency.
À l’aide d’un robot, lui et son équipe ont montré que YouTube favorise certaines vidéos politiques, nettement clivantes voire conspirationnistes. Au Guardian, il explique que l’algorithme de recommandation du site n’a pas été créé pour offrir un contenu éclairé et objectif mais « pour faire rester les gens sur le site et accroître le temps de visionnage ».
Zeynep Tufekci, célèbre techno-sociologue critique, le pose autrement. « C’est comme si rien n’était trop hardcore pour YouTube, écrit-elle dans le New York Times. L’algorithme s’est rendu compte que si vous pouviez inciter les gens à penser que vous pouvez encore leur montrer quelque chose de plus hardcore, ils sont susceptibles de rester plus longtemps ».
Accusé de faire le jeu des conspirationnistes, Google n’a pas tardé à réagir. Premièrement, en démentant vaguement les arguments de Guillaume Chaslot. Deuxièmement, en essayant de faire bonne figure.
En début d’année, YouTube s’engage dans un communiqué à « commencer à réduire le nombre de recommandations de contenus susceptibles de désinformer les usagers de façon néfaste » en prenant l’exemple de vidéos faisant la promotion d’un remède miracle à une maladie grave, d’autres assurant que la Terre est plate ou affirmant des éléments faux sur le 11 septembre.
Entre-temps, l’ensemble des géants du Net a lancé une offensive contre les conspirationnistes et notamment l’un de leurs plus célèbres représentants, Alex Jones. L’été dernier, cet ancien animateur de radio qui rassemblait des millions de personnes sur sa chaîne YouTube s’était vu privé d’accès à Facebook, YouTube, Apple et Spotify.
Anti conspi
Pour les lanceurs d’alerte comme Guillaume Chaslot, l’initiative des GAFA ne tombe pas du ciel. D’abord, elle répond à un souci d’influence et de responsabilité. On compte 1,5 milliards d’utilisateurs de YouTube dans le monde, c’est plus que le nombre de foyers possèdant une télévision. Ensuite, la pénétration du conspirationnisme sur Internet télescope celle des infox, ou fake news, face à auxquelles les États commencent à légiférer.
En France, le président de la République promulguait le 22 décembre dernier une loi organique contre la manipulation de l’information. Elle fait suite à la vigilance croissante des pouvoirs publics vis-à-vis de la prévention du complotisme, perçu également comme facteur de radicalisation, de racisme et d’antisémitisme.
Pour Rudy Reichstadt, fondateur de l’Observatoire du conspirationnisme et des théories du complot (Conspiracy Watch), la recrudescence des théories fallacieuses s’est accélérée dans l’Hexagone à partir des attentats de 2015.
À l’époque, la ministre de l’Éducation nationale soulignait qu’un jeune sur cinq y adhérait. Et c’est évidemment sur la Toile que ces derniers leur donnent du sens.
« Aujourd’hui, explique-t-il dans un entretien au Magazine Littéraire, avec une simple connexion internet, nous sommes tous, en puissance, des producteurs de contenus. Pour le meilleur, nous pouvons témoigner de ce que nous voyons en direct sur les réseaux sociaux. Pour le pire, nous pouvons aussi lancer et surtout relayer une rumeur en quelques secondes. »
Certaines d’entre elles jouissent parfois d’une longue durée de vie. Parmi les grandes théories du complot qui semblent en circulation depuis toujours, on trouve l’existence de sociétés secrètes, les « chemtrails » chimiques (traînées blanches créées par le passage des avions en vol, ndlr), l’assassinat de JFK commandité par la CIA ou l’alunissage qui n’a jamais eu lieu.
Autant de présomptions compilées dans une enquête menée par Conspiracy Watch en partenariat avec la Fondation Jean Jaurès. Parue en janvier 2019, elle rappelle que le conspirationnisme concerne, « dans sa forme la plus intense », pas moins d’un Français sur quatre.
Suffisant pour alerter le gouvernement et les organisations de la société civile impliquées dans le besoin de sensibiliser le public au phénomène.
Après tout, un million de mensonges auraient été visionnés chaque jour sur les réseaux sociaux pendant la campagne présidentielle. Et une étude publiée le 21 mai dernier par l’Université d’Oxford vient de montrer que les fake news sur l’Europe se répandent sur Facebook.jusqu’à 4 fois plus que les vraies infos.
Alors, que faire ? D’abord, établir un diagnostic : l’accélération des flux d’informations sur un mode intuitif et émotionnel, l’industrialisation des fausses nouvelles (à une époque où l’on peut acheter des milliers de retweets pour 3 euros) et la crise de confiance envers les sources traditionnelles d’information favorise l’accumulation de complots.
Ensuite, proposer des moyens d’action. Le gouvernement s’engage depuis 2016 à déconstruire le conspirationnisme via des dispositifs comme ontemanipule.fr auquel s’est joint le comédien et humoriste Kevin Razy.
De son côté, le réseau Canopée, opérateur public, propose une série d’outils aux professeurs pour les aider à préparer leurs classes à faire face aux fausses informations. Certains d’entre eux comme Sophie Mazet, autrice d’un Manuel d’autodéfense intellectuelle, organisent même des formations à l’esprit critique à destination de leurs élèves.
Au-delà de la sphère publique, ils sont de plus en nombreux à combattre les complotistes sur YouTube. Ils s’appellent les « anticonspi » et cumulent désormais des millions de vues en utilisant les mêmes codes que leurs adversaires.
De la vigilance donc, et beaucoup d’éducation face à des théories farfelues qui, d’après les spécialistes, sont somme toute faciles à démonter. Cela étant dit, il sera sans doute beaucoup plus compliqué de lutter contre les éveillés d’Awake. Car que peut-on contre l’amour ?

Numériser l’éducation : les codes d’une ambition
La mue numérique de l’école s’est concrétisée à la rentrée 2016 par l’expérimentation de l’apprentissage du code dès la maternelle. Enjeux, problématiques et bilan d’une vraie révolution dans un pays où l’informatique n’a pas toujours été automatique.
Chaque année, c’est la même chose. À la fin juin, des centaines de milliers d’enfants sortent en pagaille des salles de classes en sachant un peu mieux compter, un peu mieux lire et un peu mieux écrire. Mais en 2017, certains d’entre eux embarqueront d’autres savoirs pour les vacances. Depuis la rentrée 2016, une petite portion d’écoles primaires françaises apprend à ses élèves à coder, à programmer des jeux vidéos ou des robots. Objectif officiel ? Tester l’apprentissage de la science informatique dès le plus jeune âge. Ambition d’État ? Engager une bonne fois pour toute la transition numérique de l’éducation en France.
Une ambition présidentielle
« Il s’agit de changer le rapport à la formation et à l’apprentissage », indique Mathieu Jeandron, à la tête de la Direction du numérique pour l’éducation (DNE). Depuis 2014, cet organisme placé sous la responsabilité de l’Éducation nationale tente de déployer la stratégie numérique du ministère en concevant notamment des dispositifs de formation adéquats. Mais la DNE est d’abord et surtout le fruit d’une ambition présidentielle, celle de François Hollande qui en 2012 entendait bien faire entrer l’école dans le monde numérique. « Tout doit commencer par le codage à l’école », affirme-t-il ainsi lors d’un voyage dans la Silicon Valley en février 2014. Derrière les slogans, il y a les actes qui « commencent dès 2012 et 2013 par une loi de refondation et de définition d’un dispositif numérique éducatif », souligne Mathieu Jeandron. Puis dans le sillage de la création de la DNE, le plan numérique pour l’éducation de 2015 « jettera définitivement les bases des composantes qui vont permettre aux enseignants de s’approprier la culture numérique ».
La partie immergée de l’iceberg digital s’observe surtout depuis 8 mois, lorsqu’on pousse la porte d’une salle de classe. À l’intérieur, des élèves programment des robots tandis que leurs enseignants leur rappellent les rudiments de la cryptographie. Si tout va bien, ces enfants âgés de 3 à 10 ans seront capables dans les années à venir de créer des jeux vidéo, de tout savoir sur le stockage des informations en ligne et même de décrypter des lignes de code aujourd’hui incompréhensibles pour le grand public. Comment une scène qui relevait il n’y pas si longtemps de la science-fiction est-elle devenue réalité ? « En montrant que c’était possible, tout simplement », répond David Wilengbus de La main à la pâte, une fondation qui milite depuis plusieurs années en faveur la mue numérique de l’école. Avec son équipe composée de consultants scientifiques et de concepteurs-rédacteurs, David Wilengbus a conçu un manuel de 358 pages qui s’est rapidement imposé en tant que support pédagogique privilégié de cette nouvelle formation au numérique. L’initiative a reçu le soutien de Google et de Microsoft, mais surtout celui de l’Éducation nationale et du corps enseignant. « C’était le principal challenge, confie l’auteur. Les gens sont a priori méfiants soit parce qu’ils considèrent que c’est inutile, soit parce qu’ils pensent qu’ils ne sont pas capables de le faire. »
« Il est urgent de ne plus attendre »
Au-delà d’un manuel de 300 pages, le projet de La main à la patte entend surtout tordre le cou à certaines idées reçues : « L’informatique n’est pas qu’un ensemble d’outils, c’est une science », rappelle l’introduction d’1,2,3…codez !. D’où l’importance des activités dites « débranchées » préconisées par les pédagogues et qui permettent d’expliquer les concepts et l’histoire de l’informatique avant d’utiliser les ordinateurs. « On est parti d’un mauvais postulat en France, reprend David Wilengbus. Celui de penser que l’informatique se cantonnait à l’apprentissage d’outils numériques, d’un tableur ou d’un logiciel de traitement de texte ». Lorsque Mathieu Jeandron liste toute une série de textes qui ont suivi l’élection de François Hollande, les informaticiens préfèrent citer un rapport de l’Académie des sciences publié en 2013. Intitulé « Il est urgent de ne plus attendre », le document a eu un écho certain au sein de la communauté scientifique tout en apportant la caution intellectuelle qui manquait jusqu’alors à l’ambition du gouvernement.
S’il interpelle, c’est parce que ce rapport a le mérite de souligner les finalités et les enjeux, d’abord économiques, de l’enseignement informatique et plus globalement de la mise en place de la stratégie numérique de l’école. « L’idée générale, c’est de s’ancrer dans un environnement où le numérique est désormais partout », résume Mathieu Jeandron. « Aujourd’hui, tous les métiers – du boulanger au journaliste en passant par le taxi – sont déjà impactés par le numérique », complète David Wilengbus. La deuxième grande dimension est quant à elle citoyenne : « La protection des données personnelles, l’e-réputation, le big data, la protection de son identité… il y a des enjeux citoyens vitaux derrière tout cela. Et il est nécessaire de s’y familiariser dès le plus jeune âge », poursuit-il.
Un TOEFL du numérique
À l’orée d’une année d’un nouvel apprentissage, quel bilan peut-on tirer ? « Pour moi, il est très positif », estime David Wilengbus. À l’heure actuelle, 18 000 enseignants formés dispensent la science de l’informatique à près de 500 000 enfants. Selon lui, les élèves s’amusent énormément et les professeurs sont de plus en plus enthousiastes. « La prise de conscience est désormais faite, maintenant il reste à convaincre les 330 000 enseignants restants et à rattraper le retard. » Car oui, la France aurait du retard. À côté de certains voisins européens comme la Finlande, la Belgique ou le Royaume-Uni, « on a mis 20 ans à comprendre que bombarder les écoles de matériel, donner des tablettes à tout le monde ou mettre des imprimantes 3D partout ne servait à rien », fustige Wilengbus. Mais, selon Mathieu Jeandron, la situation n’est pas si mauvaise que ça. « Si on garde à l’esprit l’image traumatisante des ordinateurs qui sont restés dans un placard, oui il y a eu des ratés. Mais depuis le Plan Informatique pour tous de 1985, on a pu apprendre de nos erreurs et nous sommes maintenant clairement dans une logique de progrès où la France tient la dragée haute aux autres pays du monde », défend-t-il. Pour preuve, le directeur de la DNE en veut le « TOEFL du numérique » - dont une version est déjà disponible en ligne - qui permettra aux jeunes étudiants de tester leurs connaissances en informatique et « d’avoir une reconnaissance universelle sur le marché de l’emploi ». Les cours d’algorithmique et de codage devront s’intensifier jusqu’à penser un projet de création numérique d’envergure au bac. Enfin, Mathieu Jeandron ne cache pas vouloir s’inspirer des méthodes de nos voisins britanniques, en important l’idée de fournir aux élèves les plus jeunes une petite puce qui leur servira de support de programmation tout au long de leur scolarité.
Reste à savoir comment l’ambition de François Hollande se diluera dans le nouveau gouvernement de la présidence d’Emmanuel Macron. Mais selon Mathieu Jeandron, « le plus dur est passé, les principaux acteurs se sont désormais rendus compte combien le numérique était important ». David Wilengbus, lui aussi, compte bien continuer à montrer que c’est possible. Une deuxième édition d’1,2,3…codez ! est actuellement en préparation pour la rentrée prochaine. L’objet ? Numériser le collège.
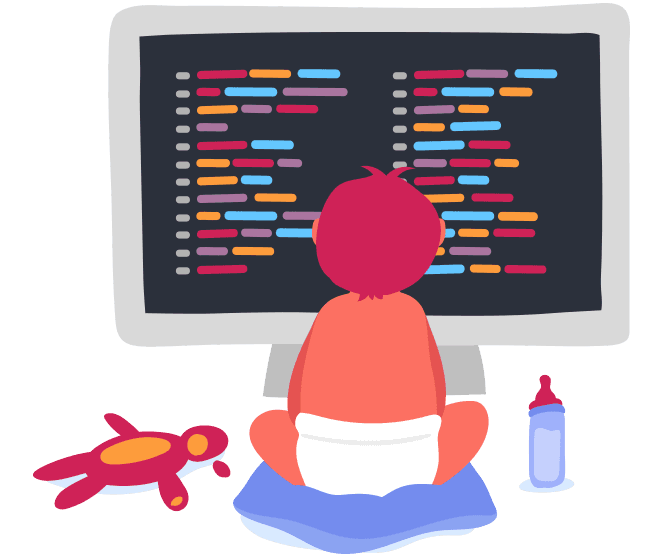
Mort numérique : à quoi ressemble l'au-delà sur Internet ?
En 2016, la loi pour une République numérique ambitionnait d’encadrer les dispositions relatives à la mort numérique. Un an après, comment le concept a-t-il évolué ? Et comment les Internautes peuvent-ils prévoir leur avenir post-mortem en ligne ?
Andrew est un homme plutôt prévoyant. À 20 ans, persuadé de pouvoir mourir n’importe quand, il préparait déjà sa succession, en allant un peu plus loin que les précautions ordinaires… au moment de dresser l’inventaire de son testament, le jeune américain a demandé à son notaire de lister l’ensemble de ses biens numériques. C’est ainsi qu’en plus de son patrimoine matériel, ses légataires recevront également ses films de famille numérisés, ses comptes de réseaux sociaux, les noms de domaines qu’il détient et même quelques bitcoins.
Six pieds sous le Net
L’histoire d’Andrew Magliochetti, c’est le New York Times qui la raconte dans un article daté de 2015. Une histoire parmi tant d’autres. Car aux États-Unis, ils sont de plus en plus nombreux à inclure leurs capitaux numériques dans leurs droits de succession.
Avant l’ère digitale, il suffisait de lire un testament sur papier et de répartir les biens physiques entre les légataires désignés. Aujourd’hui, le patrimoine d’une personne peut également se trouver dans le cloud ou sur un compte Apple. Si les avocats américains parlent d’un étrange no-man’s land juridique, le pays semble avoir un temps d’avance sur la France.
Quand un individu sur deux prend ses dispositions outre-Atlantique, près de neuf successions sur dix se règlent sans testament dans l’Hexagone. Résultat : selon un rapport de la Cour des comptes, environ 5 milliards d’avoirs seraient en déshérence, principalement issus d’assurances-vie ou de comptes bancaires qui n’auraient pas été réclamés. Toutefois, les choses pourraient bien changer au Pays des Lumières.
Le 7 octobre 2016, l’État français promulguait la loi pour une République numérique qui, pour la première fois, prévoit un décret sur la mort numérique. Un an après, le texte organisant le répertoire des directives est toujours en cours d’élaboration. Mais d’aucuns affirment qu’un sacré pas a d’ores et déjà été franchi.
N’importe quel individu possédant un compte de messagerie ou de réseau social sur Internet dispose aussi de droits personnels. En premier lieu : le droit au respect de sa vie privée, qui comprend aussi le droit au secret des correspondances et le droit à l’image. Autant de données auxquelles, par principe, les membres de la famille ou les amis ne peuvent pas avoir accès. C’est alors que le droit à la mort numérique intervient, permettant à toute personne d’organiser, de son vivant, la manière dont elle entend conserver et communiquer ses informations personnelles après son décès.
L’article 40-1 de la loi pour une République numérique encadre les dispositions de la mort numérique. Dans son deuxième point, il précise que « toute personne peut définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses données à caractères personnel après son décès ».
Bien entendu, nul n’est strictement tenu de le faire. Dans le cas où l’individu concerné n’aurait pas pris ses dispositions, il reviendra à ses héritiers désignés d’exercer ses droits – ce sans quoi le patrimoine numérique du défunt (livres, musiques ou films stockés sur Internet par exemple) pourrait bien tomber dans les limbes du web mondial, aucun mécanisme de transfert automatique n’existant à ce jour.
Programmer l’après sur les réseaux sociaux
Choisir un légataire chargé de gérer nos comptes après notre mort est donc possible depuis le 7 octobre 2016. Le texte désigne cette personne comme étant « un tiers de confiance numérique » qui doit être certifié par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et dont les modalités d’accès à de notre patrimoine numérique sont fixés par décret en Conseil d’État.
Vous l’aurez compris, la mort numérique est désormais très réglementée. Des dispositions légales dont ne se sont pas vraiment embarrassés les principaux géants du Web.
Sept ans avant la loi promulguée par la France, Facebook réfléchissait déjà à ce qu’il pourrait advenir des comptes de personnes décédées. En 2009, un ingénieur du réseau social propose la première fonctionnalité de « mémorial » après avoir été confronté au décès d’un proche. Deux ans après, on apprenait que trois utilisateurs de Facebook décédaient chaque minute, résultant en des centaines de millions de comptes fantômes.
L’entreprise de Mark Zuckerberg choisit de laisser ces comptes ouverts pour continuer à bénéficier de leur trafic. Elle ajoute toutefois une option à ses paramètres, afin d’offrir à ses utilisateurs la possibilité de déclarer le décès d’un proche et de demander la transformation dudit profil en « compte de commémoration ». Ainsi les amis du défunt pourront continuer à consulter les contenus partagés, et à lui rendre hommage en publiant sur son journal.
En revanche, plus personne ne pourra modifier ses informations, à moins que la personne décédée n’ait désigné un légataire de son vivant. Pour ce faire, rien de plus simple : ~~ il suffit de se rendre dans les paramètres de son compte, d’accéder à la rubrique sécurité et de désigner un contact légataire parmi ses amis Facebook.~~ Ce dernier aura alors la possibilité changer la photo de profil ou de couverture du compte, de répondre aux demandes d’ajout d’amis, etc.
Twitter et Google se sont également penchés sur l’avenir post-mortem des comptes de leurs utilisateurs. Le premier traite à ce jour les demandes au cas par cas, depuis son centre d’assistance.
Google, quant à lui, parle de « comptes inactifs », pour lesquels l’utilisateur doit indiquer le délai au-delà duquel l’entreprise doit acter l’inactivité du compte. Comme pour Facebook, il est possible de désigner des personnes de confiance qui disposeront d’un droit de gestion sur le compte, mais également de préciser le contenu auquel ces dernières auront accès ou non (email, agenda, photos, cloud…).
Les grosses firmes du Web ne sont pas les seules à avoir anticipé les décrets législatifs des États. En France, il existe des services qui, avant 2016, proposaient déjà de gérer la mort virtuelle des individus. Le plus connu ? Testamento, un site qui propose depuis 2013 de se créer un testament en ligne et en toute légalité. Deux ans après, l’entreprise annonçait la proposition d’un service d’inventaire, afin de lister ses biens numériques à transmettre dans le cadre d’une succession.
En attendant la fin de l’élaboration du décret sur la mort numérique du gouvernement, il est donc largement possible d’assurer sa postérité sur Internet. Et nul besoin d’être comme Andrew pour bien s’y prendre.

GAFA : votre attention s’il vous plaît
Apple et Instagram viennent de développer des services qui permettent à leurs utilisateurs de consulter le temps qu’ils passent sur leurs téléphones. Pourtant, ces innovations sont loin de mettre un terme à la bataille de l’attention sur le Net…
Depuis quelques années, les conférences annuelles des développeurs d’Apple se suivent et se ressemblent. Chacun s’installe, teste les nouvelles fonctionnalités et repart avec un aperçu des services que la marque proposera à ses clients dans les mois à venir. Mais lors de la dernière édition, un petit événement est venu bousculer les habitudes. En dévoilant la version bêta de son nouveau système d’exploitation - iOS -, Apple a surpris son monde. La raison ? Elle contenait une nouvelle fonction baptisée Screen Time qui permet de calculer le temps passé à utiliser son téléphone.
Tim Cook et l’apnée de l’email
Tim Cook a lui-même été surpris par les résultats de Screen Time. « Je l’ai utilisé et je dois vous dire : je pensais être très discipliné là-dessus. J’ai eu tort », déclare-t-il dans une interview accordée à CNN.
Le patron d’Apple est finalement comme tout le monde : il passe beaucoup trop de temps sur son téléphone. En moyenne : environ 2h30 par jour. Jusque-là, rien de bien neuf : on ne compte plus les études qui soulignent l’augmentation de la part du mobile dans ce qu’on appelle le « temps digital ».
Ce qui est plus singulier, c’est que l’un des grands patrons du numérique le reconnaisse. Et il n’est pas le seul. Le mois dernier, le CEO d’Instagram - Kevin Systrom - confirmait que le réseau social proposera prochainement à ses utilisateurs de consulter le temps quotidien passé sur l’application. Une initiative qui s’ajoute à une autre nouveauté : aujourd’hui, Instagram avertit l’internaute lorsque ce dernier est arrivé à la fin de son fil d’actualité.
Mais pourquoi les entreprises de Silicon Valley se soucient-elles soudainement du temps que les gens passent sur leurs produits ? Parce que depuis des mois, une petite révolution qui tient en trois lettres secoue le train-train disruptif de Palo Alto : « Time Well Spent ». Littéralement : le « temps bien dépensé ».
Emmené par Tristan Harris en 2016, ce mouvement est aujourd’hui parvenu à murmurer aux oreilles des GAFA. Le constat de cet ancien designer chez Google est connu : nous passons de plus en plus de temps sur nos téléphones et c’est la faute des grosses entreprises du Web. Celles-ci piratent nos esprits et volent notre temps en proposant des applications qui nous forcent à rester connectés. Partout, tout le temps.
Si à l’origine, Time Well Spent militait essentiellement pour un design plus éthique et responsable, il s’intègre désormais dans une grande association intitulée Center for Humane Technology. Cette organisation est composée de développeurs, d’ingénieurs, de philosophes, de sociologues et de médecins qui agitent souvent les dangers de la surutilisation des smartphones sur l’être humain.
Les adolescents de 13 à 17 ans envoient 4000 textos par mois, soit toutes les 6 minutes de leur vie éveillée, provoquant ainsi des problèmes de sommeil et de stress. 28% des accidents de la route sont dus à l’utilisation du téléphone en voiture. Après la lecture du dixième email sur mobile, nous ne respirons plus quand nous lisons le suivant… Et ce ne serait qu’un aperçu des effets néfastes que l’overdose de téléphone fait peser sur notre santé.
Des gestes simples
Aujourd’hui, Tristan Harris et son équipe se félicitent que certaines grandes entreprises décident de prendre en compte le temps passé sur mobile dans leur stratégie de développement. Mais ils restent tout de même vigilants. « Nous devons leur demander une responsabilité permanente », tweetait l’ancien employé de Google après l’annonce de la nouvelle fonctionnalité d’Instagram. Car ce qui est en jeu est trop important : la bataille pour une économie de l’attention.
Apparue à la fin des années 60, cette branche des sciences économiques est devenue le modèle économique par excellence des GAFA, qui ont tout intérêt à garder leurs utilisateurs le plus longtemps possible, même si leurs objectifs divergent. Après tout, le directeur de Netflix, Reed Hastings ne disait-il pas en avril dernier : « Nous sommes en compétition avec le sommeil » ?
Désormais, pour Harris, le problème est devenu politique. Partant du principe que la Silicon Valley pourra difficilement « se réparer toute seule », il s’est rendu au Congrès afin d’alerter les sénateurs américains sur ces questions. « Pour limiter cette guerre, il faut trouver des modalités, des lois, des protections, des normes attentionnelles, comme on l’a fait pour l’écologie », expliquait-il lors d’une conférence à Paris.
Sauf que le temps presse. Et qu’au regard du poids colossal des GAFA et de la complexité d’analyse de l’économie de l’attention, il se pourrait qu’une réponse politique tarde à venir. Alors le Center for Humane Technology a fait de la patience une certaine médecine expérimentale.
L’association propose des gestes simples pour reprendre le contrôle sur son temps et ses choix. Du propre aveu de Tristan Harris, « des rustines » qui pourront ensuite se muer en techniques réflexives et personnelles. Préférer les applications pour lesquelles une notification équivaut à l’action d’une personne : les services de messagerie instantanée comme Messenger ou WhatsApp plutôt que Facebook et Twitter. Griser l’écran d’accueil de son téléphone : les couleurs des applications envoient des signaux à notre cerveau qui nous incitent à rester sur l’appareil. Envoyer des messages vocaux au lieu de les écrire permet d’éviter les malentendus et surtout ne requiert pas notre attention visuelle. Ne laisser apparaître que les outils sur nos écrans d’accueil, supprimer les applications de réseaux sociaux, laisser son téléphone charger dans une autre pièce que la salle à coucher… autant de bonnes pratiques qui devraient permettre d’écarter les gens de leur téléphone. Qu’ils touchent en moyenne 2600 fois par jour.
Pour approfondir le sujet, (re)voir l’épisode 4 de Turfu Express :
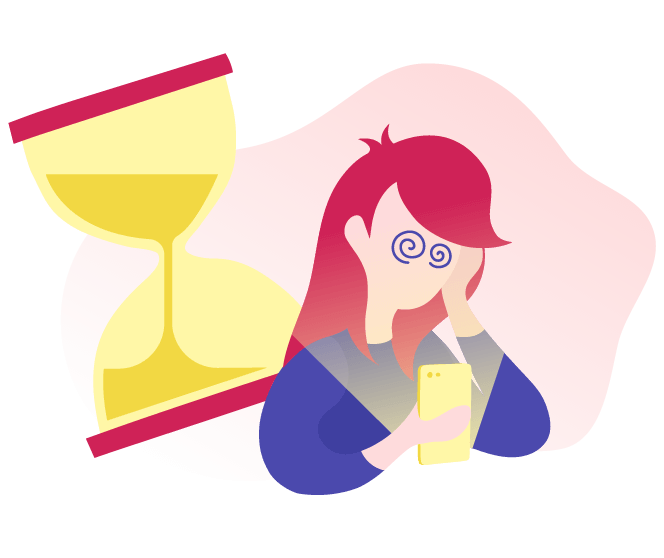
Sobriété : la fine ligne du numérique
Vous venez de faire du vélo, de trier vos déchets et de tout laver au vinaigre blanc. Vous avez bien mérité un petit épisode de votre série préférée sur Netflix ? Si vous voulez, mais ce n’est pas comme ça que vous allez sauver la planète.
Cela ne vous aura pas échappé. Elle est partout. De votre douche le matin à vos déplacements du soir en passant par votre assiette à midi. À la rentrée, l’écologie est désormais la principale préoccupation des Français selon une enquête Ipsos Sopra-Steria pour Le Monde.
Pas un jour ne se passe sans que l’environnement ne se fasse une place dans votre quotidien. Mais si vous êtes désormais incollables sur le ménage au vinaigre blanc, le tri des déchets ou le calcul de votre empreinte carbone, êtes-vous bien au fait de l’impact du numérique sur l’environnement ?
Gros comme un avion
Voilà désormais quelques années que la pollution numérique télescope la conscience collective associée aux enjeux climatiques. Qui ne sait pas aujourd’hui qu’un email pollue ? Si la notion est progressivement intégrée dans nos pratiques quotidiennes, ils sont beaucoup - militants, ONG, think-tank - à marteler que les menaces du numérique sur la planète nous dépassent.
À l’échelle du globe, si l’informatique était un pays, il se classerait au troisième rang des pays énergivores juste derrière la Chine et les États-Unis. La part du numérique dans les émissions de gaz à effet de serre a augmenté de moitié depuis 2013, passant de 2,5 % à 3,7 % du total des émissions mondiales. Dans peu de temps, elle représentera autant que celle du trafic aérien. Mais au-delà des usages, c’est la fabrication que requiert nos vies connectées qui devient gigantesque. En 2020, nous devrions être entourés de plus de 50 milliards d’appareils connectés.
Sachant que la production d’un smartphone de 100 grammes requiert 70 kilos de matériaux, tandis qu’un ordinateur nécessite 240 kilos de combustibles fossiles, 22 kilos de produits chimiques et une tonne et demie d’eau.
La liste des dépenses est infinie. Seul moyen d’endiguer le phénomène ? La sobriété numérique. Théorisée en 2008, le concept semble moins connu du grand public. D’après ses inspirateurs, il s’agit d’une transition - sobre donc - qui consiste essentiellement à acheter les équipements les moins puissants possibles, à les changer le moins souvent possible, et à réduire les usages énergivores superflus.
Selon The Shift Project - une association française qui s’est donné pour objectif la réduction de la dépendance de l’économie aux énergies fossiles - adopter cette sobriété dans notre relation au digital permettrait de ramener l’augmentation de consommation d’énergie du numérique, à 1,5%, alors qu’elle affiche actuellement une hausse de 9% par an.
Ingénieur et essayiste, le président du Shift Project, Jean-Marc Jancovici, découpe souvent l’origine de la pollution numérique totale en trois parties : 20% des émissions de gaz à effet de serres proviennent des data centers, environ 50% viennent de la fabrication des terminaux qu’on utilise, et un tiers découle de leur fonctionnement.
Faire sa part
Plusieurs millions de vues, c’est ce qu’a cumulé la vidéo de Jean-Marc Jancovici sur Konbini. Dedans ? Ce qu’il a toujours dit : notre utilisation d’Internet pollue. Mais l’accent porté sur la vidéo justement - qui représente 80% de la bande passante d’Internet - a interpellé les utilisateurs des réseaux sociaux. Vous aurez beau vous déplacer à vélo et faire de la permaculture, vous polluerez toujours plus si vous regardez un documentaire sur Netflix.
De leur propre aveu, le Shift Project n’a pas vocation à démanteler le marché de la SVOD. L’association prône simplement la bonne conscience de nos usages informatiques dans un souci de rationalisation. Avec d’autres organisations, comme la FING, WWF ou Green IT, elle propose d’abord d’agir à titre personnel, de « faire sa part » comme dirait Pierre Rabhi, théoricien de la sobriété heureuse, dans un mouvement collectif qui naîtra de la somme des individualités sensibilisées.
Quelques astuces concrètes et faciles à mettre en œuvre sont proposées ici et là. Elles vont de l’achat d’occasion à la décision responsable d’éteindre sa box pendant la nuit en passant par le choix salutaire d’éviter de mettre toute la boîte en copie quand il s’agit d’envoyer un email.
Cela dit, toutes les organisations qui portent le concept de sobriété numérique sont bien conscientes que l’on ne changera pas le monde uniquement avec les consommateurs. En parallèle, certaines se constituent en groupe de pression pour qu’un soutien réglementaire et normatif puisse exister. C’est notamment le cas du Shift Project qui adresse directement des rapports aux décideurs et pouvoirs publics.
L’association propose à la puissance publique de fonder une base de données publique - le Référentiel Environnemental du Numérique (REN) - pour permettre aux acteurs d’analyser leur impact environnemental. Grâce à cela, il sera possible de procéder à un bilan carbone des grands projets numériques avant de les lancer.
La pression semble produire des effets. Depuis peu, le Ministère de la transition écologique et solidaire soutient des projets qui vont dans le sens d’une certaine sobriété. Premier exemple : l’Institut Numérique Responsable (INR), créé en 2018, qui compte, parmi ses adhérents la communauté d’agglomération de La Rochelle, des associations et ONG (WWF, Agence Lucie, FING) ainsi que des entreprises (SNCF, Pôle Emploi, Le Groupe La Poste, Société Générale, Engie, Decathlon, MAIF, BNP Paribas…).
En juin, l’INR a inauguré en partenariat avec l’Agence Lucie, le label Numérique Responsable (NR) qui récompense les entreprises qui suivent un programme menant à davantage de sobriété numérique. Le dispositif entend répondre à un vrai défi puisqu’en France, l’empreinte numérique annuelle d’un salarié équivaut à 800 kg de gaz à effet de serre et de 14 000 litres d’eau, soit 29 km en voiture par jour et 6 packs d’eau minérale par jour travaillé.
Pour certains, comme le polytechinicien Hugues Ferreboeuf - également membre du Shift Project, l’État pourrait aller encore plus en arrêtant d’encourager des modèles de quasi-gratuité. Au-dessus d’un certain volume de données, l’ingénieur préconise de rendre payante la consommation de certains services particulièrement énergivores. Vous contraindre à la sobriété en vous faisant payer votre déclaration d’impôt en ligne, ne serait-ce pas un beau projet de société ?
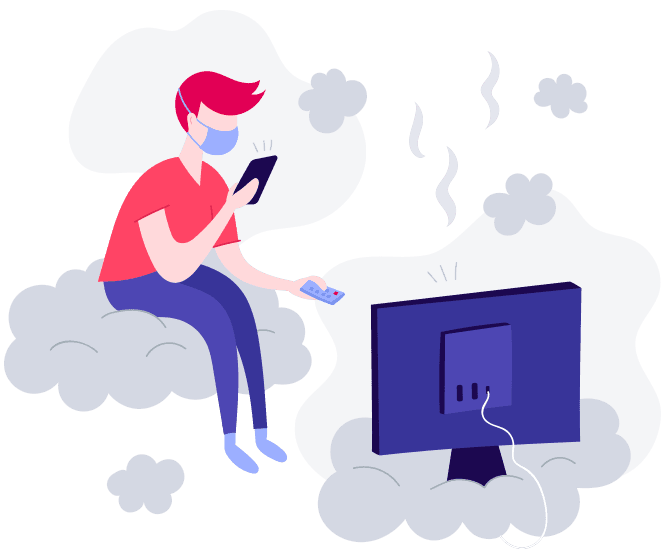
Biohacking : la révolution scientifique en ligne
Alors que la biologie française s’empêtre dans de nombreuses affaires depuis 3 ans, des hackeurs montrent qu’il est possible de faire de la science avec une connexion Internet et très peu de moyens. Plongée dans le milieu expérimental du biohacking.
Il faut passer une cour pavée, puis une deuxième. Là, à droite, avec sa façade proprette et ses tables en bois posées à l’extérieur, La Paillasse pourrait ressembler à n’importe quel incubateur de start-up. Après tout, nous sommes dans le 2ème arrondissement de Paris et non loin d’un secteur que l’on appelle « Silicon Sentier ».
L’endroit pourrait très bien être investi par de jeunes conquérants 3.0 prêts à disrupter l’économie. Sauf qu’à l’intérieur, ni seuil de rentabilité ou plan de retour sur investissement.
La Paillasse est un long dédale d’inventions, de bric, de broc et de fils, de matériaux épars et d’ordinateurs. Entre une tablette et une bouteille de Badoit, on peut trouver une boîte en carton qui pourrait bientôt révolutionner les diagnostics génétiques sur les aliments contenant des traces d’OGM.
Dans la salle de réunion vitrée, on discute de futurs composants biodégradables qui changeront à jamais le futur des appareils électroniques. À la Paillasse, on ne bouleverse définitivement pas l’économie, on invente le futur de la biologie.
Réparer le vivant
La Paillasse - du nom du plan de travail scientifique - se définit comme un laboratoire du XXIème siècle. Ouvert, communautaire et plein de hackeurs. Parce qu’il est surtout le premier « biohackerspace » d’Europe, ces endroits où l’on redéfinit complètement la biologie, avec un clavier et une souris.
« L’enjeu ici est de faire exploser la diversité des usages en favorisant l’accès aux laboratoires et aux ressources, pour permettre à un grand nombre de personnes d’imaginer la façon d’utiliser la biologie au service d’une problématique sociétale », disait en 2013 Thomas Landrain co-fondateur du lieu, lors d’une conférence TEDx parisienne.
À l’époque, le jeune thésard en biologie de synthèse investit un squat dans la banlieue de Paris. Au contact de plusieurs hackers, il peaufine sa vision d’une biologie accessible à tous, pas chère et complètement ouverte.
En 2013, cela ne fait que deux ans que Thomas a entendu parler d’un drôle de concept né aux États-Unis quelques années plus tôt : le DIY Bio (de Do It Yourself, Le faire soi-même, ndlr). À la base du mouvement, une idée qui ne coûte pas très cher : tout le monde peut réinventer le vivant avec un placard, 1000 dollars et un mois de loyer.
Comme souvent dans le milieu de la contre-culture américaine, cette idée en télescope une autre - complètement préconçue d’après les jeunes visionnaires - selon laquelle le génie génétique serait une activité réservée à une élite. D’après eux, elle est l’affaire de tous et n’a pas besoin de laboratoires ultra-sophistiqués pour s’inventer.
En rupture totale avec la communauté scientifique, les premiers adeptes du DIY Bio chercheront très tôt à se rapprocher d’un autre groupe qui croit en l’ouverture autant qu’en la désobéissance à l’égard des autorités. C’est ainsi qu’ils vont trouver dans les hackers et leur culture - solidarité, compétences techniques, démontage - de solides alliés.
Aux alentours des années 2010, presque tous les membres de la Do It Yourself Biology se revendiquent en tant que « biohackers ». Quelques années plus tard, ils feront la démonstration, avec leurs PC, de leur capacité à faire des découvertes théoriques. Qu’il s’agisse de jouer avec les codes génétiques de l’homme et de l’animal ou de créer des kits biologiques en open source.
Tous des super-héros ?
À ce jour, on compterait environ 1 240 biohackerspaces dans le monde. Selon Thomas Landrain, il en naîtrait un nouveau chaque mois.
De ces espaces de liberté absolue - où l’on associe chercheurs, juristes, sociologues, philosophes, artistes - s’échappent de nouvelles inventions aux vocations qui semblent extraordinaires. Comme cet algorithme capable de différencier, d’après l’imagerie médicale, tumeurs bénignes et malignes pour un coût proche de zéro.
Grâce au numérique, la Paillasse a créé un bioréacteur qui permet de contrôler la prolifération des bactéries et de créer des biomolécules pour détoxifier les déchets. Coût ? 500 euros, soit 100 fois moins qu’un développement commercial.
Le Web et la DIY Bio ont également permis de démocratiser des savoirs extrêmement complexes. Longue entreprise académique de 23 ans, le code du génome humain serait désormais disponible en ligne, sous la forme d’un fichier de 1,44 gigaoctet.
En près de 10 ans de conceptualisation et à grands renforts de conférences TEDx, le biohacking semble désormais être parvenu à un certain degré d’institutionnalisation. Depuis 2014, la Paillasse est soutenue par la Ville de Paris et plusieurs de ses projets ont été financés par des organisations bien connues, de la NASA à Sony.
Sur Internet aussi, les biohackers commencent à se faire une certaine e-réputation. À commencer par Josiah Zayner, chercheur scientifique américain aussi talentueux qu’excentrique, qui vend « des kits d’auto-administration de thérapie génique » entre 23 et 150 euros.
Le biohacker s’est révélé au grand public en s’injectant dans l’avant-bras de quoi modifier ses cellules musculaires. Dans son sillage, de drôles de personnalités brandissent les propriétés de la DIY Bio, comme ce guru de la tech qui entend dépenser 250 000 euros afin de devenir un super-héros ou cet ancien « bricoleur du vivant », premier homme à s’injecter un traitement inédit contre l’herpès et retrouvé mort dans de mystérieuses circonstances.
Parce qu’Internet est un immense espace de liberté, le biohacking fait aussi l’objet des plus folles rumeurs. Va-t-on pouvoir vivre éternellement via à un kit à 100 euros en ligne ? Va-t-on pouvoir choisir la qualité de peau de nos enfants ainsi que leur taille et la couleur de leur yeux par grâce à un PDF ? Quoi qu’il en soit, les biohackers posent d’ores et déjà des cas de conscience à certains gouvernements en matière de biosécurité, notamment en Allemagne.
Thomas Landrain ne s’embarasse pas de ces questions juridiques et préfère souligner que les biohackers ont mis au point une première charte éthique, ce que les académiciens n’avaient jamais su faire avant eux. Et les récentes affaires d’inconduite scientifique de la biologie française pourraient bien lui donner raison.
Alors, demain, tous savants ?

Estonie : le paradis du numérique (2/2)
Au Nord-est de l’Europe se trouve un petit pays dont la France aimerait s’inspirer. Bonne idée, car dans le domaine du numérique, l’Estonie est la championne du monde toutes catégories. Exploration d’un État nation qui a tout compris avant les autres.
[Suite du premier épisode proposant un état des lieux de l’exemplarité de l’Estonie en matière de numérique]
Les grandes manœuvres commencent dans la foulée de l’indépendance du pays, en 1991. Le pays sort exsangue du joug de l’URSS et doit tout réinventer. « Au sortir de l’effondrement du bloc soviétique, l’Estonie est un État dévasté, explique Arnaud Castaignet. Mais paradoxalement cela va constituer une immense opportunité : celle de ne pas avoir à transformer toute son administration mais de partir de zéro. » Surtout que le gouvernement possède les fondations sur lesquelles construire son grand pari numérique.
Dans l’Union soviétique, l’Estonie était le centre de fabrication des logiciels et des ordinateurs du régime. C’est donc dès le départ que les responsables politiques décident d’allouer 1% de leur budget aux technologies de l’information. Pour le reste, il suffit de s’amarrer à l’essor d’Internet dans les années 90 et d’avoir de l’audace. « Avant l’éclatement de la bulle Internet, en 1997, l’Estonie a déjà connecté toutes ses écoles à Internet », raconte Arnaud.
S’ensuit une frise historique qui se déroule à la vitesse de la fibre optique. En 2000, le pays consacre l’accès à Internet comme un droit fondamental. En 2002, il vote l’utilisation obligatoire d’une « carte d’identité numérique » que chaque Estonien reçoit à ses 15 ans pour régler les services publics, payer une place de parking ou gérer son abonnement à la salle de sport. En 2005, le pays annonce qu’internet est accessible sur l’ensemble du territoire, même les forêts.
Un système blindé
À chaque prise de risque, le gouvernement obtient une avance confortable pour instituer et administrer son plan numérique. « Aujourd’hui, 90% des adultes âgés entre 15 et 74 ans sont internautes. Mais ce n’est pas encore toute la population ! On y travaille… Mais dès le milieu des années 90, nous avons mis en place toute une série de mesures pour faciliter notre réussite digitale », explique Siim Sikkut.
Programmes d’informatique à l’école, campagnes de communication, innovations technologiques, design thinking, formation des cadres de l’administration… La liste est longue mais tout en haut figure la sensibilisation aux risques du numérique, et plus précisément la protection des données personnelles.
De tous les éléments qui composent la culture numérique estonienne, c’est peut-être le plus innovant. « Ils ont complètement retourné la vision négative que l’on peut avoir sur les enjeux numériques. Tout simplement en laissant le contrôle des données personnelles dans les mains des citoyens », explique Arnaud Castaignet. Seuls propriétaires de leurs données, ces derniers peuvent à tout moment surveiller qui consulte leurs informations personnelles et pour quelles raisons. De lourdes amendes voire des peines de prison ont déjà été prononcées à l’encontre de médecins ou de fonctionnaires trop curieux.
Autre principe unique au monde : le « one only », selon lequel l’administration ne peut pas demander à un administré une information qui lui a déjà été délivrée. « Tout est régi par la confiance, l’échange et le respect de la vie personnelle, continue Arnaud. Et cela se constate à tous les niveaux de l’administration. Quand j’ai embarqué dans le programme e-residency, on testait les choses en mode bêta. Autrement dit, on demandait à chaque utilisateur de tester une évolution. Je ne connais aucun autre gouvernement qui fonctionne de cette manière. »
À vouloir surfer sur la plus haute vague de la Toile, il peut cependant arriver d’essuyer quelques tuiles. Ainsi en 2007, l’Estonie devient le premier État nation du monde à être victime d’une cyberattaque. D’origine toujours inconnue, l’assaut sur les serveurs estoniens ne porte toutefois pas atteinte au système. Au contraire, elle le renforce. « Ça nous a servi de leçon », résume Siim Sikkut.
En plus d’avoir créé un contingent d’experts qui se chargent de prévenir ce genre de menace – la Cyber Defence League - le gouvernement tâche de sensibiliser la communauté internationale aux dangers de possibles cyberguerres, au sein de l’UE ou de l’OTAN. Au printemps dernier, il annonçait la création d’une e-ambassade au Luxembourg prévue pour 2018.
L’idée ? Assurer la continuité de l’État estonien en cas de catastrophe naturelle ou « d’invasion russe » grâce au stockage ultime de toutes les données dans un lieu tenu secret. « Ils utilisent aussi une architecture ultra-sécurisée appelée X-Road, poursuit Arnaud Castaignet. Fondée sur la technologie similaire à la blockchain (une technologie de stockage et de transmission d’informations sans organe centrale de contrôle, ndlr) elle leur permet de décentraliser toutes les données. »
À bien des égards, la culture numérique estonienne se lit comme un grand livre ouvert dont il va bien être difficile de recopier les pages. Au sujet de la duplication du système en France, Arnaud Castaignet doute que s’en inspirer totalement soit pertinent. « Il y a de quoi être influencé, affirme-t-il. Mais l’Estonie reste un pays avec une petite population qui ne connaît pratiquement aucun bouleversement sociétal. Appliquer son fonctionnement à un État de 67 millions d’habitants me semble inadapté. »
Il faudra sans doute plus de 5 ans au gouvernement français pour caresser la réalité estonienne. Mais qu’Edouard Philippe se rassure, les Estoniens pensent régulièrement à la France. Le pays balte se plaît à souligner que grâce au tout-numérique, il économise en papier chaque année l’équivalent d’une Tour Eiffel. Un clin d’œil diplomatique ?

Fact-checking : et si les citoyens donnaient une correction aux journalistes ?
Ces dernières années, les journalistes ont été rappelés aux devoirs premiers de leur profession : la vérification des faits. Mais à l’heure où les fausses informations pullulent, n’est-il pas temps pour les médias de compter sur les citoyens ?
Le 10 octobre dernier, la Terre a tremblé. Il a suffi que le fil d’actualité du Dow Jones affiche « Google va racheter Apple pour 9 milliards de dollars » pour que l’espace de quelques minutes, la Toile s’embrase et les Internautes avec. Le prix de l’action d’Apple aura même eu le temps de connaître quelques secousses. Pourtant, fausse alerte. Le titre que des milliers d’abonnés à la newsletter du Dow Jones ont reçu ce matin-là, n’était en réalité qu’un test qui n’avait pas du tout vocation à être publié.
La post-vérité
Quelques jours après cette épi-catastrophe, l’activité de la bourse et du monde médiatique a repris son rythme frénétique, balayant les informations les unes après les autres. Néanmoins, tout porte à croire qu’au sein du Dow Jones, quelqu’un s’est fait souffler dans les bronches. Car à l’heure actuelle, on ne rigole plus beaucoup avec les fausses informations. Même quand elles paraissent improbables.
Depuis quelques années, le monde de l’information semble tourner en permanence autour du même axe : la résistance aux fake news. Ce qui fait partie de la fabrique de l’information depuis l’origine est soudainement devenu l’élément le plus discuté des rédactions. Nous serions même rentrés dans une nouvelle ère, celle de la post-vérité. Un néologisme que l’influent dictionnaire britannique Oxford a même choisi de couronner de « mot de l’année » 2016.
Comme un jeu de miroir parfait, deux autres termes que l’on peinait jusque-là à définir sont également devenus les mots les plus véhiculés par les médias : le « fact-checking ». Traduction : la vérification des faits. Parties immergées d’un immense iceberg, des rubriques voire des émissions sont désormais entièrement consacrées à la vérification de l’information. En France, elles s’appellent « Désintox » (Libération), « Les Décodeurs » (Le Monde) ou « Le Vrai du Fake » (France Info).
Ces programmes connaissent un intérêt grandissant, précisément pendant les périodes électorales où la parole publique y est plus engagée. Pourtant, le fact-checking a fait son apparition il y a bien longtemps. En France, l’anglicisme se répand dans les salles de rédaction à partir des élections présidentielles de 2007. Mais c’est aux États-Unis qu’il naît, au mitan des années 90, à la faveur d’une expérience menée par l’université de Pennsylvanie : The Annenberg Political Fact Check. Et c’est à travers le média spécialisé PolitiFact.com, prix Pulitzer 2009, que la pratique va véritablement s’institutionnaliser.
Correctiv, Facebook et les fake news
L’histoire de la vérification de l’information est multiple et lointaine. De tout temps, le journalisme a dû faire face aux fausses nouvelles. Alors, pourquoi le fact-checking est-il soudainement revenu sur le devant de la scène ces dernières années ? « Si la propagande existe depuis longtemps, les moyens pour la véhiculer ont bien changé. Aujourd’hui, avec les réseaux sociaux, les personnes qui veulent bouleverser nos sociétés possèdent les meilleurs outils pour cibler et toucher des groupes de gens bien précis », explique David Schraven, directeur de la publication de Correctiv.
Ce média allemand, lancé en 2014, est devenu en moins de deux ans la référence de la lutte contre les fake news en Europe. Parce que son nom l’indique mais aussi parce qu’il a compris avant les autres qu’il se tramait quelque chose de néfaste dans l’univers des médias. « Lorsque le journalisme web est apparu, la course aux clics, l’accent mis sur les sujets polémiques et le manque de sources vérifiées ont appauvri la profession. Ce qui a conduit à une perte de confiance énorme dans les médias », poursuit David Schraven.
En faisant de l’investigation et du fact-checking le cœur de son activité journalistique, Correctiv a su regagner la confiance du public et propose désormais à de nombreux médias allemands de relayer ses contenus et ses enquêtes dans leurs colonnes.
Correctiv s’est ouvert à tout, y compris à ce qui semblait représenter « l’ennemi ». L’année dernière, il a conclu un partenariat avec Facebook, bouleversé par la prolifération de fausses informations sur son réseau lors de la campagne présidentielle américaine de 2016. Le deal est alors simple : Facebook permet à ses utilisateurs d’identifier un contenu incorrect, Correctiv vérifie la requête. « Ça ne s’est pas passé tout à fait comme je le voulais, mais c’est une bonne approche. Les gens lisent en majorité les informations sur les réseaux sociaux, c’est donc là qu’il faut intervenir », confie David.
Pourtant, ce dont il est le plus fier ne se passe pas en ligne mais bel et bien sur le terrain. Les équipes de Correctiv ont également monté des projets pour éduquer le citoyen à la collecte d’informations. « Nous avons monté des classes dans tout le pays pour apprendre au citoyen comment récolter une information dont il a besoin », traduit le patron de Correctiv.
À ce jour, 3 000 personnes ont bénéficié de ses cours et sont désormais capables de se rendre dans n’importe quelle institution publique pour formuler une requête précise. La démocratie s’en porte mieux, mais le média aussi puisqu’il peut utiliser les données collectées par les citoyens. C’est ainsi que Correctiv a lancé une plateforme intitulée « Crowdnewsroom » composée des mots « foule » et « rédaction ».
« Un fact-checking citoyen est clairement possible »
En France, le fact-checking reste une pratique dévolue aux journalistes. Pourtant, ici et là, des initiatives commencent à placer le citoyen au cœur du processus de vérification des informations. C’est le cas de Voxe, une plateforme civique créée en 2012 qui vise à rapprocher les jeunes du débat public. À l’origine, elle proposait de comparer les programmes des candidats afin que le citoyen s’informe davantage sur la campagne présidentielle en cours.
Mais aujourd’hui, les membres de l’organisation organisent aussi des débats, des ateliers, des conférences sur la politique dans toute la France par l’intermédiaire du « Voxe Tour ». « On s’est rendu compte que si on veut faire du fact-checking citoyen, il faut que les gens sachent de quoi on parle. Or, on observe un déficit démocratique grandissant qui fait que les gens n’ont pas les armes pour certifier ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas », affirme Léonore de Roquefeuil, directrice exécutive de Voxe. La solution ? « Éduquer, former, parler aux gens. »
Ainsi, la mission de sensibilisation et d’éducation à l’information, aujourd’hui portée par des médias et des organisations civiques, ne relèverait-elle pas aussi des institutions publiques, à commencer par l’école ? « Nous, ce sont les professeurs qui viennent nous voir, répond Léonore. L’école, on ne peut pas lui dire de tout faire. Il faut mettre en action le citoyen, le faire discuter, l’animer. »
Même son de cloche chez David Schraven : « Un fact-checking citoyen est clairement possible. Mais il faut éduquer les gens, dès le plus jeune âge. On ne trouvera jamais la recette miracle par des partenariats prestigieux ou des projets géniaux. Aujourd’hui, ce qu’il nous faut, c’est du temps. Cela prendra peut-être 10 ans, mais on montrera aux gens qui pensent que c’est impossible que c’est en faisant les choses que ça marche ». Alors, méfiez-vous. La prochaine fois qu’un citoyen lambda vous annonce que Google rachète Apple, croyez-le.

Time Well Spent : passer du bon temps sur Internet
Dans un univers où la majorité des services sont gratuits, notre utilisation d’Internet a un coût : notre temps. Avec son entreprise baptisée « Time Well Spent », Tristan Harris pointe du doigt les dessous de cette nouvelle économie de l’attention.
L’histoire semble tirée d’Un jour sans fin. Comme Bill Murray dans le film culte d’Harold Ramis, le réveil de plusieurs milliards d’individus semble régi par une routine infernale.
80% des humains qui utilisent un smartphone exécutent exactement le même geste lorsqu’ils ouvrent les yeux. Dans un même mouvement universel, ils sortent un bras du lit, allument leurs téléphones et regardent l’ensemble de leurs notifications. La trame pourrait servir de base scénaristique à une nouvelle comédie fantastique consacrée à l’absurdité de notre époque.
Sauf que cela ne fait plus rire grand monde. Ils sont désormais des centaines d’experts, de docteurs, de psychanalystes ou autres coachs mentaux à alerter sur les dangers de laisser son portable dans la chambre à coucher. Problème, le smartphone n’est pas qu’une ritournelle matinale : une fois réveillée, une personne le vérifiera en moyenne 150 fois par jour, en lui consacrant jusqu’à 5 heures d’attention.
Le résultat des préconisations médicales est quant à lui sans appel : les gens sont de plus en plus accros. Et l’histoire de notre addiction à la technologie ne ressemble plus vraiment à un conte de Noël : nous sommes bel et bien devenus esclaves de nos téléphones.
Entre magie et machine à sous
Bien évidemment, l’histoire comporte aussi son héros. Dans la nôtre, il s’agit d’un jeune américain qui en plus de ne pas céder à la fatalité, pourrait enfin résoudre l’équation insoluble et affreusement addictive que semblent imposer les géants du Net.
En 2016, Tristan Harris créait Time Well Spent. Son constat ? Google, Facebook, Apple ou Youtube nous prennent tout notre temps. Son pari ? Il faut le reprendre en repensant complètement l’interface des smartphones et de leurs applications. Un an plus tard, Time Well Spent agit comme un label de qualité, destiné à récompenser les technologies qui respectent nos choix et notre temps disponible, sans chercher à nous distraire ou à capturer notre attention.
Aujourd’hui, impossible de connaître le nombre exact de services que la société de Tristan Harris a étiquetés. En quelques mois, Time Well Spent n’a sûrement pas encore converti les grandes têtes pensantes de la Silicon Valley à investir dans un Internet du « Temps Bien Passé » mais le jeune designer diplômé de Standford n’y voit pas forcément une fin en soi. Dans ses prises de parole, il répète à l’envi que ce qu’il veut, c’est une conversation sur la manière dont la technologie pirate l’esprit des gens.
Et il semblerait que beaucoup de monde ait envie de parler avec Tristan Harris. Son manifeste publié sur Medium a conquis plus de 17 000 Internautes. Sa conférence TEDx a été vue plus de 243 000 fois. Il a longuement conversé avec le rédacteur en chef du Wired et The Altantic a qualifié son entreprise de « plus grand cas de conscience de la Silicon Valley ».
Le jeune trentenaire intitule généralement ses interventions de la même manière : « La technologie pirate nos esprits et je vais vous dire comme elle le fait ». Lorsqu’il crée Time Well Spent, Harris a déjà passé trois ans en tant que philosophe-produit chez Google (« Design Ethicist »). Autrement dit, de l’autre côté de la barrière.
Sa mission ne sert qu’un objectif : capter l’attention des gens et ce le plus longtemps possible. Ainsi, le designer s’enferme chaque jour dans une pièce pour penser les éléments qui vous feront rester sur telle ou telle application.
Si vous utilisez Facebook, c’est ce tag qu’un ami a utilisé pour que vous alliez voir sa photo. Si vous êtes sur YouTube, c’est cette vidéo qui se lance toute seule alors que vous n’avez rien demandé. Les mécanismes et les leviers psychologiques qui se cachent derrière ces innovations technologiques sont extrêmement complexes. Pourtant, Tristan Harris les compare à un simple tour de magie.
Magicien lui-même, il explique que les combines des grands réseaux sociaux exploitent la vulnérabilité et les limites de la perception des gens comme le feraient les prestidigitateurs. L’idée sous-jacente étant la même : tromper les gens sans qu’ils ne s’en rendent compte.
Le temps, c’est de l’argent
L’entreprise de Tristan Harris vient percuter un nouveau concept dont le champ d’étude reste encore relativement flou en 2017 : l’économie de l’attention. Théorisée par certains sociologues au début du XXème siècle, elle revêt une nouvelle dimension à l’ère du numérique.
Dans un monde largement digital, il est devenu ordinaire d’utiliser gratuitement certains services proposés par Google et Facebook. En contrepartie, ces derniers se servent de vos données personnelles et de votre temps pour en faire commerce. Un procédé qui a popularisé une expression - « Si c’est gratuit, c’est que vous êtes le produit » - dont Harris s’est servi pour écrire son manifeste.
« Tout en nous donnant faussement l’impression de choisir, nos écrans menacent notre liberté fondamentale de vivre notre vie comme on l’entend, de dépenser notre temps comme on le veut, écrit-il. Et remplacent les choix que l’on aurait faits par les choix que ces entreprises veulent que l’on fasse. »
Selon lui, nous serions interrompus en moyenne toutes les 15 minutes par une notification, un mail ou un message sur Messenger. Lorsque nous nous extirpons d’une tâche, nous mettons en moyenne 23 minutes à nous reconcentrer.
« Mais il y a pire, écrit le jeune designer. Plus nous sommes interrompus, plus nous sommes conditionnés à être interrompu. Nous nous interrompons donc nous-mêmes toutes les 3 minutes et demie. »
Un cercle vicieux, qui pourrait expliquer l’immense ballet matinal qu’exécutent des milliards d’humains lorsqu’ils se réveillent le matin avec leurs téléphones. Si c’est irrationnel selon Harris, c’est loin d’être nouveau.
« Aux États-Unis, une seule chose génère plus d’argent que le baseball, les films et les parcs d’attractions combinés : les machines à sous. Et lorsque nous retirons notre téléphone de notre proche, nous jouons à une machine à sous pour voir quelles notifications nous avons reçues. »
Mais comment stopper cette mécanique infernale ? Avec Time Well Spent, Tristan Harris plaide pour un design éthique, soit « des technologies qui nous rendraient notre liberté de choix ».
Après un an d’existence, difficile d’affirmer que Time Well Spent convaincra les GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) à redessiner leurs services, téléphones et applications. Alors comme souvent, le jeune designer américain répète que le futur appartient à chacun d’entre nous. En « réduisant le nombre de perturbations », « supprimant les notifications pour les mails », « réorganisant son écran d’accueil »… nous participerons peut-être à la reprise en main de notre temps et de notre attention. Et sans doute aussi, à la création d’une toute autre chorégraphie matinale.
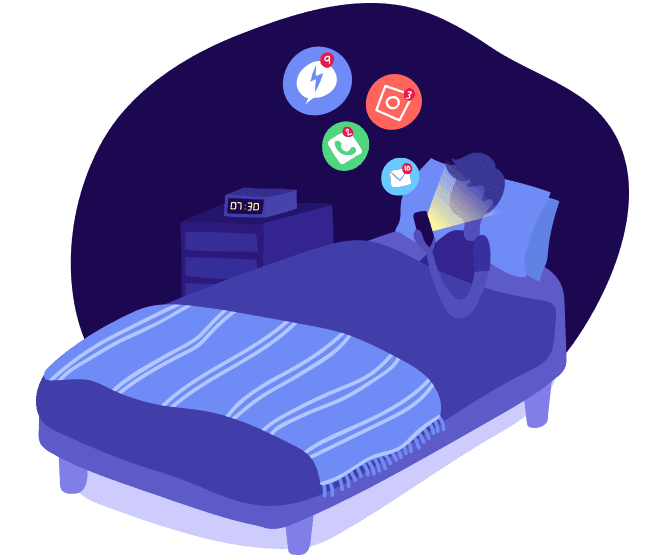
Les cookies : les informations croustillantes du Web
Tout le monde les connaît mais personne ne sait réellement ce qu’ils sont. Sortis du four du Web il y a 20 ans, les cookies font toujours l’objet de grandes interrogations sur leurs fonctions et origines. Nous vous en donnons enfin la vraie recette.
1001 allégories sont possibles, alors prenons celle-ci : imaginez que vous mangez un cookie sur une table. Si vous êtes une personne normale, vous laisserez des miettes. Elle vaut ce qu’elle vaut, mais la figure de style a le mérite de poser les bases d’un des plus grands fantasmes de l’ère numérique : les cookies. Dans une définition communément admise, un cookie est un tout petit fichier déposé par votre navigateur sur votre ordinateur lorsque vous surfez sur Internet. Autrement dit, c’est une trace que vous laissez derrière vous quand vous êtes en ligne. Ce fichier est minuscule, à peine visible. Une miette.
Ma part du gâteau
Alors pourquoi en faire tout un fromage ? Car deux décennies après leur apparition, les cookies font toujours l’objet de grandes interrogations. Présenté par la Commission européenne le 10 janvier 2017, un nouveau règlement 1 intitulé « ePrivacy » encadre désormais leur utilisation. Mis en application simultanément avec le Règlement Général sur la Protection des Données le 25 mai prochain, il imposera aux navigateurs internet de soumettre aux utilisateurs l’acceptation ou le refus du dépôt des cookies sur leurs ordinateurs. Car oui, quand vous vous baladez sur le Net, de petits fichiers se déposent automatiquement sur votre disque dur sans que l’on vous demande votre avis.
D’ores et déjà en France 2, les sites internet doivent informer les internautes de la finalité des cookies au travers de leurs mentions obligatoires, obtenir leur consentement sur leur utilisation et leur offrir la possibilité de les refuser. Demain, le règlement de la Commission permettra aux internautes de refuser les cookies a priori, en les excluant automatiquement grâce aux options proposées par les navigateurs Chrome, Firefox ou Internet Explorer.
Peut-être penserez-vous que les autorités ratissent large pour quelques miettes. Mais c’est parce qu’elles se méfient des apparences. S’ils sont minuscules, les cookies ne sont en aucun cas inoffensifs. Suite à l’explosion de la bulle Internet, de nombreux sites marchands ont clairement saisi l’opportunité fournie par ce que l’on pourrait associer à des « empreintes digitales ».
Lorsque vous vous rendez sur un site marchand, vos informations personnelles (nom, adresse, numéro de téléphone…) sont conservées par la page que vous avez consultée. Si bien que quand vous y revenez, vous retrouverez automatiquement les achats que vous aviez sélectionnés lors de votre première visite.
Cette méthode de traçage a séduit beaucoup d’éditeurs de sites jusqu’à créer un véritable pistage commercial, comportemental et social des internautes. Résultat : Facebook vous propose des publicités qui correspondent aux contenus que vous venez de consulter et Google hiérarchise vos requêtes en fonction de votre activité sur des sites marchands.
Les cookies sont même devenus un véritable modèle économique pour certains éditeurs de sites gratuits qui revendent - parfois très cher - les informations personnelles de leurs visiteurs (page, adresse email…). Dans la bataille juridique que mènent les institutions européennes à propos de l’utilisation de ces fichiers déposés, l’enjeu est donc plus grand qu’il n’y paraît de prime abord.
Maîtriser ses cookies
À l’origine, les cookies ont pourtant été pensés comme une innovation technologique permettant de faciliter l’utilisation d’Internet. C’est en tout cas l’intention de Lou Montulli un jour de juin 1994. Lorsqu’il s’assoit à son bureau, le développeur qui travaille alors pour le compte de Netscape Communications entend régler un problème de taille pour ses clients : faire en sorte que leur site puisse enregistrer les données qu’un internaute aurait déjà fournies lors de sa première visite. C’est alors que l’ingénieur propose l’idée de placer un petit fichier dans l’ordinateur de chaque visiteur de manière à enregistrer ces informations.
Sa technologie, Lou Montulli la présente sous le nom de « persistent client state object ». Littéralement : un témoin client permanent. Mais l’employé de Netscape va finalement s’inspirer d’un terme, plus parlant, que les développeurs des premiers sites Internet utilisaient lorsqu’ils s’échangeaient les premiers programmes de code : les « magic cookies ». Rapidement, les « cookies magiques » perdront leur qualificatif mais révolutionneront la manière dont fonctionne Internet. Car Lou Montulli ne vient pas simplement d’inventer un nouvel outil génial pour les sites commerciaux, il dote Internet d’une mémoire.
Cette mémoire déposée en mille morceaux s’est avérée cruciale dans le développement du Web et de ses acteurs. Les cookies ont permis aux premiers sites de recueillir des informations essentielles comme leur nombre de visiteurs ou des renseignements techniques. Côté internautes, ils leur ont offert un certain confort de navigation en retenant leur signature électronique ou leur mot de passe.
Seulement voilà, les cookies sont tout aussi vite devenus des traceurs et leur qualité pratique a très tôt été remplacée par un pur intérêt commercial. En 2014, la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés, ndlr) a souhaité contrôler 3 la manière dont les règles applicables aux cookies étaient ou non respectées.
Conclusion : sur une cinquantaine de tests, une vingtaine d’éditeurs de sites français ont été mis en demeure. Quatre ans après, la discussion s’est déplacée en haut-lieu – gouvernement, Commission européenne – pour rappeler les enjeux de vie privée et de sécurité des citoyens attachés aux cookies.
En attendant l’issue des arbitrages, la CNIL rappelle qu’il est déjà tout à fait possible de maîtriser ses cookies. Dans une vidéo pédagogique 4, l’organisation précise qu’il existe des logiciels spéciaux qui permettent d’en bloquer certains. Un internaute peut en outre contrôler les traces qu’il laisse derrière lui en supprimant son historique ou en modifiant les préférences de ses navigateurs. Nettoyer, ranger, trier restent finalement les meilleures options pour garder la maîtrise de sa vie privée sur Internet. Et pour quelques miettes, cela peut se faire aussi facilement qu’un coup d’éponge sur la table.
1 : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-16_fr.htm
2 : https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31228
3 : https://www.cnil.fr/fr/cookies-et-autres-traceurs-premier-bilan-des-controles
4 : https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser
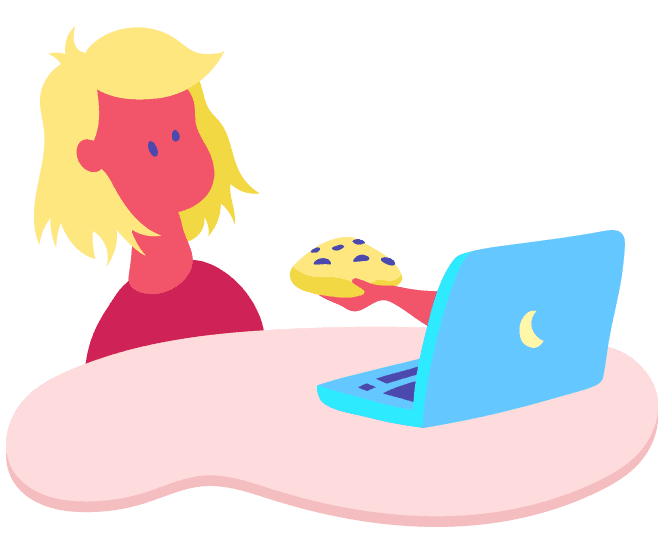
Blockchain : la révolution silencieuse
Elle serait annonciatrice d’une nouvelle révolution, équivalente à celle d’Internet. Si l’on tend bien l’oreille, la technologie blockchain devrait même sauver le monde. Mais de quoi s’agit-il ?
Qui est aujourd’hui capable de nommer l’inventeur d’Internet ? Chaque fois qu’un grand mouvement se lève, il est en général déjà trop tard pour en identifier les pionniers. Quant à la technologie blockchain, nombreux sont ceux qui l’associent déjà à une révolution similaire à celle survenue avec Internet. Mais cette fois, tous en situent très bien les origines.
Déchaînement
C’était en 2008. Cette année-là, alors que la crise frappe la planète, Satoshi Nakamoto met en ligne un fichier PDF intitulé « Bitcoin : un système monétaire électronique de pair-à-pair ». Dix ans plus tard, le document éclabousse encore le monde de l’économie, qui a vu le cours du bitcoin monter et descendre, sans vraiment tomber d’accord sur sa viabilité. En revanche, tout le monde s’accorde sur le bien-fondé de la technologie à l’origine de la crypto-monnaie, et ce bien au-delà du monde économique.
Politiques, artistes, ingénieurs, développeurs… tous se mettent à parler de révolution. Ils finiront par mettre un nom sur la technologie que Satoshi Nakamoto lui-même ne nomme jamais le long des neuf pages de son manifeste : il s’agit de la blockchain ou « chaîne de blocs ».
Aujourd’hui, elle est partout. À la Une des magazines, sur les fils d’actualité Facebook, au sein des conversations Twitter et même dans l’hémicycle de certains parlements.
En France, la blockchain a fait une entrée fracassante à l’Assemblée Nationale via deux amendements défendus par une députée LR dans le cadre de la loi Sapin sur la transparence financière et la lutte contre la corruption. Son idée ? Se servir de cette technologie pour valider les transactions financières ou la reconnaissance d’actes juridiques.
Si ces propositions ne sont finalement pas retenues, la blockchain parvient dès lors à pénétrer les institutions, et fera même son bout de chemin en politique. Le 9 décembre dernier, le conseil des ministres a adopté une ordonnance qui facilite la transmission de certains titres financiers non côtés au moyen de la technologie blockchain. Une première en Europe.
Dans d’autres pays, la blockchain dépasse même le domaine financier. Au Ghana, elle est utilisée pour résoudre les problèmes liés à l’absence de registres et de cadastres. La technologie quitte donc peu à peu le milieu des initiés. Mais quid du grand public ?
Malgré les couvertures de magazines et les titres racoleurs, il serait aujourd’hui très prétentieux d’affirmer qu’une majorité s’est appropriée le concept. Alors, on l’explique. Et on fait souvent référence à l’allégorie donnée par un mathématicien 1 pour présenter la technologie.
La blockchain ressemblerait à un « grand livre de compte qu’on met sur la place du village et où tout le monde a le droit d’écrire mais que personne ne peut effacer. Le livre enregistre l’historique de toutes les transactions qui ont lieu au sein du village ». Mais la blockchain se fonde aussi sur une promesse, celle de pouvoir se faire confiance sans se connaître et sans intermédiaire.
Mieux qu’une banque, Uber et… la loi
La chaîne de bloc est ainsi composée de toutes les transactions que les individus ont passées entre eux. Elle garde trace de tout ce que l’on possède et de tout ce que l’on échange. Avant de valider une transaction, le système va scanner l’ensemble de la chaîne pour s’assurer que le contractant possède bien ce qu’il prétend échanger. Une fois la transaction approuvée, un nouveau bloc vient s’ajouter à la chaîne.
Le système informatique fonctionne grâce à une grande puissance de calcul que des particuliers - baptisés « mineurs » - offrent et utilisent pour vérifier les échanges. Mais à quoi cela sert-il concrètement ?
Dans le cas du bitcoin, la blockchain permet à des individus d’échanger de l’argent sans avoir recours à un tiers, qu’il soit privé (une banque) ou public (les institutions monétaires). La technologie donne donc un pouvoir décentralisé à ses utilisateurs. Comprendre : la blockchain offre un vrai espace de liberté et redonnerait purement et simplement le pouvoir aux internautes.
Dans la vraie vie, comment ça marche ? Les défenseurs de la technologie ont plusieurs fois mis en avant les smart contracts, ces programmes autonomes qui exécutent automatiquement les conditions définies au préalable et inscrites dans la blockchain.
Certaines applications rêvent ainsi de concurrencer Airbnb, Uber ou Deliveroo en mettant en relation les utilisateurs directement entre eux. L’industrie culturelle pourrait aussi tirer parti des chaînes de blocs pour prouver qu’une création appartient bien à un artiste, ou encore rémunérer équitablement les artistes en identifiant facilement les auteurs d’une œuvre d’art. Ces éléments intéressent de plus en plus les gouvernements, séduits par son potentiel de simplification, qui pourraient ainsi l’utiliser dans les domaines de l’économie et de la culture, mais aussi dans celui de la santé.
Mais alors, pourquoi la révolution n’est-elle pas d’ores et déjà en marche ? Car plusieurs freins empêchent la blockchain d’avancer.
Le premier est culturel : on l’a dit, le grand public associe encore la technologie à un milieu d’initiés, qui a du mal à en démocratiser les usages. En découle une méfiance vis-à-vis d’un protocole technique dont la confiance est paradoxalement le principe fondateur.
Le deuxième est légal : beaucoup de sujets liés à la blockchain tombent dans un vide juridique, et le vœu d’un Internet décentralisé est encore un mythe auquel goûte peu le Législateur.
Enfin, le troisième est écologique : pour vérifier une chaîne de blocs, le système utilise énormément de puissance de calcul et beaucoup de machines qui font grimper la facture énergétique. Il semblerait donc qu’il faille attendre encore un peu avant de sauver le monde.
1 Jean-Paul Delahaye
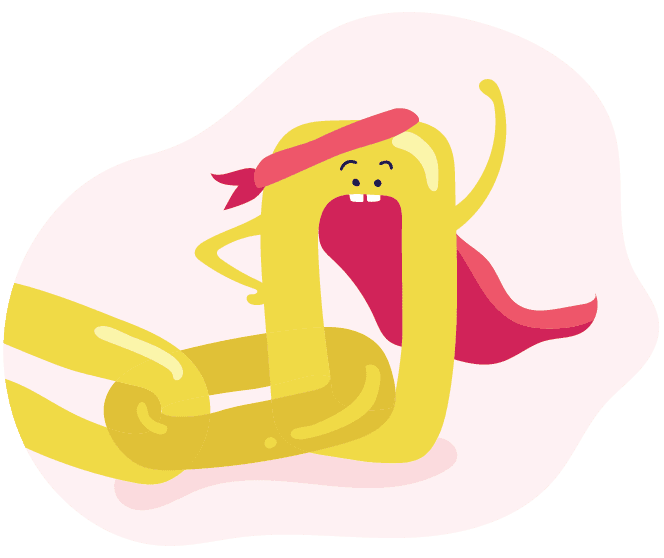
Le digital labor : les labeurs du numérique
Internet et ses plateformes de micro-tâches seraient devenus un instrument de servitude volontaire pour nombre de travailleurs du numérique. Réflexion sur la notion de « digital labor » : serions-nous tous des travailleurs invisibles du Web ?
Cela a pris un peu de temps. Quand Lorenzo a été embauché, il a fallu attendre un peu avant de se rendre compte que quelque chose ne tournait pas rond. « C’est devenu une drogue. On se levait tous la nuit pour aller vérifier les statistiques, le nombre de vues, ce que ça pouvait nous rapporter. » Il y a quatre ans, Lorenzo a signé un CDI dans une société qui avait pour ambition de devenir le média non-anglophone le plus lu du monde.
Depuis, il n’existe plus et Lorenzo est parvenu à se désintoxiquer des objectifs de performance infernaux que lui demandaient ses patrons. « J’étais rédacteur en chef de l’édition italienne, explique cet expat de 35 ans installé à Paris. Je devais écrire des articles mais aussi commissionner des pigistes pour qu’ils rédigent le plus grand nombre de papiers sur un sujet qui buzzait, du type Lady Gaga. La logique était simple : plus l’article avait de visites, plus tu gagnais de l’argent. »
Micro-tâches, maxi stress
Les possibilités sont loin d’être infinies. Le budget maximum pour un article est fixé à 24 euros. Et encore, il faut que ce dernier dépasse les 500 000 vues. Résultat, pour en tirer profit, il faut écrire beaucoup. Énormément même. « On ne savait plus quoi dire aux gens qui nous écrivaient à trois heures du matin parce qu’ils avaient vu une mini info sur Game of Thrones, continue-t-il. C’était devenu obsessionnel, les gens devenaient fous et les pigistes se livraient une véritable guerre pour être le premier à faire le buzz. »
L’enrichissement personnel, la concurrence, la pression, les micro-tâches… il semblerait que l’histoire de Lorenzo préfigure aujourd’hui ce que beaucoup appellent « l’ubérisation » du travail (du nom de l’application, ndlr). L’ubérisation ? Du côté des partisans : la possibilité de travailler partout, tout le temps, en toute indépendance. Du point de vue des détracteurs : une nouvelle aliénation qui ne dit pas son nom, une pression permanente et des burn-out.
Quoi qu’il en soit, les données Eurostat (de 2014, ndlr) montrent que les emplois précaires et atypiques progressent. Ils représenteraient désormais 32% du total des emplois en Europe. S’il est encore très difficile d’isoler le secteur d’activité qu’ils recouvrent en majorité, ces nouvelles formes du travail ont quasiment toutes un point commun : le numérique.
Il est encore trop tôt pour savoir précisément à quand remonte l’apparition de la notion de « Digital Labor », mais beaucoup mentionnent une conférence de 2012, organisée aux États-Unis et intitulée « The Internet as playground and factory ». Difficilement traduisible en français, elle a cependant vite été théorisée dans l’Hexagone par des sociologues comme Antonio A. Casilli et Dominique Cardon qui donneront au concept son premier ouvrage d’envergure, Qu’est-ce que le digital labor ? (aux éditions de l’INA).
Pour le définir, les deux auteurs commencent par dire ce qu’il n’est pas : il ne concerne ni un ensemble de personnes qui travaillent dans le numérique (ingénieurs, développeurs, informaticiens etc.) pas plus qu’un groupe de travailleurs qui seraient à la solde de géants du digital (comme par exemple le personnel des « fermes à clics » dans les pays dits « défavorisés »). Il s’agirait d’une notion - « toujours en voie de théorisation », insistent les auteurs - qui « refuse de faire l’impasse sur les phénomènes de captation de la valeur par les plateformes numériques ». En clair, le digital labor se construit sur une pensée critique qui vient directement interroger les nouvelles formes de travail sur Internet.
L’ancienne activité de Lorenzo pourrait tomber dans une première définition. La précarité associée à l’appât du gain que provoquent les micro-tâches peuvent s’apparenter à du digital labor. Comme le fait qu’un chauffeur Uber ou un livreur Deliveroo enchaîne les heures et les boulots pour pouvoir joindre les deux bouts. Seulement, les sociologues constatent que l’écosystème numérique réunit de plus en plus de conditions propres à cette forme de travail.
Sur la Toile, de nouvelles sociétés comme FoulFactory, Upwork ou Amazon Mechanical Turk proposent à des travailleurs indépendants de réaliser des micro-tâches. Pour 20 centimes, il vous sera possible d’enregistrer votre voix pour le compte d’un logiciel de montage ou de sélectionner un morceau pour une playlist « Good mood » sur Spotify.
Ces plateformes de micro-travail représentent aujourd’hui une part croissante de l’emploi. Une étude menée par l’Oxford University estime que dans 20 ans, aux États-Unis, 30% des travaux seront structurés selon les caractéristiques du digital labor. La même étude montre que dans le monde, ce travail alternatif a connu une progression importante depuis 15 ans, au point de représenter 16% de la force de travail actuelle. Et cela n’est pas prêt de s’arrêter : le marché du digital labor, évalué à 2 milliards de dollars en 2013 par la Banque Mondiale, ne cesse de grandir et pourrait atteindre, selon l’institution, entre 15 et 20 milliards de dollars en 2020…
L’hyper-travail
S’il n’avait jamais entendu parler du concept, Lorenzo n’est pas surpris de la pensée critique qui couve derrière le digital labor. Mieux, il la soutient. « Il suffit de rentrer dans un Uber pour s’apercevoir que les gens sont au bout du rouleau. Quand on regarde l’ubérisation du travail, comment ne pas trouver cela néfaste ? On a perdu la vision d’ensemble. On est comme dans une chaîne de montage où chacun accomplit une tâche spécifique sans comprendre le sens général de son action. » Antonio Casilli et Dominique Cardon préfèrent, quant à eux, renvoyer à l’idée du « travail en miette » théorisée par le sociologue George Friedmann dans les années 50. Là où beaucoup de jeunes travailleurs du digital labor ont l’impression de produire de la valeur et d’arrondir leurs fins de mois, les deux auteurs y voient un néologisme - « tâcheronner » - et une nouvelle ère dangereuse : celle de l’« hyper travail ».
Parce que le digital labor soutient aussi une philosophie critique de notre époque : nous serions en situation de travail permanent. Autrement dit, il serait extrêmement difficile de quantifier un temps de travail sur le web dès lors que la frontière entre nos vies professionnelles et nos vies personnelles se révèle de plus en plus poreuse.
Cela dit, Casilli et Cardon balaient d’un revers de main le droit à la déconnexion ou les conseils de « digital detox » préconisées par nombre d’acteurs. Leur réflexion sur le digital labor admet une vision encore plus pernicieuse : nous serions tous des travailleurs invisibles sur Internet. À partir du moment où nous avons consenti à donner de la valeur aux géants du numérique, nous serions tous des « travailleurs qui s’ignorent ». Cela peut aller de la rédaction d’un commentaire sur TripAdvisor à l’édition de son profil sur LinkedIn.
Selon les sociologues, « d’autres entreprises comme YouTube, Facebook ou Flickr prospèrent même grâce aux pratiques contributives du Net en faisant avec les internautes un pacte implicite : à vous l’enrichissement personnel lié aux possibilités de communication et de partage en ligne, à nous l’enrichissement financier lié à la monétisation de ces activités. »
Alors, sommes-nous tous aliénés par Internet ? ll est sûrement trop tôt pour tirer des conclusions compte tenu de la précocité conceptuelle du digital labor. Il n’empêche que cette nouvelle pensée critique vient de nouveau bousculer le crédit d’Internet et de ses acteurs. Et provoquer une nouvelle prise de conscience chez les utilisateurs ? En tout cas, une chose est sûre pour Dominique Cardon : « Internet était sympa, il ne l’est plus ».


